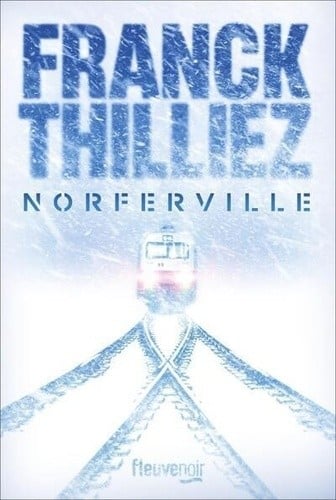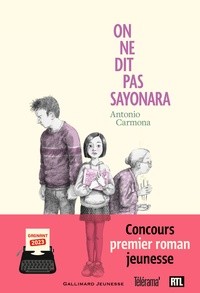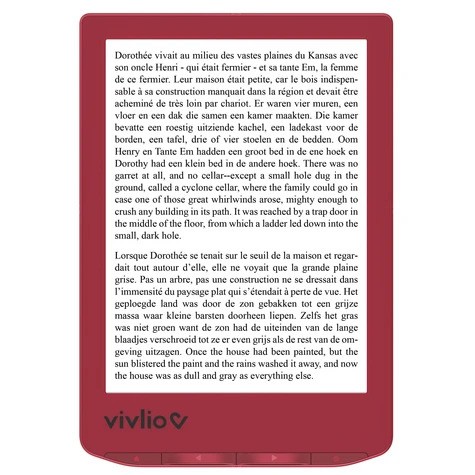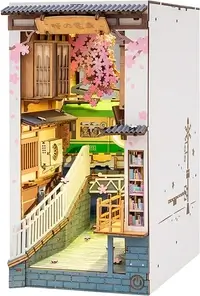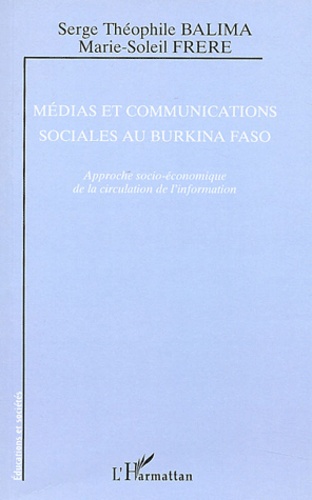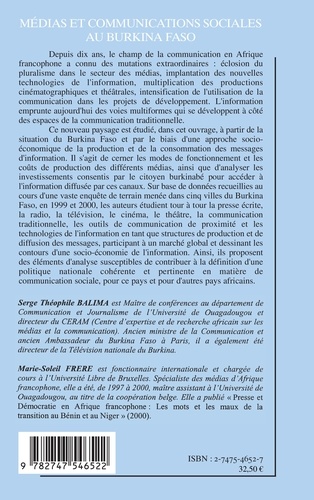En cours de chargement...
Médias et communications sociales au Burkina Faso - Approche socio-économique de la circulation de l'information
32,50 €
Neuf
Expédié sous 3 à 6 jours
Livré chez vous entre le 25 septembre et le 28 septembre
En librairie
Résumé
Depuis dix ans, le champ de la communication en Afrique francophone a connu des mutations extraordinaires : éclosion du pluralisme dans le secteur des médias, implantation des nouvelles technologies de l'information, multiplication des productions cinématographiques et théâtrales, intensification de l'utilisation de la communication dans les projets de développement. L'information emprunte aujourd'hui des voies multiformes qui se développent à côté des espaces de la communication traditionnelle. Ce nouveau paysage est étudié, dans cet ouvrage, à partir de la situation du Burkina Faso et par le biais d'une approche socio-économique de la production et de la consommation des messages d'information. Il s'agit de cerner les modes de fonctionnement et les coûts de production des différents médias, ainsi que d'analyser les investissements consentis par le citoyen burkinabé pour accéder à l'information diffusée par ces canaux. Sur base de données recueillies au cours d'une vaste enquête de terrain menée dans cinq villes du Burkina Faso, en 1999 et 2000, les auteurs étudient tour à tour la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma, le théâtre, la communication traditionnelle, les outils de communication de proximité et les technologies de l'information en tant que structures de production et de diffusion des messages, participant à un marché global et dessinant les contours d'une socio-économie de l'information. Ainsi, ils proposent des éléments d'analyse susceptibles de contribuer à la définition d'une politique nationale cohérente et pertinente en matière de communication sociale, pour ce pays et pour d'autres pays africains.
Sommaire
- L'ENTREPRISE MEDIATIQUE AU BURKINA FASO : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
- La presse écrite : une structuration difficile
- La radio : diversité et spontanéité
- La télévision : un monopole de fait
- L'ACCES A L'INFORMATION : RECEPTION ET CONSOMMATION
- Les publics de la presse écrite
- Les publics de la radiodiffusion
- Les publics et la consommation télévisuelle
- Les publics et leurs canaux d'information préférés
- LES AUTRES MOYENS ET LIEUX DE COMMUNICATION
- Le cinéma : le favori des jeunes
- Le théâtre : au service de l'information et de la sensibilisation
- Les réseaux de communication traditionnels : d'autres espaces publics
- Les outils de communication de proximité : sensibilisation et formation
- Les technologies de l'information et de la communication : la voix de demain ?
Caractéristiques
-
Date de parution01/06/2003
-
Editeur
-
Collection
-
ISBN2-7475-4652-7
-
EAN9782747546522
-
PrésentationBroché
-
Nb. de pages342 pages
-
Poids0.61 Kg
-
Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 1,6 cm
Avis libraires et clients
Avis audio
Écoutez ce qu'en disent nos libraires !
À propos des auteurs
Serge Théophile Balima est Maître de conférences au département de Communication et Journalisme de l'Université de Ouagadougou et directeur du CERAM (Centre d'expertise et de recherche africain sur les médias et la communication). Ancien ministre de la Communication et ancien Ambassadeur du Burkina Faso à Paris, il a également été directeur de la Télévision nationale du Burkina. Marie-Soleil Frère est fonctionnaire internationale et chargée de cours à l'Université Libre de Bruxelles. Spécialiste des médias d'Afrique francophone, elle a été, de 1997 à 2000, maître assistant à l'Université de Ouagadougou, au titre de la coopération belge. Elle a publié " Presse et Démocratie en Afrique francophone : Les mots et les maux de la transition au Bénin et au Niger " (2000).