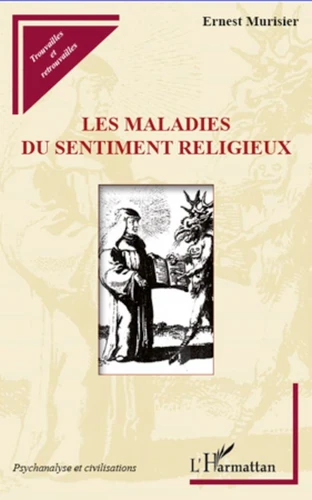Les maladies du sentiment religieux
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages178
- FormatePub
- ISBN978-2-296-82525-3
- EAN9782296825253
- Date de parution01/11/2011
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille12 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Poursuivant dans la perspective de Théodule Ribot l'étude des grandes fonctions mentales par leur pathologie qui les " décompose ", mais aussi " exagère " quelques-uns de leurs éléments constitutifs, Murisier explore ici, sans prétendre à l'exhaustivité, un sentiment supérieur : le sentiment religieux. Il aborde celui-ci sous sa forme individuelle par l'examen des multiples composantes présentes dans l'extase et le ravissement.
Ce sentiment est ensuite considéré sous sa forme sociale dans les manifestations du fanatisme. L'ouvrage s'achève par l'observation de la contagion déviante de l'émotion qui lui est propre (prophétisme des " déserts " cévenoles, épidémies de démonomanie chez les Ursulines, etc.). Chaque section est illustrée de documents psychologiques, mais aussi autobiographiques, historiques et sociologiques. L'auteur précise bien que son travail n'implique aucun réductionnisme lorsqu'il interprète par des facteurs affectifs (besoins, tendances, désirs, etc.) un sentiment aussi élevé que le religieux, ou que celui-ci perd de sa valeur une fois sa genèse connue.
Il pense même que la religion peut être, éventuellement, une " idée directrice ", facteur de synthèse de la personnalité. Toutefois, ses formes collectives peuvent aussi être désastreuses. Cent dix ans après sa première publication, ce livre garde toute son actualité, à lire un auteur suisse qui analyse le fanatisme, essentiellement, il est vrai, celui du protestantisme américain dans certaines sectes du revival, des mouvements dits évangéliques et autres Églises ultracalvinistes.
Les prêcheurs catholiques de croisades, les Pierre l'Hermite et l'intransigeant Saint-Bernard ne sont pas épargnés pour autant. Mais comment ne pas penser surtout à l'islamisme intégriste djihadiste contemporain, lorsqu'on lit : " Que la passion religieuse prenne une forme nationale ou une universelle, ses manifestations varient peu tant qu'une ligne de démarcation nette n'a pas été tracée et reconnue entre la cité de Dieu et la cité terrestre...
La suppression de l'hérétique est la conséquence naturelle, nécessaire, d'une religion qui prétend établir le règne absolu de Dieu sur terre. " ?
Ce sentiment est ensuite considéré sous sa forme sociale dans les manifestations du fanatisme. L'ouvrage s'achève par l'observation de la contagion déviante de l'émotion qui lui est propre (prophétisme des " déserts " cévenoles, épidémies de démonomanie chez les Ursulines, etc.). Chaque section est illustrée de documents psychologiques, mais aussi autobiographiques, historiques et sociologiques. L'auteur précise bien que son travail n'implique aucun réductionnisme lorsqu'il interprète par des facteurs affectifs (besoins, tendances, désirs, etc.) un sentiment aussi élevé que le religieux, ou que celui-ci perd de sa valeur une fois sa genèse connue.
Il pense même que la religion peut être, éventuellement, une " idée directrice ", facteur de synthèse de la personnalité. Toutefois, ses formes collectives peuvent aussi être désastreuses. Cent dix ans après sa première publication, ce livre garde toute son actualité, à lire un auteur suisse qui analyse le fanatisme, essentiellement, il est vrai, celui du protestantisme américain dans certaines sectes du revival, des mouvements dits évangéliques et autres Églises ultracalvinistes.
Les prêcheurs catholiques de croisades, les Pierre l'Hermite et l'intransigeant Saint-Bernard ne sont pas épargnés pour autant. Mais comment ne pas penser surtout à l'islamisme intégriste djihadiste contemporain, lorsqu'on lit : " Que la passion religieuse prenne une forme nationale ou une universelle, ses manifestations varient peu tant qu'une ligne de démarcation nette n'a pas été tracée et reconnue entre la cité de Dieu et la cité terrestre...
La suppression de l'hérétique est la conséquence naturelle, nécessaire, d'une religion qui prétend établir le règne absolu de Dieu sur terre. " ?
Poursuivant dans la perspective de Théodule Ribot l'étude des grandes fonctions mentales par leur pathologie qui les " décompose ", mais aussi " exagère " quelques-uns de leurs éléments constitutifs, Murisier explore ici, sans prétendre à l'exhaustivité, un sentiment supérieur : le sentiment religieux. Il aborde celui-ci sous sa forme individuelle par l'examen des multiples composantes présentes dans l'extase et le ravissement.
Ce sentiment est ensuite considéré sous sa forme sociale dans les manifestations du fanatisme. L'ouvrage s'achève par l'observation de la contagion déviante de l'émotion qui lui est propre (prophétisme des " déserts " cévenoles, épidémies de démonomanie chez les Ursulines, etc.). Chaque section est illustrée de documents psychologiques, mais aussi autobiographiques, historiques et sociologiques. L'auteur précise bien que son travail n'implique aucun réductionnisme lorsqu'il interprète par des facteurs affectifs (besoins, tendances, désirs, etc.) un sentiment aussi élevé que le religieux, ou que celui-ci perd de sa valeur une fois sa genèse connue.
Il pense même que la religion peut être, éventuellement, une " idée directrice ", facteur de synthèse de la personnalité. Toutefois, ses formes collectives peuvent aussi être désastreuses. Cent dix ans après sa première publication, ce livre garde toute son actualité, à lire un auteur suisse qui analyse le fanatisme, essentiellement, il est vrai, celui du protestantisme américain dans certaines sectes du revival, des mouvements dits évangéliques et autres Églises ultracalvinistes.
Les prêcheurs catholiques de croisades, les Pierre l'Hermite et l'intransigeant Saint-Bernard ne sont pas épargnés pour autant. Mais comment ne pas penser surtout à l'islamisme intégriste djihadiste contemporain, lorsqu'on lit : " Que la passion religieuse prenne une forme nationale ou une universelle, ses manifestations varient peu tant qu'une ligne de démarcation nette n'a pas été tracée et reconnue entre la cité de Dieu et la cité terrestre...
La suppression de l'hérétique est la conséquence naturelle, nécessaire, d'une religion qui prétend établir le règne absolu de Dieu sur terre. " ?
Ce sentiment est ensuite considéré sous sa forme sociale dans les manifestations du fanatisme. L'ouvrage s'achève par l'observation de la contagion déviante de l'émotion qui lui est propre (prophétisme des " déserts " cévenoles, épidémies de démonomanie chez les Ursulines, etc.). Chaque section est illustrée de documents psychologiques, mais aussi autobiographiques, historiques et sociologiques. L'auteur précise bien que son travail n'implique aucun réductionnisme lorsqu'il interprète par des facteurs affectifs (besoins, tendances, désirs, etc.) un sentiment aussi élevé que le religieux, ou que celui-ci perd de sa valeur une fois sa genèse connue.
Il pense même que la religion peut être, éventuellement, une " idée directrice ", facteur de synthèse de la personnalité. Toutefois, ses formes collectives peuvent aussi être désastreuses. Cent dix ans après sa première publication, ce livre garde toute son actualité, à lire un auteur suisse qui analyse le fanatisme, essentiellement, il est vrai, celui du protestantisme américain dans certaines sectes du revival, des mouvements dits évangéliques et autres Églises ultracalvinistes.
Les prêcheurs catholiques de croisades, les Pierre l'Hermite et l'intransigeant Saint-Bernard ne sont pas épargnés pour autant. Mais comment ne pas penser surtout à l'islamisme intégriste djihadiste contemporain, lorsqu'on lit : " Que la passion religieuse prenne une forme nationale ou une universelle, ses manifestations varient peu tant qu'une ligne de démarcation nette n'a pas été tracée et reconnue entre la cité de Dieu et la cité terrestre...
La suppression de l'hérétique est la conséquence naturelle, nécessaire, d'une religion qui prétend établir le règne absolu de Dieu sur terre. " ?