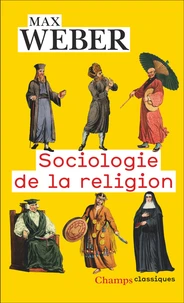Max Weber (1864-1920), économiste allemand, père de la sociologie contemporaine. Né dans une riche famille de la bourgeoise protestante allemande, M. Weber entame des études en Droit et accède au poste de professeur d'Histoire de droit romain et de droit commercial à Berlin (1893) puis à Fribourg (1894). Souffrant de dépression nerveuse, il visite l'Italie et le sud de la France, et c'est à la suite de ce voyage qu'il réoriente ses recherches vers la sociologie dont il fonde en 1909, avec G. Tönnies et G. Simmel, la Société allemande de sociologie. Les années 1915-1919 sont pour Weber une grande période d'activité intellectuelle avec la publication de ses travaux sur la sociologie comparative des religions mondiales. Il meurt peu après avoir obtenu la première chaire de sociologie à Munich. Mal connue en France, la pensée wébérienne s'appuie le processus de rationalisation de la modernité occidentale par de nombreux exemples historiques.
Philosophie N° 85, Printemps 200
Par : , , ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages94
- PrésentationBroché
- Poids0.13 kg
- Dimensions13,5 cm × 22,0 cm × 1,0 cm
- ISBN2-7073-1918-X
- EAN9782707319180
- Date de parution25/03/2005
- ÉditeurMinuit (Les Editions de)
Résumé
Ce numéro s'ouvre par la traduction, due à W. Feuerhahn, de la seconde partie du premier article méthodologique de Max Weber, "Roscher et Knies et les problèmes logiques de l'économie politique historique", intitulée " Knies et le problème de l'irrationalité". Weber y critique la conception qu'a Knies des limites de l'intelligibilité en économie politique - limites qui tiennent, selon ce dernier, à la relativité historique et nationale, ainsi qu'à
l'irrationalité des comportements humains libres, qu'il oppose au caractère nomologique des processus naturels.
Weber dénonce chez Knies une confusion entre déterminisme causal et caractère nomologique, causalité et légalité, et s'oppose à tout repli des concepts épistémologiques d'explication et de compréhension sur l'opposition ontologique entre nature et esprit. Dans "Max Weber et l'explication compréhensive", W. Feuerhahn clarifie les enjeux de cette critique weberienne de Knies. Partant de la controverse traditionnelle "expliquer/comprendre", qui fait figure de topos de l'épistémologie des sciences de l'homme, il s'attache à relativiser la présentation de l'explication et de la compréhension comme méthodes inconciliables rapportées à des domaines ontologiques hétérogènes, et montre comment Weber refuse tout ancrage ontologique de l'opposition entre sciences nomologiques et sciences de la réalité dans les régions nature et esprit, pour les déterminer par leurs visées épistémiques respectives, et fait place, au sein des sciences historiques de la culture, à la notion d'explication compréhensive qui concilie ces deux orientations. Dans "Le visage défiguré", J.
Vioulac entend dédouaner la pensée de Levinas de la double critique qui lui fut adressée : d'avoir été dupe de la morale, et d'avoir amorcé une tentative de dépassement de l'hégélianisme qui se serait soldée par un échec. Prenant le contre-pied du célèbre article " Violence et métaphysique " où Derrida affirmait que la relation à autrui thématisée par Levinas se réduisait à la dialectique intersubjective magistralement décrite par Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit, J.
Vioulac montre comment cette dialectique subordonne intégralement la description phénoménologique à la logique, en réduisant le rapport à autrui à un moment interne au syllogisme de la conscience de soi ; et comment la subordination de l'individu à l'universel dans la philosophie hégélienne de l'État confirme sans équivoque le non-apparaître d'autrui comme tel à la conscience, l'impossibilité du face-à-face entre consciences, et le régime de violence propre à la métaphysique.
Le numéro se clôt avec "La rationalité et la causalité dans le réalisme interne de Putnam", où M. Kistler part du constat de la mutation essentielle survenue à la fin des années soixante-dix dans la position philosophique de Putnam - laquelle passe de la thèse réaliste de la vérité en soi des énoncés scientifiques, indépendante de leur cognoscibilité subjective, à une position critique affirmant l'incohérence d'un tel "réalisme métaphysique".
L'enjeu essentiel de l'article de M. Kistler réside dans la démonstration que cette critique du réalisme conduit implicitement Putnam à un relativisme qui prive de sens la notion de vérité scientifique absolue, et repose en outre sur un argument dirigé contre la réalité des relations causales dont l'auteur met en évidence le caractère contestable. D.P.
Weber dénonce chez Knies une confusion entre déterminisme causal et caractère nomologique, causalité et légalité, et s'oppose à tout repli des concepts épistémologiques d'explication et de compréhension sur l'opposition ontologique entre nature et esprit. Dans "Max Weber et l'explication compréhensive", W. Feuerhahn clarifie les enjeux de cette critique weberienne de Knies. Partant de la controverse traditionnelle "expliquer/comprendre", qui fait figure de topos de l'épistémologie des sciences de l'homme, il s'attache à relativiser la présentation de l'explication et de la compréhension comme méthodes inconciliables rapportées à des domaines ontologiques hétérogènes, et montre comment Weber refuse tout ancrage ontologique de l'opposition entre sciences nomologiques et sciences de la réalité dans les régions nature et esprit, pour les déterminer par leurs visées épistémiques respectives, et fait place, au sein des sciences historiques de la culture, à la notion d'explication compréhensive qui concilie ces deux orientations. Dans "Le visage défiguré", J.
Vioulac entend dédouaner la pensée de Levinas de la double critique qui lui fut adressée : d'avoir été dupe de la morale, et d'avoir amorcé une tentative de dépassement de l'hégélianisme qui se serait soldée par un échec. Prenant le contre-pied du célèbre article " Violence et métaphysique " où Derrida affirmait que la relation à autrui thématisée par Levinas se réduisait à la dialectique intersubjective magistralement décrite par Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit, J.
Vioulac montre comment cette dialectique subordonne intégralement la description phénoménologique à la logique, en réduisant le rapport à autrui à un moment interne au syllogisme de la conscience de soi ; et comment la subordination de l'individu à l'universel dans la philosophie hégélienne de l'État confirme sans équivoque le non-apparaître d'autrui comme tel à la conscience, l'impossibilité du face-à-face entre consciences, et le régime de violence propre à la métaphysique.
Le numéro se clôt avec "La rationalité et la causalité dans le réalisme interne de Putnam", où M. Kistler part du constat de la mutation essentielle survenue à la fin des années soixante-dix dans la position philosophique de Putnam - laquelle passe de la thèse réaliste de la vérité en soi des énoncés scientifiques, indépendante de leur cognoscibilité subjective, à une position critique affirmant l'incohérence d'un tel "réalisme métaphysique".
L'enjeu essentiel de l'article de M. Kistler réside dans la démonstration que cette critique du réalisme conduit implicitement Putnam à un relativisme qui prive de sens la notion de vérité scientifique absolue, et repose en outre sur un argument dirigé contre la réalité des relations causales dont l'auteur met en évidence le caractère contestable. D.P.
Ce numéro s'ouvre par la traduction, due à W. Feuerhahn, de la seconde partie du premier article méthodologique de Max Weber, "Roscher et Knies et les problèmes logiques de l'économie politique historique", intitulée " Knies et le problème de l'irrationalité". Weber y critique la conception qu'a Knies des limites de l'intelligibilité en économie politique - limites qui tiennent, selon ce dernier, à la relativité historique et nationale, ainsi qu'à
l'irrationalité des comportements humains libres, qu'il oppose au caractère nomologique des processus naturels.
Weber dénonce chez Knies une confusion entre déterminisme causal et caractère nomologique, causalité et légalité, et s'oppose à tout repli des concepts épistémologiques d'explication et de compréhension sur l'opposition ontologique entre nature et esprit. Dans "Max Weber et l'explication compréhensive", W. Feuerhahn clarifie les enjeux de cette critique weberienne de Knies. Partant de la controverse traditionnelle "expliquer/comprendre", qui fait figure de topos de l'épistémologie des sciences de l'homme, il s'attache à relativiser la présentation de l'explication et de la compréhension comme méthodes inconciliables rapportées à des domaines ontologiques hétérogènes, et montre comment Weber refuse tout ancrage ontologique de l'opposition entre sciences nomologiques et sciences de la réalité dans les régions nature et esprit, pour les déterminer par leurs visées épistémiques respectives, et fait place, au sein des sciences historiques de la culture, à la notion d'explication compréhensive qui concilie ces deux orientations. Dans "Le visage défiguré", J.
Vioulac entend dédouaner la pensée de Levinas de la double critique qui lui fut adressée : d'avoir été dupe de la morale, et d'avoir amorcé une tentative de dépassement de l'hégélianisme qui se serait soldée par un échec. Prenant le contre-pied du célèbre article " Violence et métaphysique " où Derrida affirmait que la relation à autrui thématisée par Levinas se réduisait à la dialectique intersubjective magistralement décrite par Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit, J.
Vioulac montre comment cette dialectique subordonne intégralement la description phénoménologique à la logique, en réduisant le rapport à autrui à un moment interne au syllogisme de la conscience de soi ; et comment la subordination de l'individu à l'universel dans la philosophie hégélienne de l'État confirme sans équivoque le non-apparaître d'autrui comme tel à la conscience, l'impossibilité du face-à-face entre consciences, et le régime de violence propre à la métaphysique.
Le numéro se clôt avec "La rationalité et la causalité dans le réalisme interne de Putnam", où M. Kistler part du constat de la mutation essentielle survenue à la fin des années soixante-dix dans la position philosophique de Putnam - laquelle passe de la thèse réaliste de la vérité en soi des énoncés scientifiques, indépendante de leur cognoscibilité subjective, à une position critique affirmant l'incohérence d'un tel "réalisme métaphysique".
L'enjeu essentiel de l'article de M. Kistler réside dans la démonstration que cette critique du réalisme conduit implicitement Putnam à un relativisme qui prive de sens la notion de vérité scientifique absolue, et repose en outre sur un argument dirigé contre la réalité des relations causales dont l'auteur met en évidence le caractère contestable. D.P.
Weber dénonce chez Knies une confusion entre déterminisme causal et caractère nomologique, causalité et légalité, et s'oppose à tout repli des concepts épistémologiques d'explication et de compréhension sur l'opposition ontologique entre nature et esprit. Dans "Max Weber et l'explication compréhensive", W. Feuerhahn clarifie les enjeux de cette critique weberienne de Knies. Partant de la controverse traditionnelle "expliquer/comprendre", qui fait figure de topos de l'épistémologie des sciences de l'homme, il s'attache à relativiser la présentation de l'explication et de la compréhension comme méthodes inconciliables rapportées à des domaines ontologiques hétérogènes, et montre comment Weber refuse tout ancrage ontologique de l'opposition entre sciences nomologiques et sciences de la réalité dans les régions nature et esprit, pour les déterminer par leurs visées épistémiques respectives, et fait place, au sein des sciences historiques de la culture, à la notion d'explication compréhensive qui concilie ces deux orientations. Dans "Le visage défiguré", J.
Vioulac entend dédouaner la pensée de Levinas de la double critique qui lui fut adressée : d'avoir été dupe de la morale, et d'avoir amorcé une tentative de dépassement de l'hégélianisme qui se serait soldée par un échec. Prenant le contre-pied du célèbre article " Violence et métaphysique " où Derrida affirmait que la relation à autrui thématisée par Levinas se réduisait à la dialectique intersubjective magistralement décrite par Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit, J.
Vioulac montre comment cette dialectique subordonne intégralement la description phénoménologique à la logique, en réduisant le rapport à autrui à un moment interne au syllogisme de la conscience de soi ; et comment la subordination de l'individu à l'universel dans la philosophie hégélienne de l'État confirme sans équivoque le non-apparaître d'autrui comme tel à la conscience, l'impossibilité du face-à-face entre consciences, et le régime de violence propre à la métaphysique.
Le numéro se clôt avec "La rationalité et la causalité dans le réalisme interne de Putnam", où M. Kistler part du constat de la mutation essentielle survenue à la fin des années soixante-dix dans la position philosophique de Putnam - laquelle passe de la thèse réaliste de la vérité en soi des énoncés scientifiques, indépendante de leur cognoscibilité subjective, à une position critique affirmant l'incohérence d'un tel "réalisme métaphysique".
L'enjeu essentiel de l'article de M. Kistler réside dans la démonstration que cette critique du réalisme conduit implicitement Putnam à un relativisme qui prive de sens la notion de vérité scientifique absolue, et repose en outre sur un argument dirigé contre la réalité des relations causales dont l'auteur met en évidence le caractère contestable. D.P.