Retour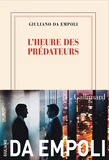
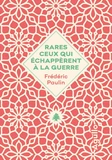

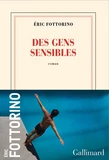
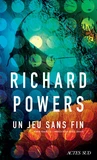

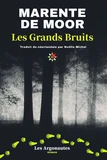
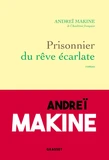
Les dernières notes et avis
Notes et avis 1 à 8 sur un total de 858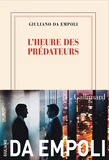
L'heure des prédateurs
Avis posté le 2025-05-18
Eclairant, fascinant et terrifiant
Après Les ingénieurs du chaos et Le Mage du Kremlin qui décryptaient, pour l’un, la stratégie d’affirmation par le chaos des nouveaux leaders populistes, pour l’autre, les ambitions de Poutine, l’ancien conseiller politique italo-suisse Giuliano da Empoli analyse les mécanismes à l’oeuvre dans le désordre mondial savamment entretenu par Trump.
Que se passe-t-il lorsque, ayant fait feu de tout bois – colère des insatisfaits et caisses de résonance numériques – pour déborder la démocratie libérale, l’un de ces stratèges du chaos parvient au pouvoir ? La réélection de Trump sonne l’heure d’une nouvelle ère, quand, d’outil de rébellion, la politique du chaos se fait institutionnelle, le gouvernant exerçant le pouvoir en multipliant les effets de sidération par l’imprévisibilité et l’usage incontrôlé de la force.
Ces nouveaux tyrans sont déjà un certain nombre à graviter dans ce que l’auteur identifie comme un nouveau cercle de prédateurs, parmi lesquels, entre Trump et Poutine, l’on peut citer Nayib Bukele au Salvador, Javier Milei en Argentine ou Mohammed ben Salmane en Arabie Saoudite. Tous ont en commun un comportement « borgien », de Borgia, le Prince qu’observa si cyniquement Machiavel. Au diable éthique et morale, seule compte la conservation du pouvoir.
Alors, à chaque époque les moyens : si les condottières du XVIe siècle profitèrent de l’invention de l’artillerie pour faire primer l’offensive dans un paroxysme de violence précipitant la fin des fortifications de type médiéval, les prédateurs de notre siècle se servent eux aussi de la rupture technologique pour avancer leurs pions. Le pouvoir passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et leurs algorithmes, dictateurs et milliardaires de la tech s’empressant d’allier leurs forces dans ce nouvel espace sans règles propice à l’exacerbation de la violence et du chaos.
Convaincu que, bien loin de nous trouver confrontés à quelques événements conjoncturels, nous vivons un vrai changement d’époque et qu’est en train de s’ouvrir « une ère de violence sans limites », d’autant plus dominée par le rapport de forces que l’attaque, cyber ou autre, est redevenue moins coûteuse que la défense, l’auteur nous voit face aux conquistadors de la tech comme les Aztèques face aux conquistadors espagnols. Alors que, comme eux, nous restons incapables de nous décider entre fascination et rejet, notre passivité frise l’inconscience du précipice vers lequel le monde fonce tête baissée.
Avec ses illustrations frappantes tirées de son expérience personnelle au sein des microcosmes politiques, l’élégance toute littéraire de sa plume et ses punchlines en salves, Giuliano da Empoli signe un nouvel ouvrage que l’on aurait aimé moins bref et un peu plus approfondi, mais, en tous les cas, d’une clarté et d’une lucidité saisissantes n’ouvrant guère la porte à l’optimisme. C’est d’un avenir glaçant dont il se fait ici l’oracle. Une lecture éclairante, aussi terrifiante que fascinante, qui ne peut laisser indifférent. Coup de coeur.
Après Les ingénieurs du chaos et Le Mage du Kremlin qui décryptaient, pour l’un, la stratégie d’affirmation par le chaos des nouveaux leaders populistes, pour l’autre, les ambitions de Poutine, l’ancien conseiller politique italo-suisse Giuliano da Empoli analyse les mécanismes à l’oeuvre dans le désordre mondial savamment entretenu par Trump.
Que se passe-t-il lorsque, ayant fait feu de tout bois – colère des insatisfaits et caisses de résonance numériques – pour déborder la démocratie libérale, l’un de ces stratèges du chaos parvient au pouvoir ? La réélection de Trump sonne l’heure d’une nouvelle ère, quand, d’outil de rébellion, la politique du chaos se fait institutionnelle, le gouvernant exerçant le pouvoir en multipliant les effets de sidération par l’imprévisibilité et l’usage incontrôlé de la force.
Ces nouveaux tyrans sont déjà un certain nombre à graviter dans ce que l’auteur identifie comme un nouveau cercle de prédateurs, parmi lesquels, entre Trump et Poutine, l’on peut citer Nayib Bukele au Salvador, Javier Milei en Argentine ou Mohammed ben Salmane en Arabie Saoudite. Tous ont en commun un comportement « borgien », de Borgia, le Prince qu’observa si cyniquement Machiavel. Au diable éthique et morale, seule compte la conservation du pouvoir.
Alors, à chaque époque les moyens : si les condottières du XVIe siècle profitèrent de l’invention de l’artillerie pour faire primer l’offensive dans un paroxysme de violence précipitant la fin des fortifications de type médiéval, les prédateurs de notre siècle se servent eux aussi de la rupture technologique pour avancer leurs pions. Le pouvoir passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et leurs algorithmes, dictateurs et milliardaires de la tech s’empressant d’allier leurs forces dans ce nouvel espace sans règles propice à l’exacerbation de la violence et du chaos.
Convaincu que, bien loin de nous trouver confrontés à quelques événements conjoncturels, nous vivons un vrai changement d’époque et qu’est en train de s’ouvrir « une ère de violence sans limites », d’autant plus dominée par le rapport de forces que l’attaque, cyber ou autre, est redevenue moins coûteuse que la défense, l’auteur nous voit face aux conquistadors de la tech comme les Aztèques face aux conquistadors espagnols. Alors que, comme eux, nous restons incapables de nous décider entre fascination et rejet, notre passivité frise l’inconscience du précipice vers lequel le monde fonce tête baissée.
Avec ses illustrations frappantes tirées de son expérience personnelle au sein des microcosmes politiques, l’élégance toute littéraire de sa plume et ses punchlines en salves, Giuliano da Empoli signe un nouvel ouvrage que l’on aurait aimé moins bref et un peu plus approfondi, mais, en tous les cas, d’une clarté et d’une lucidité saisissantes n’ouvrant guère la porte à l’optimisme. C’est d’un avenir glaçant dont il se fait ici l’oracle. Une lecture éclairante, aussi terrifiante que fascinante, qui ne peut laisser indifférent. Coup de coeur.
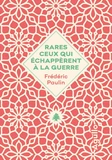
Rares ceux qui échappèrent à la guerre
Avis posté le 2025-05-16
Passionnant
Après le premier tome Nul ennemi comme un frère, Frédéric Paulin poursuit sa trilogie sur les quinze années de la guerre du Liban, de 1975 à 1990. Le récit reprend là où il s’était arrêté, en plein attentat du Drakkar le 23 octobre 1983, un immeuble de Beyrouth où stationnaient des militaires français. Le souffle de l’explosion passe ainsi directement de la dernière page du volume précédent à la première de celui-ci, dans une continuité narrative qu’il vaut mieux aborder depuis le début. En attendant le dernier tome annoncé pour l’été 2025, ce sont les années 1983 à 1986, jusqu’à cette fois l’attentat de la rue de Rennes à Paris, que l’auteur nous raconte avec toujours autant de souffle romanesque que de rigueur historique.
Mêlés aux protagonistes réels de l’époque, l’on retrouve donc les mêmes personnages fictifs qui, des désillusions du commandant Dixneuf de la DGSE au redoublement de violence du Libanais chiite Abdul Rasool al-Amine, en passant par les manoeuvres politiques du bientôt député RPR Michel Nada et de l’ex-diplomate Philippe Kellerman devenu proche conseiller du président Mitterrand, mais aussi par le désarroi du commissaire Caillaux et de sa femme juge anti-terroriste, permettent de croiser les points de vue sur ces années qui ont vu la guerre du Liban s’exporter sur le sol français.
Sans chapitre ni coupure, avec pour seules balises temporelles les faits historiques, le récit avance comme un fleuve en furie charriant les événements toujours plus violents qui, au Liban, en France, en Iran, ont pris une tournure d’une inextricable complexité. Pendant que la guerre transforme le Liban en champ de ruines, que les bombes d’Action Directe et des différents groupes islamistes installent un climat de terreur en France et que les otages tremblent pour leur vie entre les mains du Hezbollah, l’on découvre dans un étonnement consterné les dessous d’une diplomatie française minée par les rivalités et par les compromissions, les tractations concurrentes menées par les différents partis politiques à l’approche des élections présidentielles achevant d’ajouter à la confusion.
Les scènes courtes s’enchaînent sans discontinuer, sautant d’un lieu à l’autre dans une tension d’autant plus captivante que d’une crédibilité sans faille, l’auteur fondant son irréprochable rigueur d’écriture sur une documentation aussi impressionnante par sa minutie que par le naturel de sa restitution. Sans commentaire ni parti pris, le livre démonte les mécanismes et les enjeux politiques de la violence pour un tableau édifiant, souvent effarant, et toujours passionnant. Une vraie performance que cette lecture limpide et agréable du fatras au Proche-Orient. Vivement le dernier tome de la trilogie ! Coup de coeur.
Après le premier tome Nul ennemi comme un frère, Frédéric Paulin poursuit sa trilogie sur les quinze années de la guerre du Liban, de 1975 à 1990. Le récit reprend là où il s’était arrêté, en plein attentat du Drakkar le 23 octobre 1983, un immeuble de Beyrouth où stationnaient des militaires français. Le souffle de l’explosion passe ainsi directement de la dernière page du volume précédent à la première de celui-ci, dans une continuité narrative qu’il vaut mieux aborder depuis le début. En attendant le dernier tome annoncé pour l’été 2025, ce sont les années 1983 à 1986, jusqu’à cette fois l’attentat de la rue de Rennes à Paris, que l’auteur nous raconte avec toujours autant de souffle romanesque que de rigueur historique.
Mêlés aux protagonistes réels de l’époque, l’on retrouve donc les mêmes personnages fictifs qui, des désillusions du commandant Dixneuf de la DGSE au redoublement de violence du Libanais chiite Abdul Rasool al-Amine, en passant par les manoeuvres politiques du bientôt député RPR Michel Nada et de l’ex-diplomate Philippe Kellerman devenu proche conseiller du président Mitterrand, mais aussi par le désarroi du commissaire Caillaux et de sa femme juge anti-terroriste, permettent de croiser les points de vue sur ces années qui ont vu la guerre du Liban s’exporter sur le sol français.
Sans chapitre ni coupure, avec pour seules balises temporelles les faits historiques, le récit avance comme un fleuve en furie charriant les événements toujours plus violents qui, au Liban, en France, en Iran, ont pris une tournure d’une inextricable complexité. Pendant que la guerre transforme le Liban en champ de ruines, que les bombes d’Action Directe et des différents groupes islamistes installent un climat de terreur en France et que les otages tremblent pour leur vie entre les mains du Hezbollah, l’on découvre dans un étonnement consterné les dessous d’une diplomatie française minée par les rivalités et par les compromissions, les tractations concurrentes menées par les différents partis politiques à l’approche des élections présidentielles achevant d’ajouter à la confusion.
Les scènes courtes s’enchaînent sans discontinuer, sautant d’un lieu à l’autre dans une tension d’autant plus captivante que d’une crédibilité sans faille, l’auteur fondant son irréprochable rigueur d’écriture sur une documentation aussi impressionnante par sa minutie que par le naturel de sa restitution. Sans commentaire ni parti pris, le livre démonte les mécanismes et les enjeux politiques de la violence pour un tableau édifiant, souvent effarant, et toujours passionnant. Une vraie performance que cette lecture limpide et agréable du fatras au Proche-Orient. Vivement le dernier tome de la trilogie ! Coup de coeur.

Terrasses. Ou notre long baiser si longtemps retardé
Avis posté le 2025-05-14
Retenue et justesse de ton
Cela fait presque dix ans qu’ont eu lieu à Paris les attentats du 13 novembre 2015. Dans un roman choral par ailleurs mis en scène au théâtre, Laurent Gaudé nous donne à entendre les voix des victimes et des secouristes, un choeur poignant dont la délicate litanie fait ressortir le motif lumineux de l’amour, de l’empathie et de la solidarité sur le noir absolu de la violence aveugle et de la peur.
L’exercice était délicat et l’écrivain le réussit avec brio. Tandis que, donnant la parole aussi bien aux morts qu’aux vivants, le « je » et le « nous » du récit immergent le lecteur au plus près de ce qu’ont vécu les victimes et ceux qui leur ont porté secours – ici une amoureuse qui court vers un premier baiser, là deux jumelles impatientes de se retrouver à Paris pour leur anniversaire, là encore un couple qui se sépare sur une dispute, et bientôt les policiers de la BAC de nuit, une infirmière rappelée d’urgence après la fin de sa journée, les forces d’intervention de la BRI montant à l’assaut du Bataclan… –, se superposent peu à peu, jusqu’à former une petite foule évoquant un choeur antique, les silhouettes fictives mais représentatives, vives et précises, de ces hommes et de ces femmes à qui le hasard a donné rendez-vous ce soir-là avec l’horreur et l’irrémédiable arbitraire du destin.
Chacune y va de son monologue sobrement factuel, évoquant simplement et sans pathos la vie fauchée en plein geste ou à jamais transformée par la perte et la confrontation à l’impensable barbarie. Pas de haine ni même de colère, juste la sidération suivie de la douleur et, face à l’implacable atrocité tombée au hasard au beau milieu de vies banales qui auraient pu tout aussi bien être la nôtre ou celle de proches, la dignité de gens s’efforçant comme ils peuvent de faire face à une tragédie collective nous dépassant tous.
Poignant dans son incommensurable tristesse, souvent insoutenable malgré la pudeur presque clinique de ces voix comme désincarnées surgies de l’obscurité des enfers et sondant sans répit la question sans réponse du hasard et de l’arbitraire – « “Toi, oui. L’autre, pas.” À une seconde près, un centimètre près. Avoir de la chance ou pas. » –, le texte laisse la vie et l’envie de vivre diffuser une lumière têtue, celle de l’humanité et de la liberté, qui réussit en dépit de tout à imposer l’espoir face à l’obscurantisme aveugle.
Un texte bref, intense et bouleversant, qui a su trouver la retenue et la justesse de ton pour aborder avec autant d’empathie que de respect les blessures individuelles et collectives qui démarqueront toujours l’après de l’avant, mais qui, jamais, n’empêcheront la vie de triompher sur les courtes vues du fanatisme. « Nous avons appris qu’on pouvait mourir de marcher dans la rue, de s’attarder autour d’un verre avec des amis. Et pourtant, il faut continuer. Vivre. Comme on aime. Au nom de ceux qui sont tombés. Nous serons tristes, longtemps, mais pas terrifiés. Pas terrassés. »
Cela fait presque dix ans qu’ont eu lieu à Paris les attentats du 13 novembre 2015. Dans un roman choral par ailleurs mis en scène au théâtre, Laurent Gaudé nous donne à entendre les voix des victimes et des secouristes, un choeur poignant dont la délicate litanie fait ressortir le motif lumineux de l’amour, de l’empathie et de la solidarité sur le noir absolu de la violence aveugle et de la peur.
L’exercice était délicat et l’écrivain le réussit avec brio. Tandis que, donnant la parole aussi bien aux morts qu’aux vivants, le « je » et le « nous » du récit immergent le lecteur au plus près de ce qu’ont vécu les victimes et ceux qui leur ont porté secours – ici une amoureuse qui court vers un premier baiser, là deux jumelles impatientes de se retrouver à Paris pour leur anniversaire, là encore un couple qui se sépare sur une dispute, et bientôt les policiers de la BAC de nuit, une infirmière rappelée d’urgence après la fin de sa journée, les forces d’intervention de la BRI montant à l’assaut du Bataclan… –, se superposent peu à peu, jusqu’à former une petite foule évoquant un choeur antique, les silhouettes fictives mais représentatives, vives et précises, de ces hommes et de ces femmes à qui le hasard a donné rendez-vous ce soir-là avec l’horreur et l’irrémédiable arbitraire du destin.
Chacune y va de son monologue sobrement factuel, évoquant simplement et sans pathos la vie fauchée en plein geste ou à jamais transformée par la perte et la confrontation à l’impensable barbarie. Pas de haine ni même de colère, juste la sidération suivie de la douleur et, face à l’implacable atrocité tombée au hasard au beau milieu de vies banales qui auraient pu tout aussi bien être la nôtre ou celle de proches, la dignité de gens s’efforçant comme ils peuvent de faire face à une tragédie collective nous dépassant tous.
Poignant dans son incommensurable tristesse, souvent insoutenable malgré la pudeur presque clinique de ces voix comme désincarnées surgies de l’obscurité des enfers et sondant sans répit la question sans réponse du hasard et de l’arbitraire – « “Toi, oui. L’autre, pas.” À une seconde près, un centimètre près. Avoir de la chance ou pas. » –, le texte laisse la vie et l’envie de vivre diffuser une lumière têtue, celle de l’humanité et de la liberté, qui réussit en dépit de tout à imposer l’espoir face à l’obscurantisme aveugle.
Un texte bref, intense et bouleversant, qui a su trouver la retenue et la justesse de ton pour aborder avec autant d’empathie que de respect les blessures individuelles et collectives qui démarqueront toujours l’après de l’avant, mais qui, jamais, n’empêcheront la vie de triompher sur les courtes vues du fanatisme. « Nous avons appris qu’on pouvait mourir de marcher dans la rue, de s’attarder autour d’un verre avec des amis. Et pourtant, il faut continuer. Vivre. Comme on aime. Au nom de ceux qui sont tombés. Nous serons tristes, longtemps, mais pas terrifiés. Pas terrassés. »
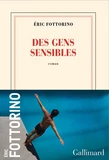
Des gens sensibles
Avis posté le 2025-05-12
Autofiction fine et pudique
Dans une fiction d’inspiration largement autobiographique, Eric Fottorino fait revivre ses fantômes d’une façon toute modianesque, pour un hommage à fleur de peau à la littérature et à la liberté d’expression au travers d’une très passionnée attachée de presse éditoriale et d’un écrivain algérien devenu la cible des fanatiques religieux dénoncés dans ses livres.
Le jeune narrateur Jean Foscolani, dit Fosco presque comme Fotto, est aux anges de voir son premier livre publié par les éditions du Losange. Il est emporté dans le tourbillon festif et mondain de Clara, l’attaché de presse déterminée à en faire la coqueluche de la rentrée littéraire. Cette femme solaire et insomniaque qui semble ne se nourrir que de la fumée de ses cigarettes, de champagne et de littérature, mène sa vie tambour battant, noyant de vieilles blessures dans sa passion pour les livres et leurs auteurs. Une relation amoureuse agitée la lie à Saïd, un écrivain algérien contraint à l’exil sous protection policière, que la violence et la peur font sombrer toujours plus profond dans l’alcool et le désespoir.
Avec la tendresse grave et nostalgique du témoin qui se retourne quelque trente ans plus tard sur ce qui fut son épiphanie d’écrivain, mais aussi une tragédie vécue dans une impuissance déférente et triste puisque Clara et Saïd – dans la vie réelle Chantal Lapicque, attachée de presse chez Stock, et Rachid Mimouni, écrivain censuré en Algérie et traqué par les islamistes – ne devaient pas tenir très longtemps à ce rythme, Fosco raconte sa fascination pour ce duo de fortes et brillantes personnalités qui, inventant contre leurs douleurs un espace littéraire et intellectuel comme échappé des contingences du monde, lui ont ouvert les portes du microcosme littéraire parisien en même temps que d’une carrière pleine de reconnaissance.
Et puis Fosco, comme Fotto, doit lui aussi composer avec ses propres souffrances et sa quête identitaire, sa mère refusant de lui délivrer sur son père plus que la seule information de son origine nord-africaine, comme Saïd. Avec la pudeur et la délicatesse des « gens sensibles », l’on pourrait même dire ici écorchés vifs, l’auteur raconte le pouvoir de l’écriture et la littérature comme espace de liberté, de découverte de soi et d’orpaillage de la vraie vie. Et, puisqu’ « on écrit pour pouvoir se taire », lui sait qu’en devenant écrivain, il a « choisi [s]a naissance. » Il est devenu « l’enfant de [s]es livres », qui ne « racont[e] pas [s]a vie », mais « l’invent[e] en l’écrivant. »
Autofiction fine et pudique, ce roman est le récit touchant d’une naissance à l’écriture et, à travers elle, d’une naissance à la vie, doublé d’un formidable hommage à celle qui, vouant son existence à ses auteurs, en a été l’accoucheuse. La littérature se fait ici espace vital, au sens propre comme au figuré. Salvatrice pour Fosco-Fotto et ses interrogations identitaires, elle était pour Saïd et Rachid Mimouni, comme elle l’est encore aujourd’hui pour tant d’auteurs persécutés, Boualem Sansal ou Kamel Daoud pour l’Algérie, mais aussi Ahmet Altan en Turquie par exemple, l’ultime refuge d’une liberté bafouée.
Dans une fiction d’inspiration largement autobiographique, Eric Fottorino fait revivre ses fantômes d’une façon toute modianesque, pour un hommage à fleur de peau à la littérature et à la liberté d’expression au travers d’une très passionnée attachée de presse éditoriale et d’un écrivain algérien devenu la cible des fanatiques religieux dénoncés dans ses livres.
Le jeune narrateur Jean Foscolani, dit Fosco presque comme Fotto, est aux anges de voir son premier livre publié par les éditions du Losange. Il est emporté dans le tourbillon festif et mondain de Clara, l’attaché de presse déterminée à en faire la coqueluche de la rentrée littéraire. Cette femme solaire et insomniaque qui semble ne se nourrir que de la fumée de ses cigarettes, de champagne et de littérature, mène sa vie tambour battant, noyant de vieilles blessures dans sa passion pour les livres et leurs auteurs. Une relation amoureuse agitée la lie à Saïd, un écrivain algérien contraint à l’exil sous protection policière, que la violence et la peur font sombrer toujours plus profond dans l’alcool et le désespoir.
Avec la tendresse grave et nostalgique du témoin qui se retourne quelque trente ans plus tard sur ce qui fut son épiphanie d’écrivain, mais aussi une tragédie vécue dans une impuissance déférente et triste puisque Clara et Saïd – dans la vie réelle Chantal Lapicque, attachée de presse chez Stock, et Rachid Mimouni, écrivain censuré en Algérie et traqué par les islamistes – ne devaient pas tenir très longtemps à ce rythme, Fosco raconte sa fascination pour ce duo de fortes et brillantes personnalités qui, inventant contre leurs douleurs un espace littéraire et intellectuel comme échappé des contingences du monde, lui ont ouvert les portes du microcosme littéraire parisien en même temps que d’une carrière pleine de reconnaissance.
Et puis Fosco, comme Fotto, doit lui aussi composer avec ses propres souffrances et sa quête identitaire, sa mère refusant de lui délivrer sur son père plus que la seule information de son origine nord-africaine, comme Saïd. Avec la pudeur et la délicatesse des « gens sensibles », l’on pourrait même dire ici écorchés vifs, l’auteur raconte le pouvoir de l’écriture et la littérature comme espace de liberté, de découverte de soi et d’orpaillage de la vraie vie. Et, puisqu’ « on écrit pour pouvoir se taire », lui sait qu’en devenant écrivain, il a « choisi [s]a naissance. » Il est devenu « l’enfant de [s]es livres », qui ne « racont[e] pas [s]a vie », mais « l’invent[e] en l’écrivant. »
Autofiction fine et pudique, ce roman est le récit touchant d’une naissance à l’écriture et, à travers elle, d’une naissance à la vie, doublé d’un formidable hommage à celle qui, vouant son existence à ses auteurs, en a été l’accoucheuse. La littérature se fait ici espace vital, au sens propre comme au figuré. Salvatrice pour Fosco-Fotto et ses interrogations identitaires, elle était pour Saïd et Rachid Mimouni, comme elle l’est encore aujourd’hui pour tant d’auteurs persécutés, Boualem Sansal ou Kamel Daoud pour l’Algérie, mais aussi Ahmet Altan en Turquie par exemple, l’ultime refuge d’une liberté bafouée.
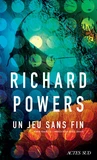
Un jeu sans fin
Avis posté le 2025-05-10
" Chaque île est une pirogue, et la Terre entière est une île "
Grande voix multi-récompensée de la littérature américaine contemporaine, Richard Powers aime à s’interroger sur les effets de la science sur le vivant. Son quatorzième roman explore l’inventivité de la nature et celle de l’homme dans ce qui fait figure d’un jeu sans fin. Car, malgré les apparences, entre extinction des espèces d’un côté et développement possiblement menaçant des intelligences artificielles de l’autre, la partie n’est pas forcément jouée…
Ile minuscule des Tuamotu en Polynésie française, Makatea se retrouve plus que jamais au coeur de choix cornéliens. Après un demi-siècle d’exploitation à outrance par la France de ses gisements de phosphate, ce bout de terre retombé dans une tranquillité paradisiaque mais impécunieuse est l’objet d’un projet américain de « seasteading », autrement dit d’implantation de villes flottantes échappant à la souveraineté des Etats. L’investisseur est un magnat de la Silicon Valley, Todd Keane, qui, après avoir fait fortune à la tête d’un réseau social, est devenu un pionnier de l’Intelligence Artificielle.
Pendant que les habitants de Makatea débattent de leur avenir, l’homme parmi les plus riches du monde a d’autant plus à coeur de faire aboutir ce projet qu’atteint d’une démence précoce et sachant ses jours comptés, il entend par là renouer avec une amitié perdue. C’est le récit de sa vie, entrepris pour nourrir l’IA censée, un jour peut-être, faire revivre les morts, qui nous fait découvrir le passé, depuis ses liens, quarante ans plus tôt, avec Rafi, un étudiant afro-américain qui partageait sa passion pour le jeu de go - « cette petite allégorie de la création cosmique » tant les coups y sont imprévisibles - et qui, avant de faire le choix de la littérature et de la poésie, avait eu le temps de lui souffler toutes les bonnes idées qui devaient faire sa fortune.
Plus jeune encore, Todd s’était passionné pour l’océan et celle qui devait en devenir l’égérie : Evelyne Beaulieu, pionnière québécoise de l’océanographie, justement installée aujourd’hui à Makatea et témoin privilégiée de la désertification progressive des espaces sous-marins. Tandis que Todd, fou de technologie, raconte ses divergences croissantes avec Rafi, épris de philosophie, un autre fil narratif déroule une troisième obsession, celle d’Evie qui doit tout sacrifier pour s’imposer dans un monde d’hommes et exercer son métier. Son regard est l’occasion pour le lecteur d’une découverte riche en surprises émerveillées, et bientôt consternées, face à l’incroyable créativité marine de la nature et aux terribles impacts de l’activité humaine.
Ainsi, au travers de l’ambitieuse et passionnante imbrication de tous ses récits pleins de rebondissements et de véritables curiosités naturelles et scientifiques, se développe de la manière la plus crédible qui soit un conte allégorique, un chant puissant et mélancolique sur les beautés d’un monde en cours de disparition. Au lieu de se rejoindre, les lignes de force du récit se repoussent de plus en plus en une tragique incompatibilité semblant déboucher sur la mort. A moins que, dans ce jeu sans fin, ne se produise quelque retournement, en tous les cas, de nouveaux rebondissements, l’ingéniosité de la nature n’ayant pas dit son dernier mot, avec ou sans hommes.
« Chaque île est une pirogue, et la Terre entière est une île, qui vit par la grâce de la créature bleue, immense et lentement tournoyante. » Un livre de grande tenue, capable de brasser autour de personnages toujours crédibles la pleine puissance des thématiques scientifiques, écologiques et technologiques contemporaines pour nous interroger sur le sens de la vie. Avons-nous seulement encore une place dans ce monde aux incroyables beautés ? Coup de coeur.
Grande voix multi-récompensée de la littérature américaine contemporaine, Richard Powers aime à s’interroger sur les effets de la science sur le vivant. Son quatorzième roman explore l’inventivité de la nature et celle de l’homme dans ce qui fait figure d’un jeu sans fin. Car, malgré les apparences, entre extinction des espèces d’un côté et développement possiblement menaçant des intelligences artificielles de l’autre, la partie n’est pas forcément jouée…
Ile minuscule des Tuamotu en Polynésie française, Makatea se retrouve plus que jamais au coeur de choix cornéliens. Après un demi-siècle d’exploitation à outrance par la France de ses gisements de phosphate, ce bout de terre retombé dans une tranquillité paradisiaque mais impécunieuse est l’objet d’un projet américain de « seasteading », autrement dit d’implantation de villes flottantes échappant à la souveraineté des Etats. L’investisseur est un magnat de la Silicon Valley, Todd Keane, qui, après avoir fait fortune à la tête d’un réseau social, est devenu un pionnier de l’Intelligence Artificielle.
Pendant que les habitants de Makatea débattent de leur avenir, l’homme parmi les plus riches du monde a d’autant plus à coeur de faire aboutir ce projet qu’atteint d’une démence précoce et sachant ses jours comptés, il entend par là renouer avec une amitié perdue. C’est le récit de sa vie, entrepris pour nourrir l’IA censée, un jour peut-être, faire revivre les morts, qui nous fait découvrir le passé, depuis ses liens, quarante ans plus tôt, avec Rafi, un étudiant afro-américain qui partageait sa passion pour le jeu de go - « cette petite allégorie de la création cosmique » tant les coups y sont imprévisibles - et qui, avant de faire le choix de la littérature et de la poésie, avait eu le temps de lui souffler toutes les bonnes idées qui devaient faire sa fortune.
Plus jeune encore, Todd s’était passionné pour l’océan et celle qui devait en devenir l’égérie : Evelyne Beaulieu, pionnière québécoise de l’océanographie, justement installée aujourd’hui à Makatea et témoin privilégiée de la désertification progressive des espaces sous-marins. Tandis que Todd, fou de technologie, raconte ses divergences croissantes avec Rafi, épris de philosophie, un autre fil narratif déroule une troisième obsession, celle d’Evie qui doit tout sacrifier pour s’imposer dans un monde d’hommes et exercer son métier. Son regard est l’occasion pour le lecteur d’une découverte riche en surprises émerveillées, et bientôt consternées, face à l’incroyable créativité marine de la nature et aux terribles impacts de l’activité humaine.
Ainsi, au travers de l’ambitieuse et passionnante imbrication de tous ses récits pleins de rebondissements et de véritables curiosités naturelles et scientifiques, se développe de la manière la plus crédible qui soit un conte allégorique, un chant puissant et mélancolique sur les beautés d’un monde en cours de disparition. Au lieu de se rejoindre, les lignes de force du récit se repoussent de plus en plus en une tragique incompatibilité semblant déboucher sur la mort. A moins que, dans ce jeu sans fin, ne se produise quelque retournement, en tous les cas, de nouveaux rebondissements, l’ingéniosité de la nature n’ayant pas dit son dernier mot, avec ou sans hommes.
« Chaque île est une pirogue, et la Terre entière est une île, qui vit par la grâce de la créature bleue, immense et lentement tournoyante. » Un livre de grande tenue, capable de brasser autour de personnages toujours crédibles la pleine puissance des thématiques scientifiques, écologiques et technologiques contemporaines pour nous interroger sur le sens de la vie. Avons-nous seulement encore une place dans ce monde aux incroyables beautés ? Coup de coeur.

Un degré de séparation
Avis posté le 2025-05-08
D’une grande finesse psychologique
Comble de l’ironie pour lui qui enseigne l’écriture créative à l’université, le célèbre écrivain américain Frédéric Altman, aussi prolifique qu’il ait pu être jusqu’ici, ne parvient plus à écrire. En plein doute et au bord de l’effondrement, le voilà de surcroît laissé à ses désormais insolubles interrogations lorsque sa mère s’éteint en EHPAD et emporte avec elle le secret de sa naissance.
Instable et sujette aux addictions, cette femme trop dévorée par ses propres manques affectifs pour assumer un enfant, qui plus est sans père, l’avait très vite oublié dans son pensionnat pour se consacrer corps et âme à son métier de critique littéraire, façon comme une autre de combler un vide émotionnel creusé par la peur de souffrir. « La culture et les idées, plutôt que les doutes et la tendresse. À prendre ou à laisser. » C’est ainsi qu’avec la littérature pour seule monnaie d’échange avec sa mère, le narrateur avait fini par devenir écrivain, colmatant à son tour les carences et les non-dits par l’invention d’histoires inspirées de la sienne. De quelles souffrances sa mère se protégeait-elle donc ? Surtout, qui était cet homme, dont elle s’obstinait à fuir le souvenir jusqu’à priver son fils ne serait-ce que du plus petit indice identitaire ?
Mais une petite photographie, retrouvée dans les maigres affaires de la morte, vient peut-être ouvrir la piste de la dernière chance. Jeune et pour une fois souriante, sa mère s’y tient radieuse aux côtés d’un inconnu. Intrigué, Frédéric Altman entame une longue quête qui, en même temps qu’il se souvient et essaie de reconstituer le parcours maternel, l’emmène, depuis les archives de l’université Columbia, à New York, sur les traces de l’étudiant de la photo, un Français devenu à Paris un scientifique de renommée internationale.
Alors qu’en incessants allers retours entre hier et aujourd’hui, l’on observe le narrateur se débattre avec les béances d’une filiation en passe d’engloutir ce qu’il pensait pourtant être devenu, l’introspection se fait quête de sens et recherche d’une issue. Il faut d’abord accepter les contours de l’impasse pour ne pas s’y laisser enfermer, isolé des autres par l’expérience du manque et de la perte, puis trouver la nouvelle voie menant à la résilience et à la façon de tenir debout au-dessus de l’abîme. Dans son désarroi, le personnage apprend à faire avec les parois auxquelles il se cogne – ce degré de séparation qui est propre à chacun de nous et sur lequel nous bâtissons notre rapport au monde et à autrui. Alors peut-être pourra-t-il trouver dans l’écriture cette planche de salut qu’à sa manière, sa mère avait désespérément cherchée dans le métier de critique littéraire.
D’une grande finesse psychologique, ce premier roman très maîtrisé explore fort joliment la perte, la quête de soi et les ressorts de la création artistique dans un récit aussi poignant qu’addictif.
Comble de l’ironie pour lui qui enseigne l’écriture créative à l’université, le célèbre écrivain américain Frédéric Altman, aussi prolifique qu’il ait pu être jusqu’ici, ne parvient plus à écrire. En plein doute et au bord de l’effondrement, le voilà de surcroît laissé à ses désormais insolubles interrogations lorsque sa mère s’éteint en EHPAD et emporte avec elle le secret de sa naissance.
Instable et sujette aux addictions, cette femme trop dévorée par ses propres manques affectifs pour assumer un enfant, qui plus est sans père, l’avait très vite oublié dans son pensionnat pour se consacrer corps et âme à son métier de critique littéraire, façon comme une autre de combler un vide émotionnel creusé par la peur de souffrir. « La culture et les idées, plutôt que les doutes et la tendresse. À prendre ou à laisser. » C’est ainsi qu’avec la littérature pour seule monnaie d’échange avec sa mère, le narrateur avait fini par devenir écrivain, colmatant à son tour les carences et les non-dits par l’invention d’histoires inspirées de la sienne. De quelles souffrances sa mère se protégeait-elle donc ? Surtout, qui était cet homme, dont elle s’obstinait à fuir le souvenir jusqu’à priver son fils ne serait-ce que du plus petit indice identitaire ?
Mais une petite photographie, retrouvée dans les maigres affaires de la morte, vient peut-être ouvrir la piste de la dernière chance. Jeune et pour une fois souriante, sa mère s’y tient radieuse aux côtés d’un inconnu. Intrigué, Frédéric Altman entame une longue quête qui, en même temps qu’il se souvient et essaie de reconstituer le parcours maternel, l’emmène, depuis les archives de l’université Columbia, à New York, sur les traces de l’étudiant de la photo, un Français devenu à Paris un scientifique de renommée internationale.
Alors qu’en incessants allers retours entre hier et aujourd’hui, l’on observe le narrateur se débattre avec les béances d’une filiation en passe d’engloutir ce qu’il pensait pourtant être devenu, l’introspection se fait quête de sens et recherche d’une issue. Il faut d’abord accepter les contours de l’impasse pour ne pas s’y laisser enfermer, isolé des autres par l’expérience du manque et de la perte, puis trouver la nouvelle voie menant à la résilience et à la façon de tenir debout au-dessus de l’abîme. Dans son désarroi, le personnage apprend à faire avec les parois auxquelles il se cogne – ce degré de séparation qui est propre à chacun de nous et sur lequel nous bâtissons notre rapport au monde et à autrui. Alors peut-être pourra-t-il trouver dans l’écriture cette planche de salut qu’à sa manière, sa mère avait désespérément cherchée dans le métier de critique littéraire.
D’une grande finesse psychologique, ce premier roman très maîtrisé explore fort joliment la perte, la quête de soi et les ressorts de la création artistique dans un récit aussi poignant qu’addictif.
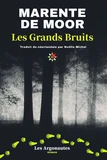
Les Grands Bruits
Avis posté le 2025-05-06
Crépusculaire jusqu'à l'étrange
De cette Russie qu’elle connaît bien pour y avoir vécu de 1991 à 2001, la romancière néerlandaise Marente De Moor tire une histoire crépusculaire aux frontières de l’étrange, tant ses personnages aux confins d’un monde en déliquescence peinent à rester ancrés dans une réalité qui leur échappe.
Il y a trois décennies de cela, Nadia, jeune étudiante, tombait amoureuse de son professeur de zoologie à Leningrad, de vingt ans son aîné. Enceinte, elle abandonnait ses études pour le suivre au milieu des forêts de l’ouest russe et y ouvrir avec lui une station biologique. Pour se financer, le couple accueillait des touristes étrangers, attirés par les oursons orphelins qu’il prenait en charge.
Alors, que s’est-il passé pour que de ces projets de vie ne reste aujourd’hui qu’un champ de ruines ? Abandonné, le laboratoire à demi écroulé n’est plus occupé que par les chauves-souris et la végétation qui l’ont envahi. Le village dont Nadia et Lev sont les derniers habitants n’a plus d’existence pour les autorités. Pillées par les maraudeurs, pressurées par la forêt, ses datchas en bois autrefois construites artisanalement sont devenues le royaume des esprits frappeurs. D’ailleurs, de grands bruits inexplicables terrifient Lev dont la tête commence aussi à partir en friche. Sa mémoire à lui s’effaçant, Nadia s’efforce de se souvenir pour deux, tout au moins dans les moments qui échappent à son dur labeur quotidien, entre leurs bêtes, le potager et les mille tracas quotidiens d’une existence en autarcie, loin de tout.
Mais, si Lev a pris de l’avance sur elle dans la décrépitude, Nadia n’est pas forcément mieux armée pour affronter la réalité. Si sa mémoire à elle lui joue des tours, c’est qu’enfoui sous les non-dits, un vieux drame n’en continue pas moins d’empoisonner l’esprit de cette femme vieillissante. Un événement a bloqué le temps pour ce couple, le laissant à jamais suspendu hors du monde. Lev et Nadia sont devenus deux pierres dans le courant d’une rivière. Le pays tout entier a changé, induisant pour cette zone rurale une irréductible déshérence. Eux sont restés figés, à observer peu à peu la déliquescence de la Russie recouvrir en un parfait mimétisme le désastre de leur propre vie. Une vieille connaissance indésirable a annoncé sa visite. Il va leur falloir affronter leurs fantômes…
Fine psychologue et peintre d’atmosphère, Marente De Moor superpose habilement les désillusions d’un couple au destin brisé à l‘agonie du monde soviétique dans les années 1990. Maintenus en vie par la nécessité de faire face aux exigences du quotidien – se nourrir et se chauffer monopolisent toute leur énergie –, Nadia et Lev n’ont pas le temps de s’appesantir sur leurs états d’âme ni de comprendre ce qui se passe autour d’eux. Il leur faut juste tenir dans un univers qui s’écroule, la fin de leurs rêves coïncidant étrangement avec celle du monde autour d’eux. Tant la structure du récit que la langue employée, entre gestes rassurants du quotidien et ambiance énigmatique et menaçante, contribuent à la douloureuse poésie du récit, marqué par la dépossession, l’inquiétude et l’étrangeté.
Comment vivre quand tout s’est écroulé ? Entre survie matérielle, rêves refuges et folles hallucinations, Marente de Moor excelle à décrire un déroutant et touchant déséquilibre, un pied dans la réalité, l’autre dans un imaginaire étrange et presque fantastique.
De cette Russie qu’elle connaît bien pour y avoir vécu de 1991 à 2001, la romancière néerlandaise Marente De Moor tire une histoire crépusculaire aux frontières de l’étrange, tant ses personnages aux confins d’un monde en déliquescence peinent à rester ancrés dans une réalité qui leur échappe.
Il y a trois décennies de cela, Nadia, jeune étudiante, tombait amoureuse de son professeur de zoologie à Leningrad, de vingt ans son aîné. Enceinte, elle abandonnait ses études pour le suivre au milieu des forêts de l’ouest russe et y ouvrir avec lui une station biologique. Pour se financer, le couple accueillait des touristes étrangers, attirés par les oursons orphelins qu’il prenait en charge.
Alors, que s’est-il passé pour que de ces projets de vie ne reste aujourd’hui qu’un champ de ruines ? Abandonné, le laboratoire à demi écroulé n’est plus occupé que par les chauves-souris et la végétation qui l’ont envahi. Le village dont Nadia et Lev sont les derniers habitants n’a plus d’existence pour les autorités. Pillées par les maraudeurs, pressurées par la forêt, ses datchas en bois autrefois construites artisanalement sont devenues le royaume des esprits frappeurs. D’ailleurs, de grands bruits inexplicables terrifient Lev dont la tête commence aussi à partir en friche. Sa mémoire à lui s’effaçant, Nadia s’efforce de se souvenir pour deux, tout au moins dans les moments qui échappent à son dur labeur quotidien, entre leurs bêtes, le potager et les mille tracas quotidiens d’une existence en autarcie, loin de tout.
Mais, si Lev a pris de l’avance sur elle dans la décrépitude, Nadia n’est pas forcément mieux armée pour affronter la réalité. Si sa mémoire à elle lui joue des tours, c’est qu’enfoui sous les non-dits, un vieux drame n’en continue pas moins d’empoisonner l’esprit de cette femme vieillissante. Un événement a bloqué le temps pour ce couple, le laissant à jamais suspendu hors du monde. Lev et Nadia sont devenus deux pierres dans le courant d’une rivière. Le pays tout entier a changé, induisant pour cette zone rurale une irréductible déshérence. Eux sont restés figés, à observer peu à peu la déliquescence de la Russie recouvrir en un parfait mimétisme le désastre de leur propre vie. Une vieille connaissance indésirable a annoncé sa visite. Il va leur falloir affronter leurs fantômes…
Fine psychologue et peintre d’atmosphère, Marente De Moor superpose habilement les désillusions d’un couple au destin brisé à l‘agonie du monde soviétique dans les années 1990. Maintenus en vie par la nécessité de faire face aux exigences du quotidien – se nourrir et se chauffer monopolisent toute leur énergie –, Nadia et Lev n’ont pas le temps de s’appesantir sur leurs états d’âme ni de comprendre ce qui se passe autour d’eux. Il leur faut juste tenir dans un univers qui s’écroule, la fin de leurs rêves coïncidant étrangement avec celle du monde autour d’eux. Tant la structure du récit que la langue employée, entre gestes rassurants du quotidien et ambiance énigmatique et menaçante, contribuent à la douloureuse poésie du récit, marqué par la dépossession, l’inquiétude et l’étrangeté.
Comment vivre quand tout s’est écroulé ? Entre survie matérielle, rêves refuges et folles hallucinations, Marente de Moor excelle à décrire un déroutant et touchant déséquilibre, un pied dans la réalité, l’autre dans un imaginaire étrange et presque fantastique.
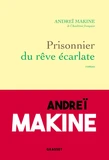
Prisonnier du rêve écarlate
Avis posté le 2025-05-04
Coup de coeur
Destin cruel que celui de Lucien Baert, ouvrier du Nord de la France si plein de ses idéaux communistes que le voilà, enthousiaste et confiant, membre d’une délégation partie visiter l’Union Soviétique en 1939. Arrêté et accusé d’espionnage après avoir manqué le train du retour, le jeune homme qui avait eu le tort de comprendre la supercherie des villages Potemkine se retrouve « prisonnier du rêve écarlate » : torturé, emprisonné puis enrôlé dans l’Armée rouge, renvoyé encore en camp de travail, il connaît trente ans de Goulag avant de parvenir à s’enfuir sous l’identité d’un mort, Matveï Bélov.
Amnistié en 1957 à la mort de Staline, il se reconstruit peu à peu dans un village reculé de la taïga, y menant une vie simple, laborieuse mais paisible, auprès d’une femme, Daria, qui, constatant ses déchirements identitaires, le pousse à rentrer en France retrouver les siens. Mais la France où il débarque en 1967 n’est plus celle qu’il a connue. Happé par le tourbillon parisien qui s’est emparé de son histoire jusqu’à lui dicter son nouveau rôle de témoin-expert des totalitarismes en tout genre, Lucien ne tarde pas à se sentir comme « un astronaute égaré sur une planète inconnue », les illusions post-soixante-huitardes lui paraissant toutes aussi fausses que les siennes autrefois dans leurs égarements hédonistes, narcissiques et libertaires menant jusqu’à une pédophilie assumée.
Et si le bonheur était tout simplement l’amour de Daria au fin fond de la taïga, là où, confronté à la rigueur d’une existence soumise au rythme des saisons et de la nature, personne ne porte de masque et tout le monde joue le jeu de la solidarité ? C’est sans compter les nouvelles dérives de la société russe devenue cette fois « cet opéra bouffe qui, avec une démesure dont la Russie a le secret, met en scène le capitalisme le plus grotesque. » A croire que nulle part, quelles que soient les modes, les convictions et la théorie sociétale du moment, l’on n'échappe à la folie des excès et des abus. Derrière les utopies et leurs illusions, toujours la même jungle déguisée sous différents costumes.
Cinquante ans d’histoire autant russe qu’occidentale pour constater que la déception fleurit de tout côté : aucune société n’a trouvé la martingale du bonheur. Inutile de chercher les méchants d’un côté, les bons de l’autre. Les dérives sont partout, de part et d’autre, et la sagesse introuvable au-delà de quelques individus au final emportés par la folie collective. Une certaine tristesse accompagne ce constat d’échec systématique des utopies. Même la parole des dissidents s’avère ici sujette à caution. Et, après avoir peint un Lucien manipulé par son éditeur et par la presse pour servir son histoire sous un angle si choisi que fallacieux, l’auteur de pointer quelques distorsions dans les écrits-mêmes de Soljenitsyne.
L’on dévore avec passion ce grand roman initiatique porté par le souffle de l’Histoire et qui, à travers ses personnages et leurs désillusions, pose de manière si vivante ces tristes constats : les sociétés n’ont pas de morale et leurs utopies sont condamnées à l’échec. Coup de coeur.
Destin cruel que celui de Lucien Baert, ouvrier du Nord de la France si plein de ses idéaux communistes que le voilà, enthousiaste et confiant, membre d’une délégation partie visiter l’Union Soviétique en 1939. Arrêté et accusé d’espionnage après avoir manqué le train du retour, le jeune homme qui avait eu le tort de comprendre la supercherie des villages Potemkine se retrouve « prisonnier du rêve écarlate » : torturé, emprisonné puis enrôlé dans l’Armée rouge, renvoyé encore en camp de travail, il connaît trente ans de Goulag avant de parvenir à s’enfuir sous l’identité d’un mort, Matveï Bélov.
Amnistié en 1957 à la mort de Staline, il se reconstruit peu à peu dans un village reculé de la taïga, y menant une vie simple, laborieuse mais paisible, auprès d’une femme, Daria, qui, constatant ses déchirements identitaires, le pousse à rentrer en France retrouver les siens. Mais la France où il débarque en 1967 n’est plus celle qu’il a connue. Happé par le tourbillon parisien qui s’est emparé de son histoire jusqu’à lui dicter son nouveau rôle de témoin-expert des totalitarismes en tout genre, Lucien ne tarde pas à se sentir comme « un astronaute égaré sur une planète inconnue », les illusions post-soixante-huitardes lui paraissant toutes aussi fausses que les siennes autrefois dans leurs égarements hédonistes, narcissiques et libertaires menant jusqu’à une pédophilie assumée.
Et si le bonheur était tout simplement l’amour de Daria au fin fond de la taïga, là où, confronté à la rigueur d’une existence soumise au rythme des saisons et de la nature, personne ne porte de masque et tout le monde joue le jeu de la solidarité ? C’est sans compter les nouvelles dérives de la société russe devenue cette fois « cet opéra bouffe qui, avec une démesure dont la Russie a le secret, met en scène le capitalisme le plus grotesque. » A croire que nulle part, quelles que soient les modes, les convictions et la théorie sociétale du moment, l’on n'échappe à la folie des excès et des abus. Derrière les utopies et leurs illusions, toujours la même jungle déguisée sous différents costumes.
Cinquante ans d’histoire autant russe qu’occidentale pour constater que la déception fleurit de tout côté : aucune société n’a trouvé la martingale du bonheur. Inutile de chercher les méchants d’un côté, les bons de l’autre. Les dérives sont partout, de part et d’autre, et la sagesse introuvable au-delà de quelques individus au final emportés par la folie collective. Une certaine tristesse accompagne ce constat d’échec systématique des utopies. Même la parole des dissidents s’avère ici sujette à caution. Et, après avoir peint un Lucien manipulé par son éditeur et par la presse pour servir son histoire sous un angle si choisi que fallacieux, l’auteur de pointer quelques distorsions dans les écrits-mêmes de Soljenitsyne.
L’on dévore avec passion ce grand roman initiatique porté par le souffle de l’Histoire et qui, à travers ses personnages et leurs désillusions, pose de manière si vivante ces tristes constats : les sociétés n’ont pas de morale et leurs utopies sont condamnées à l’échec. Coup de coeur.