Les derniers avis
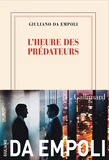
L'heure des prédateurs
Avis posté le 2025-05-18
Eclairant, fascinant et terrifiant
Après Les ingénieurs du chaos et Le Mage du Kremlin qui décryptaient, pour l’un, la stratégie d’affirmation par le chaos des nouveaux leaders populistes, pour l’autre, les ambitions de Poutine, l’ancien conseiller politique italo-suisse Giuliano da Empoli analyse les mécanismes à l’oeuvre dans le désordre mondial savamment entretenu par Trump.
Que se passe-t-il lorsque, ayant fait feu de tout bois – colère des insatisfaits et caisses de résonance numériques – pour déborder la démocratie libérale, l’un de ces stratèges du chaos parvient au pouvoir ? La réélection de Trump sonne l’heure d’une nouvelle ère, quand, d’outil de rébellion, la politique du chaos se fait institutionnelle, le gouvernant exerçant le pouvoir en multipliant les effets de sidération par l’imprévisibilité et l’usage incontrôlé de la force.
Ces nouveaux tyrans sont déjà un certain nombre à graviter dans ce que l’auteur identifie comme un nouveau cercle de prédateurs, parmi lesquels, entre Trump et Poutine, l’on peut citer Nayib Bukele au Salvador, Javier Milei en Argentine ou Mohammed ben Salmane en Arabie Saoudite. Tous ont en commun un comportement « borgien », de Borgia, le Prince qu’observa si cyniquement Machiavel. Au diable éthique et morale, seule compte la conservation du pouvoir.
Alors, à chaque époque les moyens : si les condottières du XVIe siècle profitèrent de l’invention de l’artillerie pour faire primer l’offensive dans un paroxysme de violence précipitant la fin des fortifications de type médiéval, les prédateurs de notre siècle se servent eux aussi de la rupture technologique pour avancer leurs pions. Le pouvoir passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et leurs algorithmes, dictateurs et milliardaires de la tech s’empressant d’allier leurs forces dans ce nouvel espace sans règles propice à l’exacerbation de la violence et du chaos.
Convaincu que, bien loin de nous trouver confrontés à quelques événements conjoncturels, nous vivons un vrai changement d’époque et qu’est en train de s’ouvrir « une ère de violence sans limites », d’autant plus dominée par le rapport de forces que l’attaque, cyber ou autre, est redevenue moins coûteuse que la défense, l’auteur nous voit face aux conquistadors de la tech comme les Aztèques face aux conquistadors espagnols. Alors que, comme eux, nous restons incapables de nous décider entre fascination et rejet, notre passivité frise l’inconscience du précipice vers lequel le monde fonce tête baissée.
Avec ses illustrations frappantes tirées de son expérience personnelle au sein des microcosmes politiques, l’élégance toute littéraire de sa plume et ses punchlines en salves, Giuliano da Empoli signe un nouvel ouvrage que l’on aurait aimé moins bref et un peu plus approfondi, mais, en tous les cas, d’une clarté et d’une lucidité saisissantes n’ouvrant guère la porte à l’optimisme. C’est d’un avenir glaçant dont il se fait ici l’oracle. Une lecture éclairante, aussi terrifiante que fascinante, qui ne peut laisser indifférent. Coup de coeur.
Après Les ingénieurs du chaos et Le Mage du Kremlin qui décryptaient, pour l’un, la stratégie d’affirmation par le chaos des nouveaux leaders populistes, pour l’autre, les ambitions de Poutine, l’ancien conseiller politique italo-suisse Giuliano da Empoli analyse les mécanismes à l’oeuvre dans le désordre mondial savamment entretenu par Trump.
Que se passe-t-il lorsque, ayant fait feu de tout bois – colère des insatisfaits et caisses de résonance numériques – pour déborder la démocratie libérale, l’un de ces stratèges du chaos parvient au pouvoir ? La réélection de Trump sonne l’heure d’une nouvelle ère, quand, d’outil de rébellion, la politique du chaos se fait institutionnelle, le gouvernant exerçant le pouvoir en multipliant les effets de sidération par l’imprévisibilité et l’usage incontrôlé de la force.
Ces nouveaux tyrans sont déjà un certain nombre à graviter dans ce que l’auteur identifie comme un nouveau cercle de prédateurs, parmi lesquels, entre Trump et Poutine, l’on peut citer Nayib Bukele au Salvador, Javier Milei en Argentine ou Mohammed ben Salmane en Arabie Saoudite. Tous ont en commun un comportement « borgien », de Borgia, le Prince qu’observa si cyniquement Machiavel. Au diable éthique et morale, seule compte la conservation du pouvoir.
Alors, à chaque époque les moyens : si les condottières du XVIe siècle profitèrent de l’invention de l’artillerie pour faire primer l’offensive dans un paroxysme de violence précipitant la fin des fortifications de type médiéval, les prédateurs de notre siècle se servent eux aussi de la rupture technologique pour avancer leurs pions. Le pouvoir passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et leurs algorithmes, dictateurs et milliardaires de la tech s’empressant d’allier leurs forces dans ce nouvel espace sans règles propice à l’exacerbation de la violence et du chaos.
Convaincu que, bien loin de nous trouver confrontés à quelques événements conjoncturels, nous vivons un vrai changement d’époque et qu’est en train de s’ouvrir « une ère de violence sans limites », d’autant plus dominée par le rapport de forces que l’attaque, cyber ou autre, est redevenue moins coûteuse que la défense, l’auteur nous voit face aux conquistadors de la tech comme les Aztèques face aux conquistadors espagnols. Alors que, comme eux, nous restons incapables de nous décider entre fascination et rejet, notre passivité frise l’inconscience du précipice vers lequel le monde fonce tête baissée.
Avec ses illustrations frappantes tirées de son expérience personnelle au sein des microcosmes politiques, l’élégance toute littéraire de sa plume et ses punchlines en salves, Giuliano da Empoli signe un nouvel ouvrage que l’on aurait aimé moins bref et un peu plus approfondi, mais, en tous les cas, d’une clarté et d’une lucidité saisissantes n’ouvrant guère la porte à l’optimisme. C’est d’un avenir glaçant dont il se fait ici l’oracle. Une lecture éclairante, aussi terrifiante que fascinante, qui ne peut laisser indifférent. Coup de coeur.
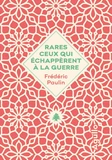
Rares ceux qui échappèrent à la guerre
Avis posté le 2025-05-16
Passionnant
Après le premier tome Nul ennemi comme un frère, Frédéric Paulin poursuit sa trilogie sur les quinze années de la guerre du Liban, de 1975 à 1990. Le récit reprend là où il s’était arrêté, en plein attentat du Drakkar le 23 octobre 1983, un immeuble de Beyrouth où stationnaient des militaires français. Le souffle de l’explosion passe ainsi directement de la dernière page du volume précédent à la première de celui-ci, dans une continuité narrative qu’il vaut mieux aborder depuis le début. En attendant le dernier tome annoncé pour l’été 2025, ce sont les années 1983 à 1986, jusqu’à cette fois l’attentat de la rue de Rennes à Paris, que l’auteur nous raconte avec toujours autant de souffle romanesque que de rigueur historique.
Mêlés aux protagonistes réels de l’époque, l’on retrouve donc les mêmes personnages fictifs qui, des désillusions du commandant Dixneuf de la DGSE au redoublement de violence du Libanais chiite Abdul Rasool al-Amine, en passant par les manoeuvres politiques du bientôt député RPR Michel Nada et de l’ex-diplomate Philippe Kellerman devenu proche conseiller du président Mitterrand, mais aussi par le désarroi du commissaire Caillaux et de sa femme juge anti-terroriste, permettent de croiser les points de vue sur ces années qui ont vu la guerre du Liban s’exporter sur le sol français.
Sans chapitre ni coupure, avec pour seules balises temporelles les faits historiques, le récit avance comme un fleuve en furie charriant les événements toujours plus violents qui, au Liban, en France, en Iran, ont pris une tournure d’une inextricable complexité. Pendant que la guerre transforme le Liban en champ de ruines, que les bombes d’Action Directe et des différents groupes islamistes installent un climat de terreur en France et que les otages tremblent pour leur vie entre les mains du Hezbollah, l’on découvre dans un étonnement consterné les dessous d’une diplomatie française minée par les rivalités et par les compromissions, les tractations concurrentes menées par les différents partis politiques à l’approche des élections présidentielles achevant d’ajouter à la confusion.
Les scènes courtes s’enchaînent sans discontinuer, sautant d’un lieu à l’autre dans une tension d’autant plus captivante que d’une crédibilité sans faille, l’auteur fondant son irréprochable rigueur d’écriture sur une documentation aussi impressionnante par sa minutie que par le naturel de sa restitution. Sans commentaire ni parti pris, le livre démonte les mécanismes et les enjeux politiques de la violence pour un tableau édifiant, souvent effarant, et toujours passionnant. Une vraie performance que cette lecture limpide et agréable du fatras au Proche-Orient. Vivement le dernier tome de la trilogie ! Coup de coeur.
Après le premier tome Nul ennemi comme un frère, Frédéric Paulin poursuit sa trilogie sur les quinze années de la guerre du Liban, de 1975 à 1990. Le récit reprend là où il s’était arrêté, en plein attentat du Drakkar le 23 octobre 1983, un immeuble de Beyrouth où stationnaient des militaires français. Le souffle de l’explosion passe ainsi directement de la dernière page du volume précédent à la première de celui-ci, dans une continuité narrative qu’il vaut mieux aborder depuis le début. En attendant le dernier tome annoncé pour l’été 2025, ce sont les années 1983 à 1986, jusqu’à cette fois l’attentat de la rue de Rennes à Paris, que l’auteur nous raconte avec toujours autant de souffle romanesque que de rigueur historique.
Mêlés aux protagonistes réels de l’époque, l’on retrouve donc les mêmes personnages fictifs qui, des désillusions du commandant Dixneuf de la DGSE au redoublement de violence du Libanais chiite Abdul Rasool al-Amine, en passant par les manoeuvres politiques du bientôt député RPR Michel Nada et de l’ex-diplomate Philippe Kellerman devenu proche conseiller du président Mitterrand, mais aussi par le désarroi du commissaire Caillaux et de sa femme juge anti-terroriste, permettent de croiser les points de vue sur ces années qui ont vu la guerre du Liban s’exporter sur le sol français.
Sans chapitre ni coupure, avec pour seules balises temporelles les faits historiques, le récit avance comme un fleuve en furie charriant les événements toujours plus violents qui, au Liban, en France, en Iran, ont pris une tournure d’une inextricable complexité. Pendant que la guerre transforme le Liban en champ de ruines, que les bombes d’Action Directe et des différents groupes islamistes installent un climat de terreur en France et que les otages tremblent pour leur vie entre les mains du Hezbollah, l’on découvre dans un étonnement consterné les dessous d’une diplomatie française minée par les rivalités et par les compromissions, les tractations concurrentes menées par les différents partis politiques à l’approche des élections présidentielles achevant d’ajouter à la confusion.
Les scènes courtes s’enchaînent sans discontinuer, sautant d’un lieu à l’autre dans une tension d’autant plus captivante que d’une crédibilité sans faille, l’auteur fondant son irréprochable rigueur d’écriture sur une documentation aussi impressionnante par sa minutie que par le naturel de sa restitution. Sans commentaire ni parti pris, le livre démonte les mécanismes et les enjeux politiques de la violence pour un tableau édifiant, souvent effarant, et toujours passionnant. Une vraie performance que cette lecture limpide et agréable du fatras au Proche-Orient. Vivement le dernier tome de la trilogie ! Coup de coeur.

Terrasses. Ou notre long baiser si longtemps retardé
Avis posté le 2025-05-14
Retenue et justesse de ton
Cela fait presque dix ans qu’ont eu lieu à Paris les attentats du 13 novembre 2015. Dans un roman choral par ailleurs mis en scène au théâtre, Laurent Gaudé nous donne à entendre les voix des victimes et des secouristes, un choeur poignant dont la délicate litanie fait ressortir le motif lumineux de l’amour, de l’empathie et de la solidarité sur le noir absolu de la violence aveugle et de la peur.
L’exercice était délicat et l’écrivain le réussit avec brio. Tandis que, donnant la parole aussi bien aux morts qu’aux vivants, le « je » et le « nous » du récit immergent le lecteur au plus près de ce qu’ont vécu les victimes et ceux qui leur ont porté secours – ici une amoureuse qui court vers un premier baiser, là deux jumelles impatientes de se retrouver à Paris pour leur anniversaire, là encore un couple qui se sépare sur une dispute, et bientôt les policiers de la BAC de nuit, une infirmière rappelée d’urgence après la fin de sa journée, les forces d’intervention de la BRI montant à l’assaut du Bataclan… –, se superposent peu à peu, jusqu’à former une petite foule évoquant un choeur antique, les silhouettes fictives mais représentatives, vives et précises, de ces hommes et de ces femmes à qui le hasard a donné rendez-vous ce soir-là avec l’horreur et l’irrémédiable arbitraire du destin.
Chacune y va de son monologue sobrement factuel, évoquant simplement et sans pathos la vie fauchée en plein geste ou à jamais transformée par la perte et la confrontation à l’impensable barbarie. Pas de haine ni même de colère, juste la sidération suivie de la douleur et, face à l’implacable atrocité tombée au hasard au beau milieu de vies banales qui auraient pu tout aussi bien être la nôtre ou celle de proches, la dignité de gens s’efforçant comme ils peuvent de faire face à une tragédie collective nous dépassant tous.
Poignant dans son incommensurable tristesse, souvent insoutenable malgré la pudeur presque clinique de ces voix comme désincarnées surgies de l’obscurité des enfers et sondant sans répit la question sans réponse du hasard et de l’arbitraire – « “Toi, oui. L’autre, pas.” À une seconde près, un centimètre près. Avoir de la chance ou pas. » –, le texte laisse la vie et l’envie de vivre diffuser une lumière têtue, celle de l’humanité et de la liberté, qui réussit en dépit de tout à imposer l’espoir face à l’obscurantisme aveugle.
Un texte bref, intense et bouleversant, qui a su trouver la retenue et la justesse de ton pour aborder avec autant d’empathie que de respect les blessures individuelles et collectives qui démarqueront toujours l’après de l’avant, mais qui, jamais, n’empêcheront la vie de triompher sur les courtes vues du fanatisme. « Nous avons appris qu’on pouvait mourir de marcher dans la rue, de s’attarder autour d’un verre avec des amis. Et pourtant, il faut continuer. Vivre. Comme on aime. Au nom de ceux qui sont tombés. Nous serons tristes, longtemps, mais pas terrifiés. Pas terrassés. »
Cela fait presque dix ans qu’ont eu lieu à Paris les attentats du 13 novembre 2015. Dans un roman choral par ailleurs mis en scène au théâtre, Laurent Gaudé nous donne à entendre les voix des victimes et des secouristes, un choeur poignant dont la délicate litanie fait ressortir le motif lumineux de l’amour, de l’empathie et de la solidarité sur le noir absolu de la violence aveugle et de la peur.
L’exercice était délicat et l’écrivain le réussit avec brio. Tandis que, donnant la parole aussi bien aux morts qu’aux vivants, le « je » et le « nous » du récit immergent le lecteur au plus près de ce qu’ont vécu les victimes et ceux qui leur ont porté secours – ici une amoureuse qui court vers un premier baiser, là deux jumelles impatientes de se retrouver à Paris pour leur anniversaire, là encore un couple qui se sépare sur une dispute, et bientôt les policiers de la BAC de nuit, une infirmière rappelée d’urgence après la fin de sa journée, les forces d’intervention de la BRI montant à l’assaut du Bataclan… –, se superposent peu à peu, jusqu’à former une petite foule évoquant un choeur antique, les silhouettes fictives mais représentatives, vives et précises, de ces hommes et de ces femmes à qui le hasard a donné rendez-vous ce soir-là avec l’horreur et l’irrémédiable arbitraire du destin.
Chacune y va de son monologue sobrement factuel, évoquant simplement et sans pathos la vie fauchée en plein geste ou à jamais transformée par la perte et la confrontation à l’impensable barbarie. Pas de haine ni même de colère, juste la sidération suivie de la douleur et, face à l’implacable atrocité tombée au hasard au beau milieu de vies banales qui auraient pu tout aussi bien être la nôtre ou celle de proches, la dignité de gens s’efforçant comme ils peuvent de faire face à une tragédie collective nous dépassant tous.
Poignant dans son incommensurable tristesse, souvent insoutenable malgré la pudeur presque clinique de ces voix comme désincarnées surgies de l’obscurité des enfers et sondant sans répit la question sans réponse du hasard et de l’arbitraire – « “Toi, oui. L’autre, pas.” À une seconde près, un centimètre près. Avoir de la chance ou pas. » –, le texte laisse la vie et l’envie de vivre diffuser une lumière têtue, celle de l’humanité et de la liberté, qui réussit en dépit de tout à imposer l’espoir face à l’obscurantisme aveugle.
Un texte bref, intense et bouleversant, qui a su trouver la retenue et la justesse de ton pour aborder avec autant d’empathie que de respect les blessures individuelles et collectives qui démarqueront toujours l’après de l’avant, mais qui, jamais, n’empêcheront la vie de triompher sur les courtes vues du fanatisme. « Nous avons appris qu’on pouvait mourir de marcher dans la rue, de s’attarder autour d’un verre avec des amis. Et pourtant, il faut continuer. Vivre. Comme on aime. Au nom de ceux qui sont tombés. Nous serons tristes, longtemps, mais pas terrifiés. Pas terrassés. »