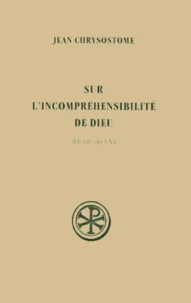Figures de l'évêque idéal
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 2 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 6 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 2 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages210
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.285 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,0 cm × 1,2 cm
- ISBN2-251-33945-0
- EAN9782251339450
- Date de parution01/01/2004
- CollectionLa roue à livres
- ÉditeurBelles Lettres
- TraducteurLaurence Brottier
Résumé
Rapprocher le Panégyrique de saint Mélèce composé par Jean Chrysostome (fin du IVe s. ap. J.-C.) et le
Panégyrique de saint Jean Chrysostome écrit par Jean
Damascène (début du VIIIe s. ap. J.-C.) permet de saisir
la vie de la tradition littéraire grecque dans sa continuité et dans ses évolutions, aussi bien que celle de la
spiritualité chrétienne. Les deux discours se font écho
à travers une quête commune, celle de l'image idéale
du maître spirituel. Si une communauté en pleine
expansion mais en proie à des dissensions internes, au
temps de Jean Chrysostome, a besoin d'une figure
comme garant de son orthodoxie, la nécessité d'un
référent est encore plus sensible à l'époque de Jean
Damascène, tandis que le christianisme tend à devenir minoritaire par rapport à l'islam et que le grec en
vient à être supplanté par l'arabe.
Rapprocher le Panégyrique de saint Mélèce composé par Jean Chrysostome (fin du IVe s. ap. J.-C.) et le
Panégyrique de saint Jean Chrysostome écrit par Jean
Damascène (début du VIIIe s. ap. J.-C.) permet de saisir
la vie de la tradition littéraire grecque dans sa continuité et dans ses évolutions, aussi bien que celle de la
spiritualité chrétienne. Les deux discours se font écho
à travers une quête commune, celle de l'image idéale
du maître spirituel. Si une communauté en pleine
expansion mais en proie à des dissensions internes, au
temps de Jean Chrysostome, a besoin d'une figure
comme garant de son orthodoxie, la nécessité d'un
référent est encore plus sensible à l'époque de Jean
Damascène, tandis que le christianisme tend à devenir minoritaire par rapport à l'islam et que le grec en
vient à être supplanté par l'arabe.