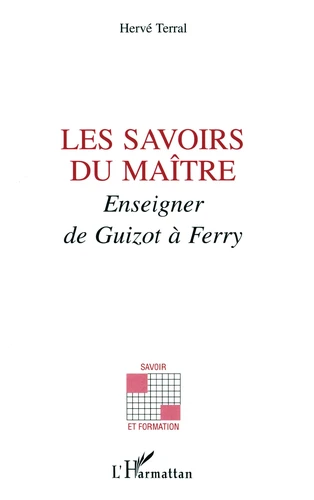Les savoirs du maître. Enseigner de Guizot à Ferry
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages243
- PrésentationBroché
- Poids0.31 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 1,7 cm
- ISBN2-7384-6847-0
- EAN9782738468475
- Date de parution15/09/1998
- CollectionSavoir et formation
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
A l'heure où ont été créés des Instituts universitaires de formation des maîtres (1989), il importe de s'interroger sur le maintien dans le langage officiel d'un terme déjà ancien : le maître, présenté aujourd'hui aussi comme " professeur ", voire comme " professionnel de l'éducation ". Quelques questions récurrentes se posent alors : quels savoirs, par delà les savoirs disciplinaires enseignés, caractérisent la " professionnalité " des enseignants et par quels dispositifs de formation spécifique peut-on se les approprier? Comment devient-on enseignant? Les savoirs convoqués semblent bien identifiés : pédagogie, science(s) de l'éducation, didactique(s), philosophie, morale/ éthique, psychologie, sociologie...
mais régulièrement remis en cause néanmoins : pourquoi? Parce que le problème des normes et de la justification professionnelles s'impose avec une acuité grandissante, cet ouvrage s'efforce de cerner, dans une approche socio-historique, la genèse des métiers de l'enseignement, de Guizot à Ferry. A travers ces deux figures majeures fondatrices de politiques de l'éducation résolues, devenues parfois des mythes, se sont en effet constitués des " moments " caractéristiques de notre modernité qu'il convient d'analyser tout particulièrement dans une période de crise du lien social.
mais régulièrement remis en cause néanmoins : pourquoi? Parce que le problème des normes et de la justification professionnelles s'impose avec une acuité grandissante, cet ouvrage s'efforce de cerner, dans une approche socio-historique, la genèse des métiers de l'enseignement, de Guizot à Ferry. A travers ces deux figures majeures fondatrices de politiques de l'éducation résolues, devenues parfois des mythes, se sont en effet constitués des " moments " caractéristiques de notre modernité qu'il convient d'analyser tout particulièrement dans une période de crise du lien social.
A l'heure où ont été créés des Instituts universitaires de formation des maîtres (1989), il importe de s'interroger sur le maintien dans le langage officiel d'un terme déjà ancien : le maître, présenté aujourd'hui aussi comme " professeur ", voire comme " professionnel de l'éducation ". Quelques questions récurrentes se posent alors : quels savoirs, par delà les savoirs disciplinaires enseignés, caractérisent la " professionnalité " des enseignants et par quels dispositifs de formation spécifique peut-on se les approprier? Comment devient-on enseignant? Les savoirs convoqués semblent bien identifiés : pédagogie, science(s) de l'éducation, didactique(s), philosophie, morale/ éthique, psychologie, sociologie...
mais régulièrement remis en cause néanmoins : pourquoi? Parce que le problème des normes et de la justification professionnelles s'impose avec une acuité grandissante, cet ouvrage s'efforce de cerner, dans une approche socio-historique, la genèse des métiers de l'enseignement, de Guizot à Ferry. A travers ces deux figures majeures fondatrices de politiques de l'éducation résolues, devenues parfois des mythes, se sont en effet constitués des " moments " caractéristiques de notre modernité qu'il convient d'analyser tout particulièrement dans une période de crise du lien social.
mais régulièrement remis en cause néanmoins : pourquoi? Parce que le problème des normes et de la justification professionnelles s'impose avec une acuité grandissante, cet ouvrage s'efforce de cerner, dans une approche socio-historique, la genèse des métiers de l'enseignement, de Guizot à Ferry. A travers ces deux figures majeures fondatrices de politiques de l'éducation résolues, devenues parfois des mythes, se sont en effet constitués des " moments " caractéristiques de notre modernité qu'il convient d'analyser tout particulièrement dans une période de crise du lien social.