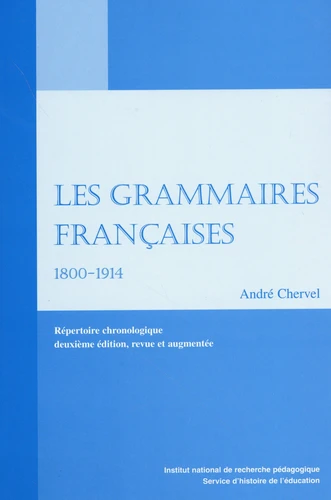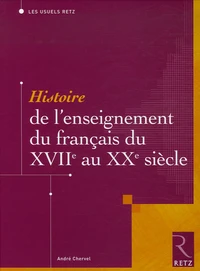Les grammaires françaises 1800 - 1914
2e édition revue et augmentée
Par : Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 16 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 5 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 16 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages226
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.365 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,1 cm
- ISBN2-7342-0664-1
- EAN9782734206644
- Date de parution01/04/2000
- ÉditeurINRP
Résumé
La réflexion grammaticale en France a connu deux époques fastes : celle qui culmine dans la "grammaire générale" et la grammaire philosophique (liées à Port-Royal et à l'Encyclopédie), et la période contemporaine marquée parle fonctionnalisme, le structuralisme et la grammaire générative et transformationnelle (d'origine américaine, il est vrai). Entre les deux, un long XIXe siècle, pendant lequel la grammaire du français a été littéralement happée par le système scolaire, pour répondre aux nécessités de l'apprentissage des "éléments de la langue française" (selon l'expression pudique de la loi Guizot de 1833), c'est-à-dire surtout de l'orthographe.
La scolarisation de la grammaire a pratiquement stérilisé toute la pensée grammaticale de type "synchronique ", les linguistes du temps se réfugiant dans la grammaire historique et comparée, dans la dialectologie ou dans la phonétique. La production grammaticale se cantonne donc alors, pour l'essentiel, dans l'élaboration de manuels, caractérisés par les contraintes du marché éditorial et la pratique du plagiat.
Mais, si elle apporte peu à la réflexion grammaticale, elle ouvre sur le système éducatif et sur la fonction culturelle des disciplines scolaires des perspectives d'une rare clarté : à travers cette énorme accumulation de manuels, il se crée une théorie grammaticale scolaire (scolaire non seulement dans sa finalité, mais dans ses origines) qui chasse de la culture française toute la linguistique qui l'avait précédée, et lui impose désormais ses catégories.
C'est ce corpus dont on donne ici un descriptif exhaustif, entre 1800 et 1914.
La scolarisation de la grammaire a pratiquement stérilisé toute la pensée grammaticale de type "synchronique ", les linguistes du temps se réfugiant dans la grammaire historique et comparée, dans la dialectologie ou dans la phonétique. La production grammaticale se cantonne donc alors, pour l'essentiel, dans l'élaboration de manuels, caractérisés par les contraintes du marché éditorial et la pratique du plagiat.
Mais, si elle apporte peu à la réflexion grammaticale, elle ouvre sur le système éducatif et sur la fonction culturelle des disciplines scolaires des perspectives d'une rare clarté : à travers cette énorme accumulation de manuels, il se crée une théorie grammaticale scolaire (scolaire non seulement dans sa finalité, mais dans ses origines) qui chasse de la culture française toute la linguistique qui l'avait précédée, et lui impose désormais ses catégories.
C'est ce corpus dont on donne ici un descriptif exhaustif, entre 1800 et 1914.
La réflexion grammaticale en France a connu deux époques fastes : celle qui culmine dans la "grammaire générale" et la grammaire philosophique (liées à Port-Royal et à l'Encyclopédie), et la période contemporaine marquée parle fonctionnalisme, le structuralisme et la grammaire générative et transformationnelle (d'origine américaine, il est vrai). Entre les deux, un long XIXe siècle, pendant lequel la grammaire du français a été littéralement happée par le système scolaire, pour répondre aux nécessités de l'apprentissage des "éléments de la langue française" (selon l'expression pudique de la loi Guizot de 1833), c'est-à-dire surtout de l'orthographe.
La scolarisation de la grammaire a pratiquement stérilisé toute la pensée grammaticale de type "synchronique ", les linguistes du temps se réfugiant dans la grammaire historique et comparée, dans la dialectologie ou dans la phonétique. La production grammaticale se cantonne donc alors, pour l'essentiel, dans l'élaboration de manuels, caractérisés par les contraintes du marché éditorial et la pratique du plagiat.
Mais, si elle apporte peu à la réflexion grammaticale, elle ouvre sur le système éducatif et sur la fonction culturelle des disciplines scolaires des perspectives d'une rare clarté : à travers cette énorme accumulation de manuels, il se crée une théorie grammaticale scolaire (scolaire non seulement dans sa finalité, mais dans ses origines) qui chasse de la culture française toute la linguistique qui l'avait précédée, et lui impose désormais ses catégories.
C'est ce corpus dont on donne ici un descriptif exhaustif, entre 1800 et 1914.
La scolarisation de la grammaire a pratiquement stérilisé toute la pensée grammaticale de type "synchronique ", les linguistes du temps se réfugiant dans la grammaire historique et comparée, dans la dialectologie ou dans la phonétique. La production grammaticale se cantonne donc alors, pour l'essentiel, dans l'élaboration de manuels, caractérisés par les contraintes du marché éditorial et la pratique du plagiat.
Mais, si elle apporte peu à la réflexion grammaticale, elle ouvre sur le système éducatif et sur la fonction culturelle des disciplines scolaires des perspectives d'une rare clarté : à travers cette énorme accumulation de manuels, il se crée une théorie grammaticale scolaire (scolaire non seulement dans sa finalité, mais dans ses origines) qui chasse de la culture française toute la linguistique qui l'avait précédée, et lui impose désormais ses catégories.
C'est ce corpus dont on donne ici un descriptif exhaustif, entre 1800 et 1914.