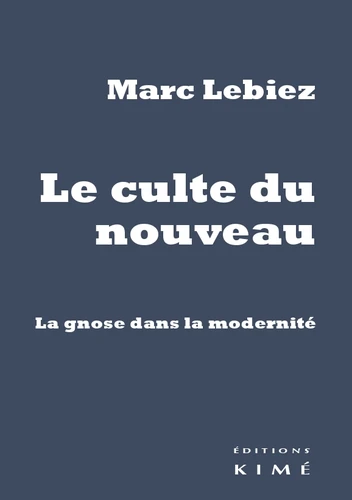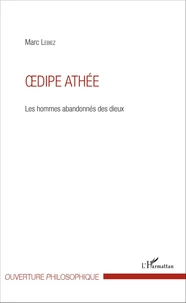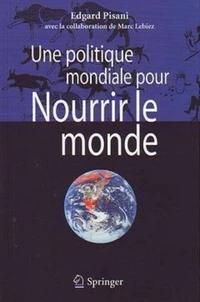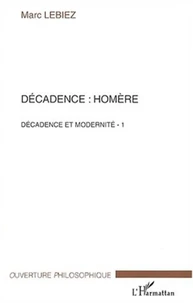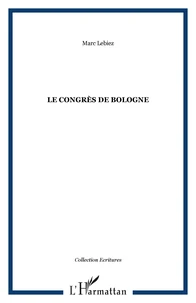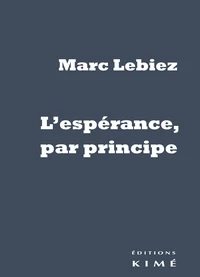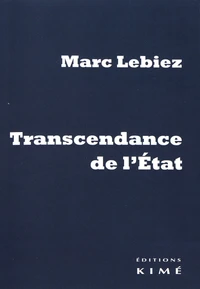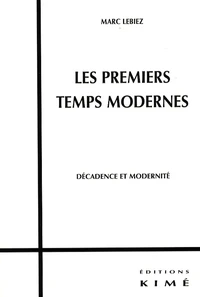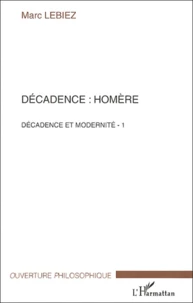Le culte du nouveau. La gnose dans la modernité
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages252
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.325 kg
- Dimensions14,5 cm × 21,0 cm × 1,8 cm
- ISBN978-2-84174-780-1
- EAN9782841747801
- Date de parution14/02/2017
- CollectionPhilosophie en cours
- ÉditeurKimé
Résumé
Les Romains de l'extrême fin de l'Antiquité ont forgé le mot modernus quand ils ont pris conscience que leur temps était devenu très différent de celui des Anciens. Pour nous, la modernité est moins un fait qu'une valeur. Mais que dit-on quand on s'y réfère, que l'on s'affiche moderne ou que l'on proclame sa détestation de la modernité ? Ce pourrait n'être qu'une autre manière de revendiquer les vertus de la jeunesse, moyennant quoi la modernité put, dans les années trente du siècle dernier, être du côté du fascisme mussolinien ou du bolchevisme, et pas des vieilles démocraties.
D'aucuns la voient maintenant du côté des incessantes innovations techniques, d'autres dans l'inquiétude écologiste, d'autres encore dans la religion. Peu après la Seconde Guerre mondiale, Eric Voegelin l'a caractérisée comme une "résurgence gnostique". La gnose avait été à la mode dans les décennies précédentes et la comparaison parut séduisante. Elle suscita en Allemagne et aux Etats-Unis un débat intellectuel dont on n'eut guère d'échos en France avant la traduction des livres de Blumenberg, en particulier son Légitimité des Temps modernes qui s'y opposait.
Quoi que l'on pense de cette thèse, elle aura eu le mérite de montrer qu'il pouvait être fructueux de chercher à dégager une essence de la modernité. La religion gnostique est loin de nous à tout point de vue, et pourtant il se pourrait qu'à en reconstituer l'inspiration on retrouve certaines des questions, voire des réponses, qui importent à notre temps. Le culte du nouveau ne témoigne-t-il pas d'une insatisfaction profonde devant l'ordre du monde ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, en l'attente d'un Sauveur ? Nos sociétés fracturées ne produisent-elles pas une dualité entre les dépositaires de la Connaissance et la foule de ceux qui peuvent bien se contenter de la télévision, son délire sécuritaire et ses complaisances pour les intégrismes religieux ?
D'aucuns la voient maintenant du côté des incessantes innovations techniques, d'autres dans l'inquiétude écologiste, d'autres encore dans la religion. Peu après la Seconde Guerre mondiale, Eric Voegelin l'a caractérisée comme une "résurgence gnostique". La gnose avait été à la mode dans les décennies précédentes et la comparaison parut séduisante. Elle suscita en Allemagne et aux Etats-Unis un débat intellectuel dont on n'eut guère d'échos en France avant la traduction des livres de Blumenberg, en particulier son Légitimité des Temps modernes qui s'y opposait.
Quoi que l'on pense de cette thèse, elle aura eu le mérite de montrer qu'il pouvait être fructueux de chercher à dégager une essence de la modernité. La religion gnostique est loin de nous à tout point de vue, et pourtant il se pourrait qu'à en reconstituer l'inspiration on retrouve certaines des questions, voire des réponses, qui importent à notre temps. Le culte du nouveau ne témoigne-t-il pas d'une insatisfaction profonde devant l'ordre du monde ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, en l'attente d'un Sauveur ? Nos sociétés fracturées ne produisent-elles pas une dualité entre les dépositaires de la Connaissance et la foule de ceux qui peuvent bien se contenter de la télévision, son délire sécuritaire et ses complaisances pour les intégrismes religieux ?
Les Romains de l'extrême fin de l'Antiquité ont forgé le mot modernus quand ils ont pris conscience que leur temps était devenu très différent de celui des Anciens. Pour nous, la modernité est moins un fait qu'une valeur. Mais que dit-on quand on s'y réfère, que l'on s'affiche moderne ou que l'on proclame sa détestation de la modernité ? Ce pourrait n'être qu'une autre manière de revendiquer les vertus de la jeunesse, moyennant quoi la modernité put, dans les années trente du siècle dernier, être du côté du fascisme mussolinien ou du bolchevisme, et pas des vieilles démocraties.
D'aucuns la voient maintenant du côté des incessantes innovations techniques, d'autres dans l'inquiétude écologiste, d'autres encore dans la religion. Peu après la Seconde Guerre mondiale, Eric Voegelin l'a caractérisée comme une "résurgence gnostique". La gnose avait été à la mode dans les décennies précédentes et la comparaison parut séduisante. Elle suscita en Allemagne et aux Etats-Unis un débat intellectuel dont on n'eut guère d'échos en France avant la traduction des livres de Blumenberg, en particulier son Légitimité des Temps modernes qui s'y opposait.
Quoi que l'on pense de cette thèse, elle aura eu le mérite de montrer qu'il pouvait être fructueux de chercher à dégager une essence de la modernité. La religion gnostique est loin de nous à tout point de vue, et pourtant il se pourrait qu'à en reconstituer l'inspiration on retrouve certaines des questions, voire des réponses, qui importent à notre temps. Le culte du nouveau ne témoigne-t-il pas d'une insatisfaction profonde devant l'ordre du monde ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, en l'attente d'un Sauveur ? Nos sociétés fracturées ne produisent-elles pas une dualité entre les dépositaires de la Connaissance et la foule de ceux qui peuvent bien se contenter de la télévision, son délire sécuritaire et ses complaisances pour les intégrismes religieux ?
D'aucuns la voient maintenant du côté des incessantes innovations techniques, d'autres dans l'inquiétude écologiste, d'autres encore dans la religion. Peu après la Seconde Guerre mondiale, Eric Voegelin l'a caractérisée comme une "résurgence gnostique". La gnose avait été à la mode dans les décennies précédentes et la comparaison parut séduisante. Elle suscita en Allemagne et aux Etats-Unis un débat intellectuel dont on n'eut guère d'échos en France avant la traduction des livres de Blumenberg, en particulier son Légitimité des Temps modernes qui s'y opposait.
Quoi que l'on pense de cette thèse, elle aura eu le mérite de montrer qu'il pouvait être fructueux de chercher à dégager une essence de la modernité. La religion gnostique est loin de nous à tout point de vue, et pourtant il se pourrait qu'à en reconstituer l'inspiration on retrouve certaines des questions, voire des réponses, qui importent à notre temps. Le culte du nouveau ne témoigne-t-il pas d'une insatisfaction profonde devant l'ordre du monde ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, en l'attente d'un Sauveur ? Nos sociétés fracturées ne produisent-elles pas une dualité entre les dépositaires de la Connaissance et la foule de ceux qui peuvent bien se contenter de la télévision, son délire sécuritaire et ses complaisances pour les intégrismes religieux ?