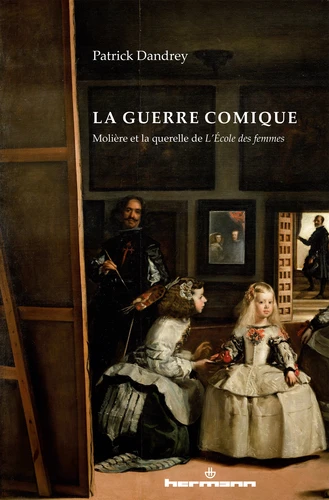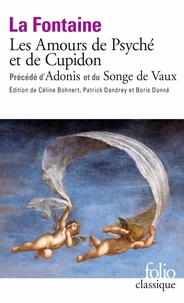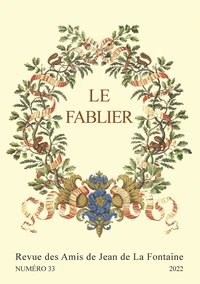La guerre comique. Molière et la querelle de L'Ecole des femmes
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages415
- PrésentationBroché
- Poids0.68 kg
- Dimensions15,8 cm × 24,0 cm × 2,2 cm
- ISBN978-2-7056-8955-1
- EAN9782705689551
- Date de parution10/10/2014
- ÉditeurHermann
Résumé
Voici quelque 350 ans, en 1663, une " guerre comique " opposa Molière aux détracteurs de son Ecole des femmes, créée en décembre 1662. Il mena ce combat à travers deux comédies, La Critique de l'Ecole des femmes et L'Impromptu de Versailles, auxquelles répondirent une dizaine de pièces presque toutes dues à ses adversaires (à l'exception d'un partisan tardif). L'originalité de cette " querelle de L'Ecole des femmes ", c'est qu'elle se choisit le théâtre pour scène et la scène pour théâtre.
Partant de cette intuition, on a tenté de modéliser cette polémique comme une vaste comédie à diverses voix, en l'éclairant à travers plusieurs grilles herméneutiques : celle de la prophétie auto-réalisatrice, pour éclairer l'ambiguïté de l'entrée en querelle ; celle de la prouesse, que Molière voulut opposer aux chicaneries de ses adversaires ; celle de l'écriture spéculaire et de la composition " ironique ", qui réalisent l'oeuvre dans la représentation de son échec ou le démontage de son artifice ; celle de la réécriture hypertextuelle, qui a transformé le conflit de textes en une ondulation polyphonique d'arguments et de thèmes empilés et partagés, etc.
C'est un enchevêtrement de mobiles, de formes et de fins dont on cherche à démêler l'écheveau pour mieux comprendre le miracle esthétique que constituent la délicieuse Critique de l'Ecole des femmes et le miroitant Impromptu de Versailles.
Partant de cette intuition, on a tenté de modéliser cette polémique comme une vaste comédie à diverses voix, en l'éclairant à travers plusieurs grilles herméneutiques : celle de la prophétie auto-réalisatrice, pour éclairer l'ambiguïté de l'entrée en querelle ; celle de la prouesse, que Molière voulut opposer aux chicaneries de ses adversaires ; celle de l'écriture spéculaire et de la composition " ironique ", qui réalisent l'oeuvre dans la représentation de son échec ou le démontage de son artifice ; celle de la réécriture hypertextuelle, qui a transformé le conflit de textes en une ondulation polyphonique d'arguments et de thèmes empilés et partagés, etc.
C'est un enchevêtrement de mobiles, de formes et de fins dont on cherche à démêler l'écheveau pour mieux comprendre le miracle esthétique que constituent la délicieuse Critique de l'Ecole des femmes et le miroitant Impromptu de Versailles.
Voici quelque 350 ans, en 1663, une " guerre comique " opposa Molière aux détracteurs de son Ecole des femmes, créée en décembre 1662. Il mena ce combat à travers deux comédies, La Critique de l'Ecole des femmes et L'Impromptu de Versailles, auxquelles répondirent une dizaine de pièces presque toutes dues à ses adversaires (à l'exception d'un partisan tardif). L'originalité de cette " querelle de L'Ecole des femmes ", c'est qu'elle se choisit le théâtre pour scène et la scène pour théâtre.
Partant de cette intuition, on a tenté de modéliser cette polémique comme une vaste comédie à diverses voix, en l'éclairant à travers plusieurs grilles herméneutiques : celle de la prophétie auto-réalisatrice, pour éclairer l'ambiguïté de l'entrée en querelle ; celle de la prouesse, que Molière voulut opposer aux chicaneries de ses adversaires ; celle de l'écriture spéculaire et de la composition " ironique ", qui réalisent l'oeuvre dans la représentation de son échec ou le démontage de son artifice ; celle de la réécriture hypertextuelle, qui a transformé le conflit de textes en une ondulation polyphonique d'arguments et de thèmes empilés et partagés, etc.
C'est un enchevêtrement de mobiles, de formes et de fins dont on cherche à démêler l'écheveau pour mieux comprendre le miracle esthétique que constituent la délicieuse Critique de l'Ecole des femmes et le miroitant Impromptu de Versailles.
Partant de cette intuition, on a tenté de modéliser cette polémique comme une vaste comédie à diverses voix, en l'éclairant à travers plusieurs grilles herméneutiques : celle de la prophétie auto-réalisatrice, pour éclairer l'ambiguïté de l'entrée en querelle ; celle de la prouesse, que Molière voulut opposer aux chicaneries de ses adversaires ; celle de l'écriture spéculaire et de la composition " ironique ", qui réalisent l'oeuvre dans la représentation de son échec ou le démontage de son artifice ; celle de la réécriture hypertextuelle, qui a transformé le conflit de textes en une ondulation polyphonique d'arguments et de thèmes empilés et partagés, etc.
C'est un enchevêtrement de mobiles, de formes et de fins dont on cherche à démêler l'écheveau pour mieux comprendre le miracle esthétique que constituent la délicieuse Critique de l'Ecole des femmes et le miroitant Impromptu de Versailles.