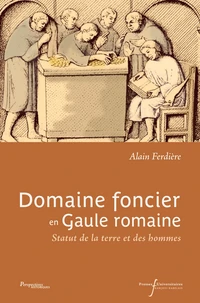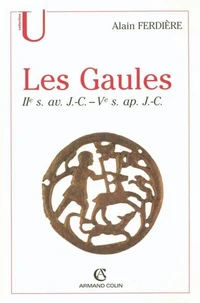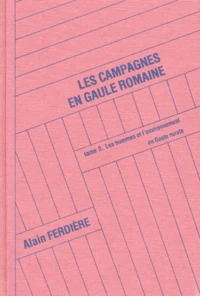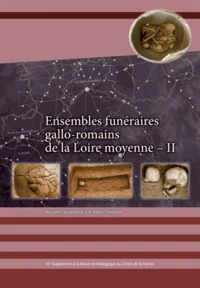Revue archéologique du Centre de la France Supplément N° 25
Capitales éphémères. Des capitales de cités perdent leur statut dans l'Antiquité tardive
Par : , Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages508
- PrésentationBroché
- Poids1.695 kg
- Dimensions21,0 cm × 27,0 cm × 3,0 cm
- ISBN2-913272-10-X
- EAN9782913272101
- Date de parution01/01/2004
- ÉditeurFERACF
Résumé
Pour quelles raisons, dans l'Antiquité tardive, un certain nombre de chefs-lieux de cités ont-ils été dépossédés de ce statut, au profit souvent d'autres sites ? Javols au profit de Mende, Alba au profit de Viviers, mais aussi ailleurs par exemple Jublains, Vieux, Avenches ou Bavay... En fait près de 40 cas à travers les provinces gauloises et alpines. L'archéologie, notamment, permet-elle d'apporter des réponses à ces questions, grâce aux recherches dont on fait récemment l'objet un certain nombre de ces capitales désaffectées, éphémères ? Et même, est-il possible de répondre réellement à cette question originelle sur les causes du phénomènes ? Les réponses semblent en tout cas multiples...
Il nous est donc apparu intéressant de réunir, à l'occasion d'un colloque tenu à Tours en mars 2003, les chercheurs, historiens et archéologues, concernés par cette question, pour s'interroger sur les explications que l'on peut proposer à ce constat : celui de l'échec relatif de certaines capitales de cités choisies comme telle au début de l'Empire qui, comme villes et en tout cas comme lieux de pouvoir, n'ont pas pu survivre aux mutations culturelles et aux soubresauts qu'ont connu les Gaules à partir du 3e siècle.
L'interrogation a été examinée à travers des synthèses régionales, mais aussi un certain nombre d'études de as sur l'un ou l'autre de ces sites spécifiques : le présent volume concerne les 20 communications constituant les Actes de ce colloque ; elles sont suivies d'un Atlas quasi exhaustif de quelque 40 notices portant sur les chefs-lieux concernés des Gaules, sous une forme courte et dans une présentation homogène.
Il nous est donc apparu intéressant de réunir, à l'occasion d'un colloque tenu à Tours en mars 2003, les chercheurs, historiens et archéologues, concernés par cette question, pour s'interroger sur les explications que l'on peut proposer à ce constat : celui de l'échec relatif de certaines capitales de cités choisies comme telle au début de l'Empire qui, comme villes et en tout cas comme lieux de pouvoir, n'ont pas pu survivre aux mutations culturelles et aux soubresauts qu'ont connu les Gaules à partir du 3e siècle.
L'interrogation a été examinée à travers des synthèses régionales, mais aussi un certain nombre d'études de as sur l'un ou l'autre de ces sites spécifiques : le présent volume concerne les 20 communications constituant les Actes de ce colloque ; elles sont suivies d'un Atlas quasi exhaustif de quelque 40 notices portant sur les chefs-lieux concernés des Gaules, sous une forme courte et dans une présentation homogène.
Pour quelles raisons, dans l'Antiquité tardive, un certain nombre de chefs-lieux de cités ont-ils été dépossédés de ce statut, au profit souvent d'autres sites ? Javols au profit de Mende, Alba au profit de Viviers, mais aussi ailleurs par exemple Jublains, Vieux, Avenches ou Bavay... En fait près de 40 cas à travers les provinces gauloises et alpines. L'archéologie, notamment, permet-elle d'apporter des réponses à ces questions, grâce aux recherches dont on fait récemment l'objet un certain nombre de ces capitales désaffectées, éphémères ? Et même, est-il possible de répondre réellement à cette question originelle sur les causes du phénomènes ? Les réponses semblent en tout cas multiples...
Il nous est donc apparu intéressant de réunir, à l'occasion d'un colloque tenu à Tours en mars 2003, les chercheurs, historiens et archéologues, concernés par cette question, pour s'interroger sur les explications que l'on peut proposer à ce constat : celui de l'échec relatif de certaines capitales de cités choisies comme telle au début de l'Empire qui, comme villes et en tout cas comme lieux de pouvoir, n'ont pas pu survivre aux mutations culturelles et aux soubresauts qu'ont connu les Gaules à partir du 3e siècle.
L'interrogation a été examinée à travers des synthèses régionales, mais aussi un certain nombre d'études de as sur l'un ou l'autre de ces sites spécifiques : le présent volume concerne les 20 communications constituant les Actes de ce colloque ; elles sont suivies d'un Atlas quasi exhaustif de quelque 40 notices portant sur les chefs-lieux concernés des Gaules, sous une forme courte et dans une présentation homogène.
Il nous est donc apparu intéressant de réunir, à l'occasion d'un colloque tenu à Tours en mars 2003, les chercheurs, historiens et archéologues, concernés par cette question, pour s'interroger sur les explications que l'on peut proposer à ce constat : celui de l'échec relatif de certaines capitales de cités choisies comme telle au début de l'Empire qui, comme villes et en tout cas comme lieux de pouvoir, n'ont pas pu survivre aux mutations culturelles et aux soubresauts qu'ont connu les Gaules à partir du 3e siècle.
L'interrogation a été examinée à travers des synthèses régionales, mais aussi un certain nombre d'études de as sur l'un ou l'autre de ces sites spécifiques : le présent volume concerne les 20 communications constituant les Actes de ce colloque ; elles sont suivies d'un Atlas quasi exhaustif de quelque 40 notices portant sur les chefs-lieux concernés des Gaules, sous une forme courte et dans une présentation homogène.