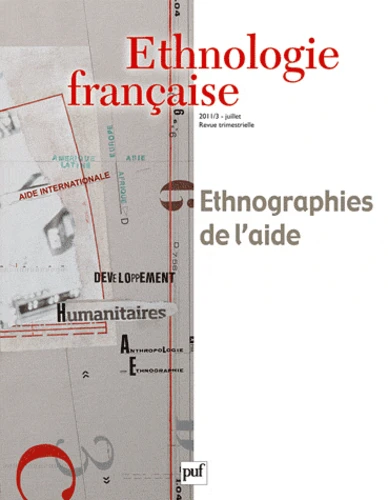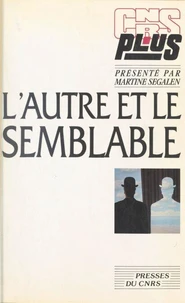Martine Segalen, professeur émérite à l'université de Paris X-Nanterre.
Ethnologie française N° 3, Juillet 2011
Ethnographies de l'aide
Par : Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages180
- PrésentationBroché
- Poids0.508 kg
- Dimensions21,0 cm × 27,0 cm × 0,8 cm
- ISBN978-2-13-058413-1
- EAN9782130584131
- Date de parution23/06/2011
- ÉditeurPUF
Résumé
Une fois n'est pas coutume, Ethnologie française s'évade de ses frontières en ouvrant ses colonnes aux recherches sur l'aide humanitaire et le développement. Sur toute la planète, à travers la multiplication des ONG, associations de toutes sortes, fondations, nouvelles agences multilatérales, cette aide s'enfle et se transforme. Un nouveau champ s'ouvre donc à la réflexion, que les Ethnographies de l'aide, ici présentées, s'attachent à expliciter.
Elles sont aussi soucieuses de s'inscrire dans une histoire intellectuelle longue, dans la filiation des travaux sur le passé colonial, les indépendances, le développement, la santé - histoire sur laquelle se penchent plusieurs articles de cette livraison. Dans des textes où les auteurs montrent jusqu'à quel point et comment cette histoire intellectuelle a modelé leur positionnement théorique comme leur rapport au terrain, ce numéro s'attache aussi à l'étude de cas.
Ainsi sont étudiés en Afrique sub-saharienne, plans fonciers et repérage de droits, politiques de " démocratisation ", réponses internationales à une crise alimentaire, implantation d'un service de soins maternels, organisation de la lutte contre le sida, et en Amérique centrale et du Sud, des politiques du témoignage et de fabrication de "victimes innocentes " d'un conflit armé, ou encore la prise en charge de sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle.
Autant de questions relevant d'une anthropologie qui s'intéresse aux " populations bénéficiaires " comme aux acteurs de l'aide présents sur le terrain, censés les soutenir ou les secourir. Une anthropologie qui ne peut être que critique et politique.
Elles sont aussi soucieuses de s'inscrire dans une histoire intellectuelle longue, dans la filiation des travaux sur le passé colonial, les indépendances, le développement, la santé - histoire sur laquelle se penchent plusieurs articles de cette livraison. Dans des textes où les auteurs montrent jusqu'à quel point et comment cette histoire intellectuelle a modelé leur positionnement théorique comme leur rapport au terrain, ce numéro s'attache aussi à l'étude de cas.
Ainsi sont étudiés en Afrique sub-saharienne, plans fonciers et repérage de droits, politiques de " démocratisation ", réponses internationales à une crise alimentaire, implantation d'un service de soins maternels, organisation de la lutte contre le sida, et en Amérique centrale et du Sud, des politiques du témoignage et de fabrication de "victimes innocentes " d'un conflit armé, ou encore la prise en charge de sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle.
Autant de questions relevant d'une anthropologie qui s'intéresse aux " populations bénéficiaires " comme aux acteurs de l'aide présents sur le terrain, censés les soutenir ou les secourir. Une anthropologie qui ne peut être que critique et politique.
Une fois n'est pas coutume, Ethnologie française s'évade de ses frontières en ouvrant ses colonnes aux recherches sur l'aide humanitaire et le développement. Sur toute la planète, à travers la multiplication des ONG, associations de toutes sortes, fondations, nouvelles agences multilatérales, cette aide s'enfle et se transforme. Un nouveau champ s'ouvre donc à la réflexion, que les Ethnographies de l'aide, ici présentées, s'attachent à expliciter.
Elles sont aussi soucieuses de s'inscrire dans une histoire intellectuelle longue, dans la filiation des travaux sur le passé colonial, les indépendances, le développement, la santé - histoire sur laquelle se penchent plusieurs articles de cette livraison. Dans des textes où les auteurs montrent jusqu'à quel point et comment cette histoire intellectuelle a modelé leur positionnement théorique comme leur rapport au terrain, ce numéro s'attache aussi à l'étude de cas.
Ainsi sont étudiés en Afrique sub-saharienne, plans fonciers et repérage de droits, politiques de " démocratisation ", réponses internationales à une crise alimentaire, implantation d'un service de soins maternels, organisation de la lutte contre le sida, et en Amérique centrale et du Sud, des politiques du témoignage et de fabrication de "victimes innocentes " d'un conflit armé, ou encore la prise en charge de sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle.
Autant de questions relevant d'une anthropologie qui s'intéresse aux " populations bénéficiaires " comme aux acteurs de l'aide présents sur le terrain, censés les soutenir ou les secourir. Une anthropologie qui ne peut être que critique et politique.
Elles sont aussi soucieuses de s'inscrire dans une histoire intellectuelle longue, dans la filiation des travaux sur le passé colonial, les indépendances, le développement, la santé - histoire sur laquelle se penchent plusieurs articles de cette livraison. Dans des textes où les auteurs montrent jusqu'à quel point et comment cette histoire intellectuelle a modelé leur positionnement théorique comme leur rapport au terrain, ce numéro s'attache aussi à l'étude de cas.
Ainsi sont étudiés en Afrique sub-saharienne, plans fonciers et repérage de droits, politiques de " démocratisation ", réponses internationales à une crise alimentaire, implantation d'un service de soins maternels, organisation de la lutte contre le sida, et en Amérique centrale et du Sud, des politiques du témoignage et de fabrication de "victimes innocentes " d'un conflit armé, ou encore la prise en charge de sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle.
Autant de questions relevant d'une anthropologie qui s'intéresse aux " populations bénéficiaires " comme aux acteurs de l'aide présents sur le terrain, censés les soutenir ou les secourir. Une anthropologie qui ne peut être que critique et politique.