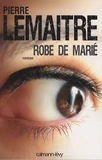Retour



Les dernières notes et avis
Notes et avis 1 à 8 sur un total de 44
Yeruldelgger
Avis posté le 2013-09-04
- Passionnant
- XXe siècle
- Mongolie
- Surprenant
Passionnant
Yeruldelgger est un roman policier très réussi se déroulant en Mongolie. Nous y découvrons sa capitale, Ourlan-Bator, et ses blocs soviétiques qui côtoient les gratte-ciel, ses immeubles en verre et ses égouts qui abritent tous les exclus venus s’y réchauffer. Nous y découvrons également ses forêts, ses plaines infinies et ses déserts que des touristes Coréens traversent à dos de quads en piétinant tout, êtres humains et traditions, sur leur passage. C’est dans un de ces paysages sublimes, sur une terre desséchée, que le cadavre d’une petite fille est retrouvée par des villageois. Le commissaire Yeruldelgger est appelé sur les lieux, et la vision des restes du cadavre de la fillette lui rappelle de bien douloureux souvenirs. En effet, ce commissaire meurtri a perdu sa propre fille lors d’une enquête, quand des criminels avides de s’emparer des terres mongoles l’ont enlevée afin que son père renonce à son enquête. Cinq ans plus tard, cette enquête sera alors pour lui vécue comme une chance de rédemption. Mais les cadavres de trois chinois retrouvés dans un entrepôt viennent compliquer la donne, et vont dans un premier temps reléguer au second plan l’enquête sur la petite fille.
Yeruldelgger parvient à nous fasciner pour cette terre inconnue, ses habitants, son histoire, les problèmes auxquels ils sont confrontés, et surtout les traditions omniprésentes qui en abritent le quotidien. Le roman nous emporte très vite dans sa course effrénée pour que vérité et justice soient faites, malgré la corruption qui semble un fléau bien pire que le crime, et malgré une modernité galopante qui risque d’emporter sur son passage beaucoup de souvenirs ancestraux. Les rebondissements sont nombreux et inattendus, nous offrant une bonne dose de peur et d’excitation et des scènes d’anthologie (fosse aux serpents, course-poursuite dans des égouts où s’abritent les sans-logis, …).
Yeruldelgger est un roman policier très réussi se déroulant en Mongolie. Nous y découvrons sa capitale, Ourlan-Bator, et ses blocs soviétiques qui côtoient les gratte-ciel, ses immeubles en verre et ses égouts qui abritent tous les exclus venus s’y réchauffer. Nous y découvrons également ses forêts, ses plaines infinies et ses déserts que des touristes Coréens traversent à dos de quads en piétinant tout, êtres humains et traditions, sur leur passage. C’est dans un de ces paysages sublimes, sur une terre desséchée, que le cadavre d’une petite fille est retrouvée par des villageois. Le commissaire Yeruldelgger est appelé sur les lieux, et la vision des restes du cadavre de la fillette lui rappelle de bien douloureux souvenirs. En effet, ce commissaire meurtri a perdu sa propre fille lors d’une enquête, quand des criminels avides de s’emparer des terres mongoles l’ont enlevée afin que son père renonce à son enquête. Cinq ans plus tard, cette enquête sera alors pour lui vécue comme une chance de rédemption. Mais les cadavres de trois chinois retrouvés dans un entrepôt viennent compliquer la donne, et vont dans un premier temps reléguer au second plan l’enquête sur la petite fille.
Yeruldelgger parvient à nous fasciner pour cette terre inconnue, ses habitants, son histoire, les problèmes auxquels ils sont confrontés, et surtout les traditions omniprésentes qui en abritent le quotidien. Le roman nous emporte très vite dans sa course effrénée pour que vérité et justice soient faites, malgré la corruption qui semble un fléau bien pire que le crime, et malgré une modernité galopante qui risque d’emporter sur son passage beaucoup de souvenirs ancestraux. Les rebondissements sont nombreux et inattendus, nous offrant une bonne dose de peur et d’excitation et des scènes d’anthologie (fosse aux serpents, course-poursuite dans des égouts où s’abritent les sans-logis, …).

Outre-atlantique
Avis posté le 2013-08-27
- Triste
- Emouvant
- XXe siècle
Un puzzle émouvant
Outre-Atlantique est un roman en forme de poupée russe, ou plutôt, il fonctionne en nous livrant plusieurs poupées les unes après les autres sans nous expliquer immédiatement de quel jeu il s’agit. Du coup, nous sommes un peu perplexes au début du livre, et nous ne comprenons pas bien de quoi il est question. Mais peu à peu, nous réalisons que l’intrigue est en marche : quels sont les liens entre ces personnages si différents ? quel est cet homme dont la moitié de la tête fut arrachée durant la seconde guerre mondiale ? que s’est-il passé sur le champ de bataille ? Nous découvrons d’abord Martin, qui fut abandonné à une boulangère française lors de la Libération, et qui a suivi sa famille adoptive lorsque celle-ci a déménagé en Californie. Puis nous passons à Monsieur Hugo, que son visage arraché a isolé du monde, mais qui s’occupe de son petit voisin lorsque sa mère a trop de travail, et l’initie à la lecture. Il y a aussi cette jeune femme aveugle, dont le grand-père vit en Angleterre, et qui fut toute sa vie éperdument amoureux de sa femme, Harriet, même lorsqu’il faillit mourir sur le front. Quelles sont alors les relations entre tous ces personnages ? Si l’intention de l’auteur est assez floue au début, lorsque tout se met en place nous sommes à la fois saisis et émus par la beauté d’une telle reconstitution.
Outre-Atlantique parle de la guerre, d’une façon pudique et touchante. Il n’est pas question d’en décrire les atrocités, ou de faire vivre au lecteur des scènes violentes écrites mille fois. Certes, les événements évoqués sont parfois cruels, mais la cruauté est toujours passée lorsqu’elle entre en scène, le mal est un écho ou un une trace refroidie depuis longtemps. Tout a déjà eu lieu, et les personnages arrivent toujours après le pire, ce qui les sauve d’ailleurs, mais permet surtout à l’auteur de se concentrer sur autre chose, à savoir le lien entre les êtres, leur capacité à avancer malgré tout pour se reconnaître avant qu’il ne soit trop tard.
Il s’agit d’un roman qui a un peu de mal à nous captiver dès le début, mais qui se met en place lentement pour pouvoir enfin se révéler dans toute sa beauté.
Outre-Atlantique est un roman en forme de poupée russe, ou plutôt, il fonctionne en nous livrant plusieurs poupées les unes après les autres sans nous expliquer immédiatement de quel jeu il s’agit. Du coup, nous sommes un peu perplexes au début du livre, et nous ne comprenons pas bien de quoi il est question. Mais peu à peu, nous réalisons que l’intrigue est en marche : quels sont les liens entre ces personnages si différents ? quel est cet homme dont la moitié de la tête fut arrachée durant la seconde guerre mondiale ? que s’est-il passé sur le champ de bataille ? Nous découvrons d’abord Martin, qui fut abandonné à une boulangère française lors de la Libération, et qui a suivi sa famille adoptive lorsque celle-ci a déménagé en Californie. Puis nous passons à Monsieur Hugo, que son visage arraché a isolé du monde, mais qui s’occupe de son petit voisin lorsque sa mère a trop de travail, et l’initie à la lecture. Il y a aussi cette jeune femme aveugle, dont le grand-père vit en Angleterre, et qui fut toute sa vie éperdument amoureux de sa femme, Harriet, même lorsqu’il faillit mourir sur le front. Quelles sont alors les relations entre tous ces personnages ? Si l’intention de l’auteur est assez floue au début, lorsque tout se met en place nous sommes à la fois saisis et émus par la beauté d’une telle reconstitution.
Outre-Atlantique parle de la guerre, d’une façon pudique et touchante. Il n’est pas question d’en décrire les atrocités, ou de faire vivre au lecteur des scènes violentes écrites mille fois. Certes, les événements évoqués sont parfois cruels, mais la cruauté est toujours passée lorsqu’elle entre en scène, le mal est un écho ou un une trace refroidie depuis longtemps. Tout a déjà eu lieu, et les personnages arrivent toujours après le pire, ce qui les sauve d’ailleurs, mais permet surtout à l’auteur de se concentrer sur autre chose, à savoir le lien entre les êtres, leur capacité à avancer malgré tout pour se reconnaître avant qu’il ne soit trop tard.
Il s’agit d’un roman qui a un peu de mal à nous captiver dès le début, mais qui se met en place lentement pour pouvoir enfin se révéler dans toute sa beauté.

Lamb
Avis posté le 2013-08-26
- Emouvant
Roman troublant et dérangeant
Lamb, c’est le nom de famille du personnage principal qui restera, malgré quelques bribes de lui dévoilées peu à peu, profondément secret et mystérieux tout au long du roman. David Lamb a la cinquantaine et, alors qu’il vient d’enterrer son père, une très jeune fille vient lui demander une cigarette. Tout en elle, son accoutrement grossier, son corps recouvert de taches de rousseur, sa médiocrité palpable, attire l’attention de David, qui comprend immédiatement qu’elle est en train de se livrer à un défi, deux amies l’observant en ricanant. Mais il est agacé par ce petit jeu et, après lui avoir offert cette fameuse cigarette, et même tout le paquet, il l’enlève, pour lui faire peur, pour lui donner une bonne leçon, et pour d’autres obscures raisons. Lorsqu’il lui semble que Tommie, c’est le nom de l’enfant, a eu suffisamment peur pour comprendre la leçon, il la reconduit chez elle. Malgré cette expérience éprouvante, Tommie et Lamb vont tous deux chercher à se revoir et à se connaître.
Ainsi, dès le début du roman, le problème de la limite est posé avec clarté et profondeur. En effet, dès ce simulacre d’enlèvement, Bonnie Nadzam parvient à créer une atmosphère à la fois inquiétante et douce, obligeant le lecteur à craindre pour Tommie tout en respectant le plaisir que celle-ci prend dans la compagnie de cet homme nettement plus âgé qu’elle. Car le problème est là : Tommie n’a que onze ans. Que peut bien chercher Lamb en sa compagnie ? Est-il, car il faut énoncer le mot qui ne sera jamais évoqué dans le roman, bien que le risque principal soit plus que sous-entendu, un pédophile, un manipulateur qui parviendra, tel un Humbert Humbert du vingt-et-unième siècle, à gagner les faveurs de sa Lolita sans avoir jamais à la forcer ? Lamb est opaque, et ses desseins sont étranges. Est-il simplement fasciné et attendri par la fillette, savourant dangereusement en elle l’innocence qu’il a perdue ? Ou entretient-il des projets inavouables ? Quoi qu’il en soit, lorsque ce couple improbable décide de partir à l’aventure, une semaine ou plus, dans les montagnes, il devient impossible de ne pas être glacé par le projet, qui ne semble rien d’autre qu’un enlèvement consenti. Faut-il alors respecter le choix de la fillette, qui accepte librement de suivre Lamb, ou faut-il considérer tant celui-ci est beau-parleur, qu’il l’a déjà manipulée ?
Ce sont toutes ces questions qui font de Lamb un roman puissant et profond, à l’atmosphère inquiétante puisque le problème principal reste longtemps sous-jacent, comme une toile qui se refermerait lentement sur sa proie, selon les vœux de cette dernière. La subtilité de l’auteure est également admirable, celle-ci parvenant à aborder avec élégance un sujet profondément tabou, grâce à une écriture qui possède une grande puissance d’évocation.
Lamb, c’est le nom de famille du personnage principal qui restera, malgré quelques bribes de lui dévoilées peu à peu, profondément secret et mystérieux tout au long du roman. David Lamb a la cinquantaine et, alors qu’il vient d’enterrer son père, une très jeune fille vient lui demander une cigarette. Tout en elle, son accoutrement grossier, son corps recouvert de taches de rousseur, sa médiocrité palpable, attire l’attention de David, qui comprend immédiatement qu’elle est en train de se livrer à un défi, deux amies l’observant en ricanant. Mais il est agacé par ce petit jeu et, après lui avoir offert cette fameuse cigarette, et même tout le paquet, il l’enlève, pour lui faire peur, pour lui donner une bonne leçon, et pour d’autres obscures raisons. Lorsqu’il lui semble que Tommie, c’est le nom de l’enfant, a eu suffisamment peur pour comprendre la leçon, il la reconduit chez elle. Malgré cette expérience éprouvante, Tommie et Lamb vont tous deux chercher à se revoir et à se connaître.
Ainsi, dès le début du roman, le problème de la limite est posé avec clarté et profondeur. En effet, dès ce simulacre d’enlèvement, Bonnie Nadzam parvient à créer une atmosphère à la fois inquiétante et douce, obligeant le lecteur à craindre pour Tommie tout en respectant le plaisir que celle-ci prend dans la compagnie de cet homme nettement plus âgé qu’elle. Car le problème est là : Tommie n’a que onze ans. Que peut bien chercher Lamb en sa compagnie ? Est-il, car il faut énoncer le mot qui ne sera jamais évoqué dans le roman, bien que le risque principal soit plus que sous-entendu, un pédophile, un manipulateur qui parviendra, tel un Humbert Humbert du vingt-et-unième siècle, à gagner les faveurs de sa Lolita sans avoir jamais à la forcer ? Lamb est opaque, et ses desseins sont étranges. Est-il simplement fasciné et attendri par la fillette, savourant dangereusement en elle l’innocence qu’il a perdue ? Ou entretient-il des projets inavouables ? Quoi qu’il en soit, lorsque ce couple improbable décide de partir à l’aventure, une semaine ou plus, dans les montagnes, il devient impossible de ne pas être glacé par le projet, qui ne semble rien d’autre qu’un enlèvement consenti. Faut-il alors respecter le choix de la fillette, qui accepte librement de suivre Lamb, ou faut-il considérer tant celui-ci est beau-parleur, qu’il l’a déjà manipulée ?
Ce sont toutes ces questions qui font de Lamb un roman puissant et profond, à l’atmosphère inquiétante puisque le problème principal reste longtemps sous-jacent, comme une toile qui se refermerait lentement sur sa proie, selon les vœux de cette dernière. La subtilité de l’auteure est également admirable, celle-ci parvenant à aborder avec élégance un sujet profondément tabou, grâce à une écriture qui possède une grande puissance d’évocation.

Park Avenue
Avis posté le 2013-02-25
- Passionnant
- XXIe siècle
- New York
Un roman absolument passionnant
L’action de Park Avenue se déroule sur une petite semaine. Chaque chapitre traite des événements du point de vue d’un personnage plus ou moins proche des Darling, participant ainsi à l’accélération des événements qui vont bouleverser le destin de cette famille. Et progressivement, Park Avenue se lit comme une saga sur le destin d’une riche famille américaine, renouant ainsi avec un genre classique, à deux différences près. Cette saga se déroule en une semaine, et ce n’est que de façon très habile que Cristina Alger nous parle des origines de cette famille en faisant de brèves incursions dans le passé. La deuxième différence est qu’il s’agit d’une famille qui n’est pas confronté à une guerre, qu’elle soit de Sécession ou Mondiale, comme c’est le cas d’habitude mais à un événement économique, l’économie étant à l’époque contemporaine ce que la politique était à l’époque des O’hara, par exemple. Le rythme est également extrêmement intéressant, puisque nous sommes à la fois dans l’action et dans l’attente d’un dénouement incertain mais imminent, et dans le passé, celui des origines des grandes familles mais aussi celui de leur âge d’or. Richesse et faillite, pouvoir et chute, ces grands thèmes de la littérature sont ainsi revisités avec grand talent par Cristina Alger, qui sait les adapter avec une grande habileté au monde contemporain.
Il y a enfin la famille Darling elle-même, dont le nom, si bien choisi, exprime tout ce que Cristina Alger a voulu nous faire éprouver pour elle. Leurs riches propriétés, leur élégance, leur style, bref tous les signes extérieurs de richesse sont parfaitement décrits par l’auteur qui nous fait ainsi pénétrer un monde fermé dont nous sommes, le temps de cette lecture, un familier. Mais il y a également l’esprit de clan qui les caractérise, jusqu’à ce que les apparences s’effondrent. L’éducation des sœurs Darling, Lily et Merrill, est une éducation en vase clos, les parents veillant à ce qu’elles ne fréquentent que les meilleurs établissements, et ne sortent jamais du milieu très sélectif auquel elles appartiennent. Manhattan, où elles évoluent, est donc une cage dorée nous nous sont décrits les vices (le superflu, l’enfermement, la vanité), d’une façon qui, toutes proportions gardées (ou pas), m’a parfois rappelé la façon dont le grand Fitzgerald dépeignait la richesse de Gatsby. Car il y a du Fitzgerald dans cette famille Darling, leur style, leur aisance, et la sympathie naturelle que nous ne pouvons nous empêcher d’éprouver pour eux, en même temps que la fascination qu’ils inspirent, nous mettant parfois dans la peau d’un Nick Carraway.
Central Park est un énorme coup de cœur, un grand roman qui tout en dépeignant avec justesse un événement contemporain peu exploré, y relie des thèmes vibrants dans une atmosphère absolument envoûtante.
L’action de Park Avenue se déroule sur une petite semaine. Chaque chapitre traite des événements du point de vue d’un personnage plus ou moins proche des Darling, participant ainsi à l’accélération des événements qui vont bouleverser le destin de cette famille. Et progressivement, Park Avenue se lit comme une saga sur le destin d’une riche famille américaine, renouant ainsi avec un genre classique, à deux différences près. Cette saga se déroule en une semaine, et ce n’est que de façon très habile que Cristina Alger nous parle des origines de cette famille en faisant de brèves incursions dans le passé. La deuxième différence est qu’il s’agit d’une famille qui n’est pas confronté à une guerre, qu’elle soit de Sécession ou Mondiale, comme c’est le cas d’habitude mais à un événement économique, l’économie étant à l’époque contemporaine ce que la politique était à l’époque des O’hara, par exemple. Le rythme est également extrêmement intéressant, puisque nous sommes à la fois dans l’action et dans l’attente d’un dénouement incertain mais imminent, et dans le passé, celui des origines des grandes familles mais aussi celui de leur âge d’or. Richesse et faillite, pouvoir et chute, ces grands thèmes de la littérature sont ainsi revisités avec grand talent par Cristina Alger, qui sait les adapter avec une grande habileté au monde contemporain.
Il y a enfin la famille Darling elle-même, dont le nom, si bien choisi, exprime tout ce que Cristina Alger a voulu nous faire éprouver pour elle. Leurs riches propriétés, leur élégance, leur style, bref tous les signes extérieurs de richesse sont parfaitement décrits par l’auteur qui nous fait ainsi pénétrer un monde fermé dont nous sommes, le temps de cette lecture, un familier. Mais il y a également l’esprit de clan qui les caractérise, jusqu’à ce que les apparences s’effondrent. L’éducation des sœurs Darling, Lily et Merrill, est une éducation en vase clos, les parents veillant à ce qu’elles ne fréquentent que les meilleurs établissements, et ne sortent jamais du milieu très sélectif auquel elles appartiennent. Manhattan, où elles évoluent, est donc une cage dorée nous nous sont décrits les vices (le superflu, l’enfermement, la vanité), d’une façon qui, toutes proportions gardées (ou pas), m’a parfois rappelé la façon dont le grand Fitzgerald dépeignait la richesse de Gatsby. Car il y a du Fitzgerald dans cette famille Darling, leur style, leur aisance, et la sympathie naturelle que nous ne pouvons nous empêcher d’éprouver pour eux, en même temps que la fascination qu’ils inspirent, nous mettant parfois dans la peau d’un Nick Carraway.
Central Park est un énorme coup de cœur, un grand roman qui tout en dépeignant avec justesse un événement contemporain peu exploré, y relie des thèmes vibrants dans une atmosphère absolument envoûtante.