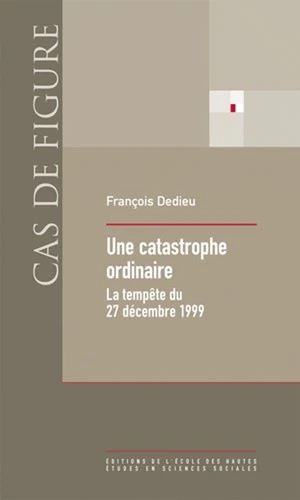François Dedieu est sociologue à l’institut de la recherche agronomique (Inra). Ses recherches portent sur les rapports entre organisations et production de savoirs dans le domaine des risques. L’étude du contrôle des risques induits par l’usage des pesticides en agriculture lui permet de s’intéresser à la construction de l’ignorance au sein des politiques publiques : à quelles conditions sociales, politiques et organisationnelles est-il possible de reconnaître les multiples dangers induits par les pesticides ? Quels sont ceux qui sont laissés durablement dans l’ombre et pourquoi ? Il enseigne à Sciences Po Paris (méthodologie qualitative), à l’Ecole Nationale des Ponts et chaussées (sociologie du risque, de l’ignorance) et à l’Agro Paris tech de Paris (sociologie des controverses).
Une catastrophe ordinaire. La tempête du 27 décembre 1999
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages232
- PrésentationBroché
- Poids0.268 kg
- Dimensions12,0 cm × 20,0 cm × 1,4 cm
- ISBN978-2-7132-2409-6
- EAN9782713224096
- Date de parution17/10/2013
- CollectionCas de figure
- ÉditeurEHESS
Résumé
Le 27 décembre 1999, la tempête surnommée "Martin" ravage le Sud-Ouest de la France et une partie du Sud de l'Europe. Alors même qu'il s'agit d'une catastrophe dite naturelle, se pose, parmi la société civile, la question des dysfonctionnements à l'origine de sa survenue. Les pouvoirs publics et les dispositifs officiels de protection civile sont montrés du doigt. En conséquence, des mesures sont prises afin de remédier à ces "carences".
Sommes-nous pour autant mieux protégés ? Analysant les dispositifs de sécurité civile durant les deux phases de l'épisode, l'alerte et la gestion de la crise, François Dedieu avance une interprétation à contre-courant de l'idéologie dominante de lacunes des systèmes d'alertes météorologiques à travers la notion de "risque scélérat". Si les acteurs n'ont pas pu agir en conséquences, c'est qu'ils ont été trompés par l'apparence familière du phénomène.
Il montre ensuite que c'est le désordre qui règne dans la phase d'urgence qui permet d'expliquer paradoxalement pourquoi les secours ont pu résoudre aussi rapidement la crise provoquée par les dégâts de la tempête. Enfin, et à partir de la notion d'accident total, il propose plus généralement d'expliquer l'origine de ces catastrophes non pas à partir des carences de la sécurité civile mais à partir d'une conjonction de circonstances défavorables (défaillances techniques, décision tardive, convergence défavorable d'éléments naturels etc) qui en s'accumulant conduisent progressivement à la catastrophe.
Sommes-nous pour autant mieux protégés ? Analysant les dispositifs de sécurité civile durant les deux phases de l'épisode, l'alerte et la gestion de la crise, François Dedieu avance une interprétation à contre-courant de l'idéologie dominante de lacunes des systèmes d'alertes météorologiques à travers la notion de "risque scélérat". Si les acteurs n'ont pas pu agir en conséquences, c'est qu'ils ont été trompés par l'apparence familière du phénomène.
Il montre ensuite que c'est le désordre qui règne dans la phase d'urgence qui permet d'expliquer paradoxalement pourquoi les secours ont pu résoudre aussi rapidement la crise provoquée par les dégâts de la tempête. Enfin, et à partir de la notion d'accident total, il propose plus généralement d'expliquer l'origine de ces catastrophes non pas à partir des carences de la sécurité civile mais à partir d'une conjonction de circonstances défavorables (défaillances techniques, décision tardive, convergence défavorable d'éléments naturels etc) qui en s'accumulant conduisent progressivement à la catastrophe.
Le 27 décembre 1999, la tempête surnommée "Martin" ravage le Sud-Ouest de la France et une partie du Sud de l'Europe. Alors même qu'il s'agit d'une catastrophe dite naturelle, se pose, parmi la société civile, la question des dysfonctionnements à l'origine de sa survenue. Les pouvoirs publics et les dispositifs officiels de protection civile sont montrés du doigt. En conséquence, des mesures sont prises afin de remédier à ces "carences".
Sommes-nous pour autant mieux protégés ? Analysant les dispositifs de sécurité civile durant les deux phases de l'épisode, l'alerte et la gestion de la crise, François Dedieu avance une interprétation à contre-courant de l'idéologie dominante de lacunes des systèmes d'alertes météorologiques à travers la notion de "risque scélérat". Si les acteurs n'ont pas pu agir en conséquences, c'est qu'ils ont été trompés par l'apparence familière du phénomène.
Il montre ensuite que c'est le désordre qui règne dans la phase d'urgence qui permet d'expliquer paradoxalement pourquoi les secours ont pu résoudre aussi rapidement la crise provoquée par les dégâts de la tempête. Enfin, et à partir de la notion d'accident total, il propose plus généralement d'expliquer l'origine de ces catastrophes non pas à partir des carences de la sécurité civile mais à partir d'une conjonction de circonstances défavorables (défaillances techniques, décision tardive, convergence défavorable d'éléments naturels etc) qui en s'accumulant conduisent progressivement à la catastrophe.
Sommes-nous pour autant mieux protégés ? Analysant les dispositifs de sécurité civile durant les deux phases de l'épisode, l'alerte et la gestion de la crise, François Dedieu avance une interprétation à contre-courant de l'idéologie dominante de lacunes des systèmes d'alertes météorologiques à travers la notion de "risque scélérat". Si les acteurs n'ont pas pu agir en conséquences, c'est qu'ils ont été trompés par l'apparence familière du phénomène.
Il montre ensuite que c'est le désordre qui règne dans la phase d'urgence qui permet d'expliquer paradoxalement pourquoi les secours ont pu résoudre aussi rapidement la crise provoquée par les dégâts de la tempête. Enfin, et à partir de la notion d'accident total, il propose plus généralement d'expliquer l'origine de ces catastrophes non pas à partir des carences de la sécurité civile mais à partir d'une conjonction de circonstances défavorables (défaillances techniques, décision tardive, convergence défavorable d'éléments naturels etc) qui en s'accumulant conduisent progressivement à la catastrophe.