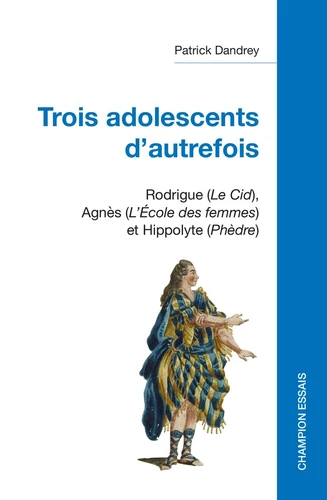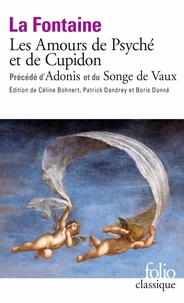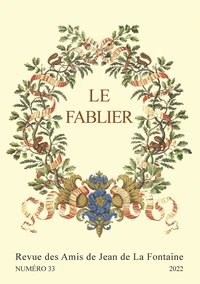Trois adolescents d'autrefois. Rodrigue (Le Cid), Agnès (L'Ecole des femmes) et Hippolyte (Phèdre)
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages204
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.36 kg
- Dimensions13,0 cm × 20,0 cm × 1,2 cm
- ISBN978-2-7453-5742-7
- EAN9782745357427
- Date de parution27/09/2021
- CollectionEssais
- ÉditeurHonoré Champion
Résumé
Peut-être parce qu'on s'est accoutumé à les voir incarnés à la scène par des comédiens plus âgés que leurs rôles, Rodrigue, Agnès et Hippolyte, héros de trois chefs-d'oeuvre parmi les plus vivants et les plus puissants du théâtre français, se caractérisent par un trait commun qu'on a trop oublié : ce sont des adolescents. Soumis à des figures adultes dont ils subissent les injonctions contradictoires et les passions mal maîtrisées, ils sortent de l'enfance assujettie et prétendent à une reconnaissance comme sujets de plein droit, comme sujets adultes : cette transition, c'est ce que nous nommons adolescence.
Mais au XVIIe siècle l'adolescence ne constitue pas une tranche de vie identifiée et autonome : on y entre et on en sort par phases décousues, par "tuilage". L'oeuvre dramatique aurait-elle donc pour tâche de combler ce vide, de dire cette béance, de revendiquer cette reconnaissance ? En relisant dans cette optique inédite ces trois pièces, on les redécouvre : toujours neuves et étonnamment méconnues.
Mais au XVIIe siècle l'adolescence ne constitue pas une tranche de vie identifiée et autonome : on y entre et on en sort par phases décousues, par "tuilage". L'oeuvre dramatique aurait-elle donc pour tâche de combler ce vide, de dire cette béance, de revendiquer cette reconnaissance ? En relisant dans cette optique inédite ces trois pièces, on les redécouvre : toujours neuves et étonnamment méconnues.
Peut-être parce qu'on s'est accoutumé à les voir incarnés à la scène par des comédiens plus âgés que leurs rôles, Rodrigue, Agnès et Hippolyte, héros de trois chefs-d'oeuvre parmi les plus vivants et les plus puissants du théâtre français, se caractérisent par un trait commun qu'on a trop oublié : ce sont des adolescents. Soumis à des figures adultes dont ils subissent les injonctions contradictoires et les passions mal maîtrisées, ils sortent de l'enfance assujettie et prétendent à une reconnaissance comme sujets de plein droit, comme sujets adultes : cette transition, c'est ce que nous nommons adolescence.
Mais au XVIIe siècle l'adolescence ne constitue pas une tranche de vie identifiée et autonome : on y entre et on en sort par phases décousues, par "tuilage". L'oeuvre dramatique aurait-elle donc pour tâche de combler ce vide, de dire cette béance, de revendiquer cette reconnaissance ? En relisant dans cette optique inédite ces trois pièces, on les redécouvre : toujours neuves et étonnamment méconnues.
Mais au XVIIe siècle l'adolescence ne constitue pas une tranche de vie identifiée et autonome : on y entre et on en sort par phases décousues, par "tuilage". L'oeuvre dramatique aurait-elle donc pour tâche de combler ce vide, de dire cette béance, de revendiquer cette reconnaissance ? En relisant dans cette optique inédite ces trois pièces, on les redécouvre : toujours neuves et étonnamment méconnues.