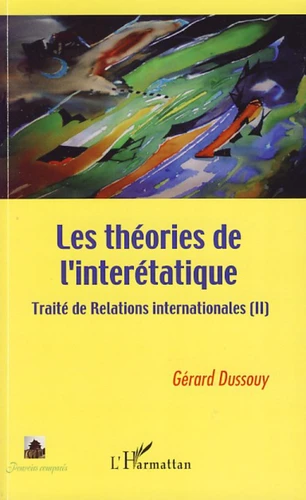Traité de relations internationales. Tome 2, Les théories de l'interétatique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages351
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.375 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 2,5 cm
- ISBN978-2-296-04592-7
- EAN9782296045927
- Date de parution01/11/2007
- CollectionPouvoirs comparés
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Comme dans le tome précédent consacré aux théories géopolitiques, Gérard Dussouy se livre à une analyse particulièrement précise et innovante des théories de la science politique centrées sur les relations entre les Etats, qui sont majoritairement anglo-américaines. Sans qu'il y ait lieu de tout confondre, l'école anglaise, plus pragmatique, mérite d'être connue. L'auteur met en perspective les contextes et les enjeux qui les conditionnent, après avoir analysé les origines, l'évolution et les mutations de leur acteur unique, l'Etat.
Il relativise ces théories les unes par rapport aux autres, sachant qu'aucune, en soi, ne saurait être une "copie du réel". Il peut ainsi mettre en valeur leurs limites, parfois leurs errements quand elles se veulent par trop prescriptives, comme celles de la mouvance néo-kantienne à la mode. Mais il saisit aussi des complémentarités qui, au-delà des préjugés des théoriciens, sont susceptibles de contribuer à une modélisation systémique du monde des Etats, à laquelle l'immense majorité d'entre eux aspirent.
Il montre alors le caractère toujours central de la puissance, sous ses faces multiples, que les tenants de la "construction sociale de la réalité" internationale, rendus à l'évidence, finissent eux-mêmes par réintégrer après l'avoir proscrite. Enfin, en incluant une présentation inédite des théories traditionnelles chinoises, ce traité apparaît sans doute comme l'un des plus achevés sur la problématique du système international.
Un dernier tome suivra qui abordera enfin les théories de la mondialisation.
Il relativise ces théories les unes par rapport aux autres, sachant qu'aucune, en soi, ne saurait être une "copie du réel". Il peut ainsi mettre en valeur leurs limites, parfois leurs errements quand elles se veulent par trop prescriptives, comme celles de la mouvance néo-kantienne à la mode. Mais il saisit aussi des complémentarités qui, au-delà des préjugés des théoriciens, sont susceptibles de contribuer à une modélisation systémique du monde des Etats, à laquelle l'immense majorité d'entre eux aspirent.
Il montre alors le caractère toujours central de la puissance, sous ses faces multiples, que les tenants de la "construction sociale de la réalité" internationale, rendus à l'évidence, finissent eux-mêmes par réintégrer après l'avoir proscrite. Enfin, en incluant une présentation inédite des théories traditionnelles chinoises, ce traité apparaît sans doute comme l'un des plus achevés sur la problématique du système international.
Un dernier tome suivra qui abordera enfin les théories de la mondialisation.
Comme dans le tome précédent consacré aux théories géopolitiques, Gérard Dussouy se livre à une analyse particulièrement précise et innovante des théories de la science politique centrées sur les relations entre les Etats, qui sont majoritairement anglo-américaines. Sans qu'il y ait lieu de tout confondre, l'école anglaise, plus pragmatique, mérite d'être connue. L'auteur met en perspective les contextes et les enjeux qui les conditionnent, après avoir analysé les origines, l'évolution et les mutations de leur acteur unique, l'Etat.
Il relativise ces théories les unes par rapport aux autres, sachant qu'aucune, en soi, ne saurait être une "copie du réel". Il peut ainsi mettre en valeur leurs limites, parfois leurs errements quand elles se veulent par trop prescriptives, comme celles de la mouvance néo-kantienne à la mode. Mais il saisit aussi des complémentarités qui, au-delà des préjugés des théoriciens, sont susceptibles de contribuer à une modélisation systémique du monde des Etats, à laquelle l'immense majorité d'entre eux aspirent.
Il montre alors le caractère toujours central de la puissance, sous ses faces multiples, que les tenants de la "construction sociale de la réalité" internationale, rendus à l'évidence, finissent eux-mêmes par réintégrer après l'avoir proscrite. Enfin, en incluant une présentation inédite des théories traditionnelles chinoises, ce traité apparaît sans doute comme l'un des plus achevés sur la problématique du système international.
Un dernier tome suivra qui abordera enfin les théories de la mondialisation.
Il relativise ces théories les unes par rapport aux autres, sachant qu'aucune, en soi, ne saurait être une "copie du réel". Il peut ainsi mettre en valeur leurs limites, parfois leurs errements quand elles se veulent par trop prescriptives, comme celles de la mouvance néo-kantienne à la mode. Mais il saisit aussi des complémentarités qui, au-delà des préjugés des théoriciens, sont susceptibles de contribuer à une modélisation systémique du monde des Etats, à laquelle l'immense majorité d'entre eux aspirent.
Il montre alors le caractère toujours central de la puissance, sous ses faces multiples, que les tenants de la "construction sociale de la réalité" internationale, rendus à l'évidence, finissent eux-mêmes par réintégrer après l'avoir proscrite. Enfin, en incluant une présentation inédite des théories traditionnelles chinoises, ce traité apparaît sans doute comme l'un des plus achevés sur la problématique du système international.
Un dernier tome suivra qui abordera enfin les théories de la mondialisation.