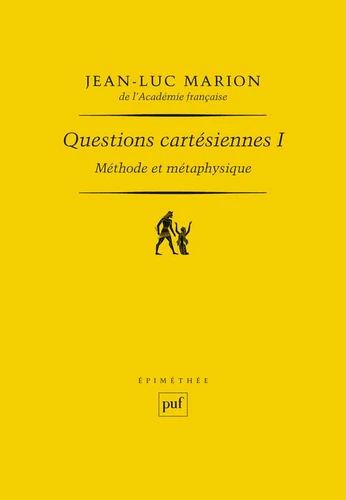Questions cartésiennes. Méthode et métaphysique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages266
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.358 kg
- Dimensions15,0 cm × 21,8 cm × 1,9 cm
- ISBN978-2-13-083046-7
- EAN9782130830467
- Date de parution05/10/2021
- CollectionEpiméthée
- ÉditeurPUF
Résumé
En deçà des thèses, qui visent à la cohérence, demeurent, comme des sources cachées mais vitales, des questions toujours ouvertes. Ce sont certaines de ces questions récurrentes dans les études cartésiennes qui sont abordées ici, chacune pour elle-même, mais en dialogue constant avec la tradition des grands interprètes. Pourquoi le philosophe de l'évidence commence-t-il à penser en faisant trois rêves - et en les interprétant sans même se réveiller ? Pourquoi et jusqu'où le Discours de la méthode ne livre-t-il pas exactement la même métaphysique que celle des Meditationes ? En quoi et jusqu'où les Meditationes respectent-elles la méthode ? Le "sujet" cartésien se définit-il par une thèse théologique au moment précis où il prétend "mettre à part les vérités de la foi" ? Pourquoi la générosité semble-t-elle devoir répéter le "je pense" sur le mode de l'auto-affection ? Pourquoi Descartes ne parvient-il finalement pas à reconnaître un alter ego à l'ego et ferme-t-il la possibilité de tout accès à l'autre ? L'argument dit ontologique appartient-il encore à une ontothéo-logie avant et après Descartes ? Ces recherches dont le fil directeur est une enquête sur la méthode et la métaphysique attestent que les soubassements historiques et les conséquences modernes, voire post-modernes, de Descartes restent encore, pour une large part, à déceler et à mesurer.
Car nous ne pouvons étudier seulement Descartes comme un objet : nous en provenons. Même pour s'en défaire, il faut encore y revenir.
Car nous ne pouvons étudier seulement Descartes comme un objet : nous en provenons. Même pour s'en défaire, il faut encore y revenir.
En deçà des thèses, qui visent à la cohérence, demeurent, comme des sources cachées mais vitales, des questions toujours ouvertes. Ce sont certaines de ces questions récurrentes dans les études cartésiennes qui sont abordées ici, chacune pour elle-même, mais en dialogue constant avec la tradition des grands interprètes. Pourquoi le philosophe de l'évidence commence-t-il à penser en faisant trois rêves - et en les interprétant sans même se réveiller ? Pourquoi et jusqu'où le Discours de la méthode ne livre-t-il pas exactement la même métaphysique que celle des Meditationes ? En quoi et jusqu'où les Meditationes respectent-elles la méthode ? Le "sujet" cartésien se définit-il par une thèse théologique au moment précis où il prétend "mettre à part les vérités de la foi" ? Pourquoi la générosité semble-t-elle devoir répéter le "je pense" sur le mode de l'auto-affection ? Pourquoi Descartes ne parvient-il finalement pas à reconnaître un alter ego à l'ego et ferme-t-il la possibilité de tout accès à l'autre ? L'argument dit ontologique appartient-il encore à une ontothéo-logie avant et après Descartes ? Ces recherches dont le fil directeur est une enquête sur la méthode et la métaphysique attestent que les soubassements historiques et les conséquences modernes, voire post-modernes, de Descartes restent encore, pour une large part, à déceler et à mesurer.
Car nous ne pouvons étudier seulement Descartes comme un objet : nous en provenons. Même pour s'en défaire, il faut encore y revenir.
Car nous ne pouvons étudier seulement Descartes comme un objet : nous en provenons. Même pour s'en défaire, il faut encore y revenir.