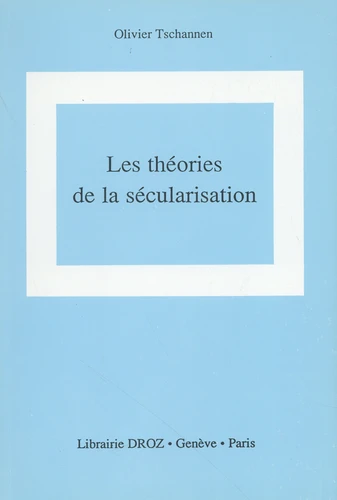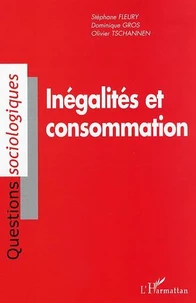Les théories de la sécularisation
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages408
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.555 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 2,5 cm
- ISBN2-600-04128-1
- EAN9782600041287
- Date de parution01/01/1992
- CollectionTravaux de sciences sociales
- ÉditeurDroz
Résumé
Le problème de la sécularisation a suscité une littérature sociologique abondante et variée. Pourtant, jusqu'ici, aucune étude systématique de l'histoire intellectuelle de cette thématique n'avait été entreprise. C'est cette lacune que se propose de combler l'ouvrage que voici. On considère généralement les fondateurs de la sociologie (surtout Weber, parfois aussi Comte, voire Spencer) comme les "pères" de la thèse de la sécularisation.
Mais la comparaison de leurs théories avec celles défendues par les auteurs modernes fait surtout apparaître leur caractère fragmentaire, morcelé : plus que de théories de la sécularisation, il s'agit d'esquisses, de pistes à explorer. Le chemin qui conduit de ces formulations aux théories modernes est long et sinueux : il passe par de nombreux auteurs américains (Ward, Sumner, etc.) et ne saurait se comprendre sans tenir compte de l'influence des cadres institutionnels (notamment des associations professionnelles) et de leurs transformations.
On montrera notamment le rôle joué, dans ce processus, parla sociologie catholique européenne, ainsi que par certains débats théologiques. Aujourd'hui, en dépit des apparences, la notion de sécularisation jouit en sociologie d'une hégémonie intellectuelle qui permet de l'apparenter à un paradigme - au sens kuhnien du terme. La dominance de ce modèle est telle que tout le monde - même les plus virulents pourfendeurs de "la théorie de la sécularisation" - parle son langage.
Bien entendu, cela ne signifie pas que le paradigme doive être considéré comme définitif : il souffre au contraire d'insuffisances évidentes. Si nous voulons un jour le dépasser, nous devons d'abord en reconnaître l'existence et le pouvoir, plutôt que de tenter de l'exorciser par de purs artifices verbaux.
Mais la comparaison de leurs théories avec celles défendues par les auteurs modernes fait surtout apparaître leur caractère fragmentaire, morcelé : plus que de théories de la sécularisation, il s'agit d'esquisses, de pistes à explorer. Le chemin qui conduit de ces formulations aux théories modernes est long et sinueux : il passe par de nombreux auteurs américains (Ward, Sumner, etc.) et ne saurait se comprendre sans tenir compte de l'influence des cadres institutionnels (notamment des associations professionnelles) et de leurs transformations.
On montrera notamment le rôle joué, dans ce processus, parla sociologie catholique européenne, ainsi que par certains débats théologiques. Aujourd'hui, en dépit des apparences, la notion de sécularisation jouit en sociologie d'une hégémonie intellectuelle qui permet de l'apparenter à un paradigme - au sens kuhnien du terme. La dominance de ce modèle est telle que tout le monde - même les plus virulents pourfendeurs de "la théorie de la sécularisation" - parle son langage.
Bien entendu, cela ne signifie pas que le paradigme doive être considéré comme définitif : il souffre au contraire d'insuffisances évidentes. Si nous voulons un jour le dépasser, nous devons d'abord en reconnaître l'existence et le pouvoir, plutôt que de tenter de l'exorciser par de purs artifices verbaux.
Le problème de la sécularisation a suscité une littérature sociologique abondante et variée. Pourtant, jusqu'ici, aucune étude systématique de l'histoire intellectuelle de cette thématique n'avait été entreprise. C'est cette lacune que se propose de combler l'ouvrage que voici. On considère généralement les fondateurs de la sociologie (surtout Weber, parfois aussi Comte, voire Spencer) comme les "pères" de la thèse de la sécularisation.
Mais la comparaison de leurs théories avec celles défendues par les auteurs modernes fait surtout apparaître leur caractère fragmentaire, morcelé : plus que de théories de la sécularisation, il s'agit d'esquisses, de pistes à explorer. Le chemin qui conduit de ces formulations aux théories modernes est long et sinueux : il passe par de nombreux auteurs américains (Ward, Sumner, etc.) et ne saurait se comprendre sans tenir compte de l'influence des cadres institutionnels (notamment des associations professionnelles) et de leurs transformations.
On montrera notamment le rôle joué, dans ce processus, parla sociologie catholique européenne, ainsi que par certains débats théologiques. Aujourd'hui, en dépit des apparences, la notion de sécularisation jouit en sociologie d'une hégémonie intellectuelle qui permet de l'apparenter à un paradigme - au sens kuhnien du terme. La dominance de ce modèle est telle que tout le monde - même les plus virulents pourfendeurs de "la théorie de la sécularisation" - parle son langage.
Bien entendu, cela ne signifie pas que le paradigme doive être considéré comme définitif : il souffre au contraire d'insuffisances évidentes. Si nous voulons un jour le dépasser, nous devons d'abord en reconnaître l'existence et le pouvoir, plutôt que de tenter de l'exorciser par de purs artifices verbaux.
Mais la comparaison de leurs théories avec celles défendues par les auteurs modernes fait surtout apparaître leur caractère fragmentaire, morcelé : plus que de théories de la sécularisation, il s'agit d'esquisses, de pistes à explorer. Le chemin qui conduit de ces formulations aux théories modernes est long et sinueux : il passe par de nombreux auteurs américains (Ward, Sumner, etc.) et ne saurait se comprendre sans tenir compte de l'influence des cadres institutionnels (notamment des associations professionnelles) et de leurs transformations.
On montrera notamment le rôle joué, dans ce processus, parla sociologie catholique européenne, ainsi que par certains débats théologiques. Aujourd'hui, en dépit des apparences, la notion de sécularisation jouit en sociologie d'une hégémonie intellectuelle qui permet de l'apparenter à un paradigme - au sens kuhnien du terme. La dominance de ce modèle est telle que tout le monde - même les plus virulents pourfendeurs de "la théorie de la sécularisation" - parle son langage.
Bien entendu, cela ne signifie pas que le paradigme doive être considéré comme définitif : il souffre au contraire d'insuffisances évidentes. Si nous voulons un jour le dépasser, nous devons d'abord en reconnaître l'existence et le pouvoir, plutôt que de tenter de l'exorciser par de purs artifices verbaux.