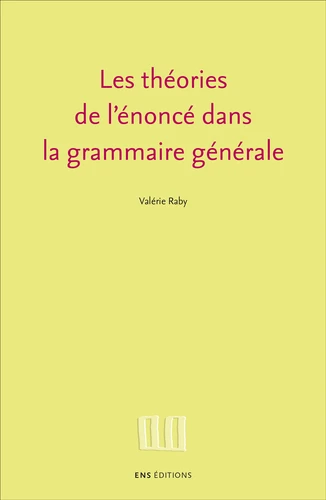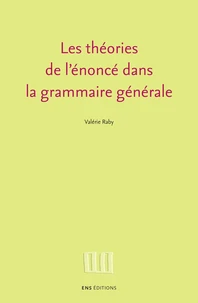Les théories de l'énoncé dans la grammaire générale
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages256
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.425 kg
- Dimensions15,0 cm × 23,0 cm × 1,5 cm
- ISBN978-2-84788-697-9
- EAN9782847886979
- Date de parution21/04/2018
- CollectionLangages
- ÉditeurENS (Editions)
Résumé
Cet ouvrage, inscrit dans le champ de l'histoire et de l'épistémologie des idées linguistiques, propose une enquête historique sur la constitution de l'énoncé comme niveau d'analyse pertinent pour les théories linguistiques. Enoncé est ici un terme générique désignant une séquence linguistique perçue comme complète, supérieure au mot, et qui forme - au moins intuitivement et empiriquement - une unité de la communication.
Les grammaires générales et françaises des xviie et xviiie siècles thématisent l'énoncé et en font la théorie, au moyen d'un réseau terminologique et notionnel associant proposition, période, phrase, unités alternativement conçues comme concurrentes, redondantes ou complémentaires. Cette étude s'attache aux modalités d'élaboration d'un statut syntaxique pour ces unités, ainsi qu'à la transformation du domaine d'objets de la grammaire qui en a résulté.
Elle fournit les matériaux utiles à la saisie historique de notions toujours présentes dans le champ syntaxique contemporain, mobilisées aussi bien par les savoirs de spécialité que par la culture scolaire.
Les grammaires générales et françaises des xviie et xviiie siècles thématisent l'énoncé et en font la théorie, au moyen d'un réseau terminologique et notionnel associant proposition, période, phrase, unités alternativement conçues comme concurrentes, redondantes ou complémentaires. Cette étude s'attache aux modalités d'élaboration d'un statut syntaxique pour ces unités, ainsi qu'à la transformation du domaine d'objets de la grammaire qui en a résulté.
Elle fournit les matériaux utiles à la saisie historique de notions toujours présentes dans le champ syntaxique contemporain, mobilisées aussi bien par les savoirs de spécialité que par la culture scolaire.
Cet ouvrage, inscrit dans le champ de l'histoire et de l'épistémologie des idées linguistiques, propose une enquête historique sur la constitution de l'énoncé comme niveau d'analyse pertinent pour les théories linguistiques. Enoncé est ici un terme générique désignant une séquence linguistique perçue comme complète, supérieure au mot, et qui forme - au moins intuitivement et empiriquement - une unité de la communication.
Les grammaires générales et françaises des xviie et xviiie siècles thématisent l'énoncé et en font la théorie, au moyen d'un réseau terminologique et notionnel associant proposition, période, phrase, unités alternativement conçues comme concurrentes, redondantes ou complémentaires. Cette étude s'attache aux modalités d'élaboration d'un statut syntaxique pour ces unités, ainsi qu'à la transformation du domaine d'objets de la grammaire qui en a résulté.
Elle fournit les matériaux utiles à la saisie historique de notions toujours présentes dans le champ syntaxique contemporain, mobilisées aussi bien par les savoirs de spécialité que par la culture scolaire.
Les grammaires générales et françaises des xviie et xviiie siècles thématisent l'énoncé et en font la théorie, au moyen d'un réseau terminologique et notionnel associant proposition, période, phrase, unités alternativement conçues comme concurrentes, redondantes ou complémentaires. Cette étude s'attache aux modalités d'élaboration d'un statut syntaxique pour ces unités, ainsi qu'à la transformation du domaine d'objets de la grammaire qui en a résulté.
Elle fournit les matériaux utiles à la saisie historique de notions toujours présentes dans le champ syntaxique contemporain, mobilisées aussi bien par les savoirs de spécialité que par la culture scolaire.