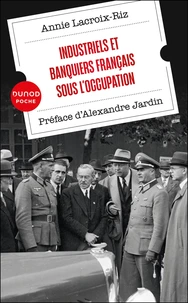Les protectorats d'Afrique du Nord entre la France et Washington. Maroc et Tunisie
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages262
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.492 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,4 cm
- ISBN2-7384-0031-0
- EAN9782738400314
- Date de parution01/01/1988
- CollectionHistoire et perspectives médit
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Pendant plusieurs décennies, la France a pu sembler échapper au sort commun de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, que Washington incita fermement à lâcher, après 1945, leur plantureux empire colonial : le non-recours aux archives explique seul le long maintien d'une thèse faisant de l'Etat américain "le spectateur amical, mais demeurant à l'écart, de l'indépendance africaine" (Stephen Ambrose). L'ouverture de la documentation originale (particulièrement les fonds du Quay d'Orsay) autorise une approche radicalement nouvelle des circonstances de l'accession de l'Afrique du Nord à l'indépendance.
Quel rôle les objectifs de la "Porte ouverte" - incompatibles avec l'exclusivisme du Pacte colonial - ont-ils joué dans l'anticolonialisme américain ? Quels efforts les dirigeants français ont-ils déployés pour allonger le "sursis" que la guerre froide succédant promptement à la guerre impartit au colonialisme ? Quelle part faut-il attribuer, chez les alliés adversaires, à la hantise, si souvent feinte, du communisme ? Grâce à quel atout précieux et particulier les Français ont-ils "lâché" les protectorats du Maghreb si tard - près de dix ans après les Britanniques ou les Néerlandais ? Peut-on accorder quelque crédit à l'hypothèse d'une rupture entre la position des démocrates et celle des républicains, à l'égard des possessions coloniales de leurs alliés.
Telles sont les questions fondamentales auxquelles permettent de commencer à répondre, sur la base d'éléments sérieux, les dossiers consultés pour la première fois. Ils éloignent résolument le lecteur de la description du traditionnel tête-à-tête entre les nationalistes musulmans et un colonialisme français incapable de comprendre l'inéluctable nécessité du départ (ou disposé au "divorce" sans oser l'avouer).
Quel rôle les objectifs de la "Porte ouverte" - incompatibles avec l'exclusivisme du Pacte colonial - ont-ils joué dans l'anticolonialisme américain ? Quels efforts les dirigeants français ont-ils déployés pour allonger le "sursis" que la guerre froide succédant promptement à la guerre impartit au colonialisme ? Quelle part faut-il attribuer, chez les alliés adversaires, à la hantise, si souvent feinte, du communisme ? Grâce à quel atout précieux et particulier les Français ont-ils "lâché" les protectorats du Maghreb si tard - près de dix ans après les Britanniques ou les Néerlandais ? Peut-on accorder quelque crédit à l'hypothèse d'une rupture entre la position des démocrates et celle des républicains, à l'égard des possessions coloniales de leurs alliés.
Telles sont les questions fondamentales auxquelles permettent de commencer à répondre, sur la base d'éléments sérieux, les dossiers consultés pour la première fois. Ils éloignent résolument le lecteur de la description du traditionnel tête-à-tête entre les nationalistes musulmans et un colonialisme français incapable de comprendre l'inéluctable nécessité du départ (ou disposé au "divorce" sans oser l'avouer).
Pendant plusieurs décennies, la France a pu sembler échapper au sort commun de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, que Washington incita fermement à lâcher, après 1945, leur plantureux empire colonial : le non-recours aux archives explique seul le long maintien d'une thèse faisant de l'Etat américain "le spectateur amical, mais demeurant à l'écart, de l'indépendance africaine" (Stephen Ambrose). L'ouverture de la documentation originale (particulièrement les fonds du Quay d'Orsay) autorise une approche radicalement nouvelle des circonstances de l'accession de l'Afrique du Nord à l'indépendance.
Quel rôle les objectifs de la "Porte ouverte" - incompatibles avec l'exclusivisme du Pacte colonial - ont-ils joué dans l'anticolonialisme américain ? Quels efforts les dirigeants français ont-ils déployés pour allonger le "sursis" que la guerre froide succédant promptement à la guerre impartit au colonialisme ? Quelle part faut-il attribuer, chez les alliés adversaires, à la hantise, si souvent feinte, du communisme ? Grâce à quel atout précieux et particulier les Français ont-ils "lâché" les protectorats du Maghreb si tard - près de dix ans après les Britanniques ou les Néerlandais ? Peut-on accorder quelque crédit à l'hypothèse d'une rupture entre la position des démocrates et celle des républicains, à l'égard des possessions coloniales de leurs alliés.
Telles sont les questions fondamentales auxquelles permettent de commencer à répondre, sur la base d'éléments sérieux, les dossiers consultés pour la première fois. Ils éloignent résolument le lecteur de la description du traditionnel tête-à-tête entre les nationalistes musulmans et un colonialisme français incapable de comprendre l'inéluctable nécessité du départ (ou disposé au "divorce" sans oser l'avouer).
Quel rôle les objectifs de la "Porte ouverte" - incompatibles avec l'exclusivisme du Pacte colonial - ont-ils joué dans l'anticolonialisme américain ? Quels efforts les dirigeants français ont-ils déployés pour allonger le "sursis" que la guerre froide succédant promptement à la guerre impartit au colonialisme ? Quelle part faut-il attribuer, chez les alliés adversaires, à la hantise, si souvent feinte, du communisme ? Grâce à quel atout précieux et particulier les Français ont-ils "lâché" les protectorats du Maghreb si tard - près de dix ans après les Britanniques ou les Néerlandais ? Peut-on accorder quelque crédit à l'hypothèse d'une rupture entre la position des démocrates et celle des républicains, à l'égard des possessions coloniales de leurs alliés.
Telles sont les questions fondamentales auxquelles permettent de commencer à répondre, sur la base d'éléments sérieux, les dossiers consultés pour la première fois. Ils éloignent résolument le lecteur de la description du traditionnel tête-à-tête entre les nationalistes musulmans et un colonialisme français incapable de comprendre l'inéluctable nécessité du départ (ou disposé au "divorce" sans oser l'avouer).