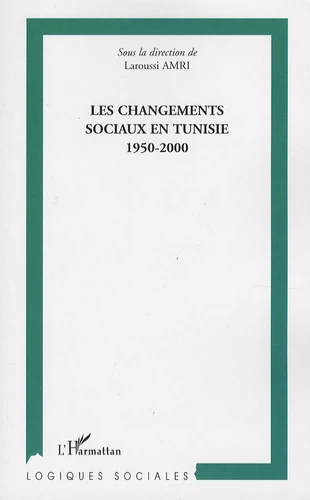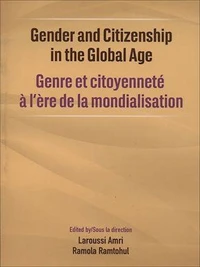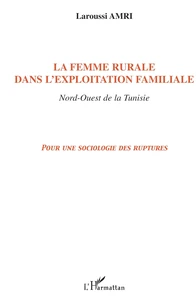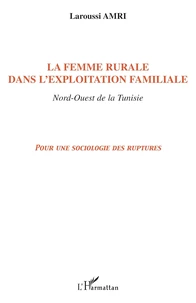Les changements sociaux en Tunisie. 1950-2000
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages331
- PrésentationBroché
- Poids0.46 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
- ISBN978-2-296-04310-7
- EAN9782296043107
- Date de parution01/10/2007
- CollectionLogiques sociales
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Le changement social se confond-il avec le développement que s'assigne consciemment une société sous la férule directrice de son élite ? Quelle est la part de la planification, de la prédictibilité, de la centralisation ? Quelle est la part de l'inattendu, du foisonnant, de l'anarchique et du divergent ? Quelle bonne part du social s'assurent l'en bas et l'en haut ? Quelle est la part du tangible pour jauger les évolutions que connaît une société, quelle est la part du souterrain, de l'informel, et même de l'ambigu et du paradoxal ? La rationalité, y compris économique, le positivisme régi par le paradigme du chiffre, ont-ils, à eux seuls, suffi pour couvrir le champ des actions des hommes en interaction sociale durant un demi-siècle de bruit et de fureur, de mouvements sociaux, mais aussi de fulgurances individuelles, tout aussi bien dans le domaine ordinaire de la vie quotidienne que du domaine extraordinaire de l'art ? Quelle est la part de l'environnement extérieur, quel est le poids des forces internes à l'œuvre dans le changement social qui régit la marche d'une société ? C'est pour répondre à ces questions que les acteurs tant individuels que collectifs, ont été interpellés par un aréopage de chercheurs, pour étudier le changement social en Tunisie aux niveaux les plus divers des actions et des phénomènes sociaux : famille, jeunes, élites, notables, corporations, groupes sociaux en termes de classe (bourgeoisie urbaine, paysannerie parcellaire, classe ouvrière), en termes d'organisations (syndicat) en termes d'institutions et de structures : lieux de culte, etc.
Les approches sont diverses, on y retrouve les adeptes de l'individualisme, mais aussi les tenants du holisme. Des essais tant théoriques que pratiques ont abordé les deux approches sous l'angle du lien et de l'articulation tels que : le " relationnalisme méthodologique " ou les " acteurs collectifs ", sous de nouveaux éclairages et de nouvelles déclinaisons.
Les approches sont diverses, on y retrouve les adeptes de l'individualisme, mais aussi les tenants du holisme. Des essais tant théoriques que pratiques ont abordé les deux approches sous l'angle du lien et de l'articulation tels que : le " relationnalisme méthodologique " ou les " acteurs collectifs ", sous de nouveaux éclairages et de nouvelles déclinaisons.
Le changement social se confond-il avec le développement que s'assigne consciemment une société sous la férule directrice de son élite ? Quelle est la part de la planification, de la prédictibilité, de la centralisation ? Quelle est la part de l'inattendu, du foisonnant, de l'anarchique et du divergent ? Quelle bonne part du social s'assurent l'en bas et l'en haut ? Quelle est la part du tangible pour jauger les évolutions que connaît une société, quelle est la part du souterrain, de l'informel, et même de l'ambigu et du paradoxal ? La rationalité, y compris économique, le positivisme régi par le paradigme du chiffre, ont-ils, à eux seuls, suffi pour couvrir le champ des actions des hommes en interaction sociale durant un demi-siècle de bruit et de fureur, de mouvements sociaux, mais aussi de fulgurances individuelles, tout aussi bien dans le domaine ordinaire de la vie quotidienne que du domaine extraordinaire de l'art ? Quelle est la part de l'environnement extérieur, quel est le poids des forces internes à l'œuvre dans le changement social qui régit la marche d'une société ? C'est pour répondre à ces questions que les acteurs tant individuels que collectifs, ont été interpellés par un aréopage de chercheurs, pour étudier le changement social en Tunisie aux niveaux les plus divers des actions et des phénomènes sociaux : famille, jeunes, élites, notables, corporations, groupes sociaux en termes de classe (bourgeoisie urbaine, paysannerie parcellaire, classe ouvrière), en termes d'organisations (syndicat) en termes d'institutions et de structures : lieux de culte, etc.
Les approches sont diverses, on y retrouve les adeptes de l'individualisme, mais aussi les tenants du holisme. Des essais tant théoriques que pratiques ont abordé les deux approches sous l'angle du lien et de l'articulation tels que : le " relationnalisme méthodologique " ou les " acteurs collectifs ", sous de nouveaux éclairages et de nouvelles déclinaisons.
Les approches sont diverses, on y retrouve les adeptes de l'individualisme, mais aussi les tenants du holisme. Des essais tant théoriques que pratiques ont abordé les deux approches sous l'angle du lien et de l'articulation tels que : le " relationnalisme méthodologique " ou les " acteurs collectifs ", sous de nouveaux éclairages et de nouvelles déclinaisons.