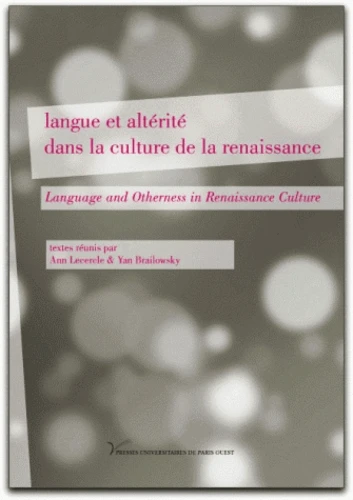Langue et altérité dans la culture de la Renaissance
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages194
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.295 kg
- Dimensions15,1 cm × 21,3 cm × 1,7 cm
- ISBN978-2-84016-039-7
- EAN9782840160397
- Date de parution09/12/2008
- ÉditeurPU Paris Ouest
Résumé
Cet ouvrage s'intéresse à la figure de "l'Autre", qui prend ses sources dans la Grèce antique, et qui façonne la culture de la Renaissance. Au coeur de l'organisation sociale de la Grèce antique et de l'institution théâtrale s'inscrivait Dionysos, "la figure de l'Autre" par excellence (Louis Gernet). Le théâtre élisabéthain, quant à lui, plaçait le festif ou l'Altérité prohibée dans un lieu alternatif, de l'autre côté de la Tamise, comme pour mieux confronter la ville au-delà de ses frontières.
Entre les murs du théâtre, les garçons jouaient les rôles de femmes - fait unique en Europe à l'époque - alors que le langage était lui-même "autre", un mélange instable d'idiomes naturels et de langues vernaculaires issues des cultures dominantes d'Europe continentale, marquant la disparition progressive de la langue de "l'Eglise d'Antan", le latin, de plus en plus souvent perçu comme la langue de l'Autre suprême, le Pape Antéchrist.
Ce volume tente de montrer la diversité topologique de l'Altérité dans la culture de la Renaissance en s'intéressant à la fois à la langue "autre" (la calomnie, l'insulte, le jargon des colporteurs, la traduction, la prophétie), comme aux figures de "l'Autre" (le fantôme, le bâtard, le garçon acteur travesti, l'homme des bois...).
Entre les murs du théâtre, les garçons jouaient les rôles de femmes - fait unique en Europe à l'époque - alors que le langage était lui-même "autre", un mélange instable d'idiomes naturels et de langues vernaculaires issues des cultures dominantes d'Europe continentale, marquant la disparition progressive de la langue de "l'Eglise d'Antan", le latin, de plus en plus souvent perçu comme la langue de l'Autre suprême, le Pape Antéchrist.
Ce volume tente de montrer la diversité topologique de l'Altérité dans la culture de la Renaissance en s'intéressant à la fois à la langue "autre" (la calomnie, l'insulte, le jargon des colporteurs, la traduction, la prophétie), comme aux figures de "l'Autre" (le fantôme, le bâtard, le garçon acteur travesti, l'homme des bois...).
Cet ouvrage s'intéresse à la figure de "l'Autre", qui prend ses sources dans la Grèce antique, et qui façonne la culture de la Renaissance. Au coeur de l'organisation sociale de la Grèce antique et de l'institution théâtrale s'inscrivait Dionysos, "la figure de l'Autre" par excellence (Louis Gernet). Le théâtre élisabéthain, quant à lui, plaçait le festif ou l'Altérité prohibée dans un lieu alternatif, de l'autre côté de la Tamise, comme pour mieux confronter la ville au-delà de ses frontières.
Entre les murs du théâtre, les garçons jouaient les rôles de femmes - fait unique en Europe à l'époque - alors que le langage était lui-même "autre", un mélange instable d'idiomes naturels et de langues vernaculaires issues des cultures dominantes d'Europe continentale, marquant la disparition progressive de la langue de "l'Eglise d'Antan", le latin, de plus en plus souvent perçu comme la langue de l'Autre suprême, le Pape Antéchrist.
Ce volume tente de montrer la diversité topologique de l'Altérité dans la culture de la Renaissance en s'intéressant à la fois à la langue "autre" (la calomnie, l'insulte, le jargon des colporteurs, la traduction, la prophétie), comme aux figures de "l'Autre" (le fantôme, le bâtard, le garçon acteur travesti, l'homme des bois...).
Entre les murs du théâtre, les garçons jouaient les rôles de femmes - fait unique en Europe à l'époque - alors que le langage était lui-même "autre", un mélange instable d'idiomes naturels et de langues vernaculaires issues des cultures dominantes d'Europe continentale, marquant la disparition progressive de la langue de "l'Eglise d'Antan", le latin, de plus en plus souvent perçu comme la langue de l'Autre suprême, le Pape Antéchrist.
Ce volume tente de montrer la diversité topologique de l'Altérité dans la culture de la Renaissance en s'intéressant à la fois à la langue "autre" (la calomnie, l'insulte, le jargon des colporteurs, la traduction, la prophétie), comme aux figures de "l'Autre" (le fantôme, le bâtard, le garçon acteur travesti, l'homme des bois...).