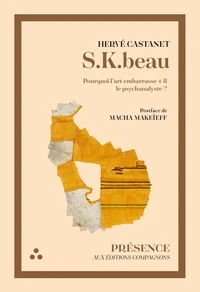Cet ouvrage ordonne les nombreuses références à la perversion chez Freud et chez Lacan.
D'abord, il déplie la thèse, explicitement freudienne, suivante : les attitudes, comportements, rituels, passages à l'acte... qui manifestent la polymorphie, sous ses formes les plus aberrantes ou surprenantes, de la sexualité humaine ne permettent pas d'établir le diagnostic de perversion. La description, fût-elle détaillée et fouillée, ne suffit pas pour spécifier la perversion. Autrement dit, la perversion (freudienne) est une position subjective et c'est parce qu'elle a ce statut qu'elle peut être mise en série avec les deux autres structures cliniques que sont la névrose et la psychose.
Ensuite, il montre que c'est à partir de la formule du fantasme qui joint-disjoint le sujet et l'Autre, que Lacan fonde la position du pervers. Seule la référence au fantasme en tant que " soutien du désir ", permet de spécifier la perversion comme structure subjective. C'est ce qu'assure le fantasme en tant qu'il donne au sujet son assurance, son ancrage libidinal. D'un côté, la logique du signifiant où le sujet glisse, se déplace selon les deux axes de la métaphore et de la métonymie ; de l'autre, le fantasme comme réponse à la faille de l'Autre : fixité, arrêt, consistance où le sujet trouve son support silencieux.
Enfin, un long exemple clinique, tiré d'une fiction littéraire : l'admirable Trilogie de Roberte de Pierre Klossowski, démontre en quoi tout pervers est un singulier auxiliaire de Dieu à la jouissance duquel il se voue.
Tout au long du parcours, l'ouvrage fait valoir que les joutes amoureuses entre hommes et femmes ont encore de beaux jours. En matière d'accès à la satisfaction sexuelle, les méandres de l'un ne sont pas ceux de l'autre. La psychanalyse affirme un " répartitoire sexuel " selon l'expression de Jacques-Alain Miller. Ce n'est pas le moindre intérêt de la perversion que de nous en donner la raison.
Cet ouvrage ordonne les nombreuses références à la perversion chez Freud et chez Lacan.
D'abord, il déplie la thèse, explicitement freudienne, suivante : les attitudes, comportements, rituels, passages à l'acte... qui manifestent la polymorphie, sous ses formes les plus aberrantes ou surprenantes, de la sexualité humaine ne permettent pas d'établir le diagnostic de perversion. La description, fût-elle détaillée et fouillée, ne suffit pas pour spécifier la perversion. Autrement dit, la perversion (freudienne) est une position subjective et c'est parce qu'elle a ce statut qu'elle peut être mise en série avec les deux autres structures cliniques que sont la névrose et la psychose.
Ensuite, il montre que c'est à partir de la formule du fantasme qui joint-disjoint le sujet et l'Autre, que Lacan fonde la position du pervers. Seule la référence au fantasme en tant que " soutien du désir ", permet de spécifier la perversion comme structure subjective. C'est ce qu'assure le fantasme en tant qu'il donne au sujet son assurance, son ancrage libidinal. D'un côté, la logique du signifiant où le sujet glisse, se déplace selon les deux axes de la métaphore et de la métonymie ; de l'autre, le fantasme comme réponse à la faille de l'Autre : fixité, arrêt, consistance où le sujet trouve son support silencieux.
Enfin, un long exemple clinique, tiré d'une fiction littéraire : l'admirable Trilogie de Roberte de Pierre Klossowski, démontre en quoi tout pervers est un singulier auxiliaire de Dieu à la jouissance duquel il se voue.
Tout au long du parcours, l'ouvrage fait valoir que les joutes amoureuses entre hommes et femmes ont encore de beaux jours. En matière d'accès à la satisfaction sexuelle, les méandres de l'un ne sont pas ceux de l'autre. La psychanalyse affirme un " répartitoire sexuel " selon l'expression de Jacques-Alain Miller. Ce n'est pas le moindre intérêt de la perversion que de nous en donner la raison.