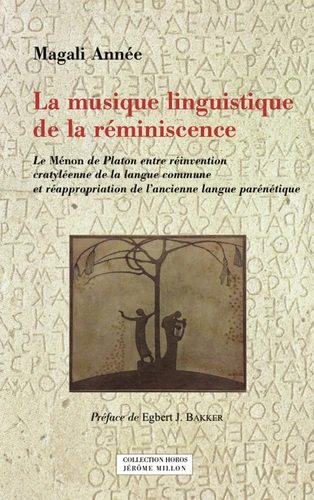La musique linguistique de la réminiscence. Le Ménon de Platon entre réinvention cratyléenne de la langue commune et réappropriation de l'ancienne langue parénétique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages144
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.178 kg
- Dimensions13,6 cm × 21,5 cm × 1,1 cm
- ISBN978-2-84137-340-6
- EAN9782841373406
- Date de parution08/11/2018
- CollectionHoros
- ÉditeurMillon
- PréfacierEgbert Bakker
Résumé
La nouvelle lecture que je propose du Ménon part d'un double constat, l'un bien connu, l'autre moins : non seulement le nom du protagoniste MEvwv correspond exactement à la forme de participe présent du verbe µvcty "tenir bon, résister", mais il s'avère encore que chaque adresse que Socrate fait à Ménon génère un phénomène de "clusters" phonico-syllabiques de séquences µEv, µiv, µov, µv, µav. En étudiant la structure d'ensemble du dialogue, plusieurs fois réflexive sur elle-même, et en menant une analyse serrée des noeuds de sa mécanique dictionnelle, par-deçà le niveau logico-syntaxique de son argumentation, on parvient à montrer que ce tissage sonore s'inspirant (sans jamais la nommer ni la citer explicitement) de la diction caractéristique des élégies d'exhortation de Tyrtée, participe tout entier d'un processus de réinvention perpétuelle du dire soi-même et du dire ensemble, destiné à servir l'effort d'introspection anamnétique sans laquelle nulle connaissance n'est possible.
Cela nous amène à formuler l'hypothèse d'un fondement linguistique de l'anamnèse platonicienne et à considérer cette dernière comme une véritable expérience initiatique au coeur d'un langage ré-accordé à lui-même et à ses locuteurs — c'est-à-dire rendu à sa propre connaturalité, où réside toute la puissance intercommunicationnelle et cognitive qui est la sienne et qui ne présuppose pas la contemplation des Idées.
Cela nous amène à formuler l'hypothèse d'un fondement linguistique de l'anamnèse platonicienne et à considérer cette dernière comme une véritable expérience initiatique au coeur d'un langage ré-accordé à lui-même et à ses locuteurs — c'est-à-dire rendu à sa propre connaturalité, où réside toute la puissance intercommunicationnelle et cognitive qui est la sienne et qui ne présuppose pas la contemplation des Idées.
La nouvelle lecture que je propose du Ménon part d'un double constat, l'un bien connu, l'autre moins : non seulement le nom du protagoniste MEvwv correspond exactement à la forme de participe présent du verbe µvcty "tenir bon, résister", mais il s'avère encore que chaque adresse que Socrate fait à Ménon génère un phénomène de "clusters" phonico-syllabiques de séquences µEv, µiv, µov, µv, µav. En étudiant la structure d'ensemble du dialogue, plusieurs fois réflexive sur elle-même, et en menant une analyse serrée des noeuds de sa mécanique dictionnelle, par-deçà le niveau logico-syntaxique de son argumentation, on parvient à montrer que ce tissage sonore s'inspirant (sans jamais la nommer ni la citer explicitement) de la diction caractéristique des élégies d'exhortation de Tyrtée, participe tout entier d'un processus de réinvention perpétuelle du dire soi-même et du dire ensemble, destiné à servir l'effort d'introspection anamnétique sans laquelle nulle connaissance n'est possible.
Cela nous amène à formuler l'hypothèse d'un fondement linguistique de l'anamnèse platonicienne et à considérer cette dernière comme une véritable expérience initiatique au coeur d'un langage ré-accordé à lui-même et à ses locuteurs — c'est-à-dire rendu à sa propre connaturalité, où réside toute la puissance intercommunicationnelle et cognitive qui est la sienne et qui ne présuppose pas la contemplation des Idées.
Cela nous amène à formuler l'hypothèse d'un fondement linguistique de l'anamnèse platonicienne et à considérer cette dernière comme une véritable expérience initiatique au coeur d'un langage ré-accordé à lui-même et à ses locuteurs — c'est-à-dire rendu à sa propre connaturalité, où réside toute la puissance intercommunicationnelle et cognitive qui est la sienne et qui ne présuppose pas la contemplation des Idées.