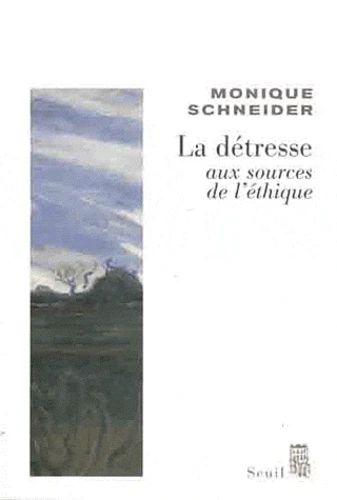La détresse, aux sources de l'éthique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages384
- PrésentationBroché
- Poids0.415 kg
- Dimensions14,0 cm × 20,5 cm × 2,5 cm
- ISBN978-2-02-103016-7
- EAN9782021030167
- Date de parution21/04/2011
- ÉditeurSeuil
Résumé
L’expérience de la souffrance semble de celles qui, comme la faim, sont immédiatement données.
Freud montre au contraire dans Esquisse pour une psychologie scientifique (1895) que l’accès à un
tel éprouvé, qui s’ouvre sur l’émotion qualifiée de « souffrance », ne peut avoir lieu sans « l’être
proche », qui reconnaît cette souffrance. Ainsi, c’est l’exigence éthique de l’attention portée à l’être
souffrant qui rend possible l’expérience de la souffrance, c'est-à-dire sa reconnaissance et sa
verbalisation éventuelle.
Sans l’être proche, l’état de détresse, qui correspond à l’expérience originaire du réel, déboucherait sur une anesthésie hébétée, tels l’hospitalisme ou certains états psychotiques. Les conséquences de cette analyse sont considérables :le psychisme est un ensemble de processus de structuration rendant nécessaire la présence de l’autre, ce que l’on sait bien depuis Lacan, mais qui est souvent négligé dans l’apport qu’on attribue à Freud ; l’autre apparaît dans une dualité dramatique, puisqu’étant celui qui peut reconnaître et éventuellement réparer la souffrance, il est aussi celui qui peut renier l’enfant quand il répond à sa souffrance par un cri de détresse ; enfin, l’expérience de la souffrance place le jeune enfant au seuil du jugement (c’est à partir de la dualité première où plonge la souffrance que se construit la possibilité de l’attribution, du jugement).
Sans l’être proche, l’état de détresse, qui correspond à l’expérience originaire du réel, déboucherait sur une anesthésie hébétée, tels l’hospitalisme ou certains états psychotiques. Les conséquences de cette analyse sont considérables :le psychisme est un ensemble de processus de structuration rendant nécessaire la présence de l’autre, ce que l’on sait bien depuis Lacan, mais qui est souvent négligé dans l’apport qu’on attribue à Freud ; l’autre apparaît dans une dualité dramatique, puisqu’étant celui qui peut reconnaître et éventuellement réparer la souffrance, il est aussi celui qui peut renier l’enfant quand il répond à sa souffrance par un cri de détresse ; enfin, l’expérience de la souffrance place le jeune enfant au seuil du jugement (c’est à partir de la dualité première où plonge la souffrance que se construit la possibilité de l’attribution, du jugement).
L’expérience de la souffrance semble de celles qui, comme la faim, sont immédiatement données.
Freud montre au contraire dans Esquisse pour une psychologie scientifique (1895) que l’accès à un
tel éprouvé, qui s’ouvre sur l’émotion qualifiée de « souffrance », ne peut avoir lieu sans « l’être
proche », qui reconnaît cette souffrance. Ainsi, c’est l’exigence éthique de l’attention portée à l’être
souffrant qui rend possible l’expérience de la souffrance, c'est-à-dire sa reconnaissance et sa
verbalisation éventuelle.
Sans l’être proche, l’état de détresse, qui correspond à l’expérience originaire du réel, déboucherait sur une anesthésie hébétée, tels l’hospitalisme ou certains états psychotiques. Les conséquences de cette analyse sont considérables :le psychisme est un ensemble de processus de structuration rendant nécessaire la présence de l’autre, ce que l’on sait bien depuis Lacan, mais qui est souvent négligé dans l’apport qu’on attribue à Freud ; l’autre apparaît dans une dualité dramatique, puisqu’étant celui qui peut reconnaître et éventuellement réparer la souffrance, il est aussi celui qui peut renier l’enfant quand il répond à sa souffrance par un cri de détresse ; enfin, l’expérience de la souffrance place le jeune enfant au seuil du jugement (c’est à partir de la dualité première où plonge la souffrance que se construit la possibilité de l’attribution, du jugement).
Sans l’être proche, l’état de détresse, qui correspond à l’expérience originaire du réel, déboucherait sur une anesthésie hébétée, tels l’hospitalisme ou certains états psychotiques. Les conséquences de cette analyse sont considérables :le psychisme est un ensemble de processus de structuration rendant nécessaire la présence de l’autre, ce que l’on sait bien depuis Lacan, mais qui est souvent négligé dans l’apport qu’on attribue à Freud ; l’autre apparaît dans une dualité dramatique, puisqu’étant celui qui peut reconnaître et éventuellement réparer la souffrance, il est aussi celui qui peut renier l’enfant quand il répond à sa souffrance par un cri de détresse ; enfin, l’expérience de la souffrance place le jeune enfant au seuil du jugement (c’est à partir de la dualité première où plonge la souffrance que se construit la possibilité de l’attribution, du jugement).