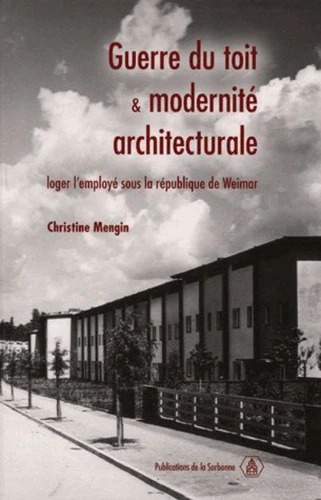Guerre du toit et modernité architecturale : loger l'employé sous la république de Weimar
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages540
- PrésentationBroché
- Poids0.975 kg
- Dimensions16,5 cm × 24,0 cm × 3,5 cm
- ISBN978-2-85944-567-6
- EAN9782859445676
- Date de parution16/05/2007
- CollectionHistoire de l'art
- ÉditeurPublications de la Sorbonne
Résumé
Berlin, 1928. Dans le quartier tranquille de Zehlendorf, deux cités
d'habitation sortent de terre, dans un face-à-face hostile. D'un
côté, la plastique cubiste de l'avant-garde, de l'autre, les tuiles
de la tradition revisitée par le régionalisme. Cette confrontation
de formes déclenche la " guerre du toit ", qui divise le …
Berlin, 1928. Dans le quartier tranquille de Zehlendorf, deux cités
d'habitation sortent de terre, dans un face-à-face hostile. D'un
côté, la plastique cubiste de l'avant-garde, de l'autre, les tuiles
de la tradition revisitée par le régionalisme. Cette confrontation
de formes déclenche la " guerre du toit ", qui divise le milieu
architectural si fécond de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres.
Replaçant cet épisode célèbre, mais jamais étudié, dans le contexte
de l'ambitieuse politique du logement menée par la république
de Weimar, le livre compare les deux sociétés de construction
impliquées, la conservatrice Gagfah et la progressiste Gehag, et
présente leurs destinataires, à savoir le groupe social des employés.
Evoquant les convictions partagées par les maîtres d'ouvrage et les
maîtres d'œuvre sur la cité-jardin, la standardisation et la nécessaire
éducation des habitants, l'étude pose en des termes nouveaux la
question de la fracture entre modernisme et traditionalisme, liée à
des enjeux symboliques et recoupant l'antagonisme entre Kultur et
Zivilisation. Grâce à des sources inédites, l'ouvrage propose de
nouvelles hypothèses sur ce moment crucial où le renouvellement
de la culture architecturale, engagé au début du siècle, rencontre
l'émergence de la société de masse avec ses nouvelles exigences
en matière d'habitat. Il vient aussi combler une considérable lacune
historiographique des études françaises sur l'architecture et sur l'Allemagne.