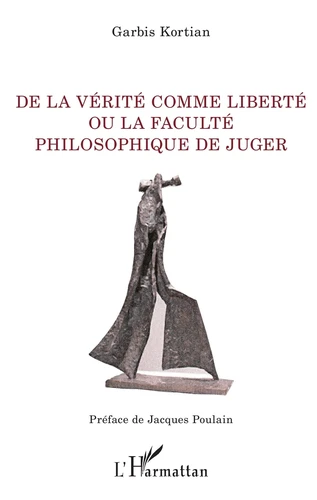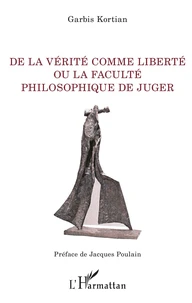De la vérité comme liberté ou la faculté philosophique de juger
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 11 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 7 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 11 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages250
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.316 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 2,0 cm
- ISBN978-2-343-20396-6
- EAN9782343203966
- Date de parution24/08/2020
- CollectionLa philosophie en commun
- ÉditeurL'Harmattan
- PréfacierJacques Poulain
Résumé
Le vingtième siècle semble avoir mis fin à l'errance de la philosophie. En découvrant que la pensée trouve sa source dans l'usage du langage, la philosophie découvrait que son usage de la faculté de juger était déjà balisé par la logique des énoncés et la performativité de la parole. Son propre discours ne pouvait donc plus s'exclure des jugements de vérité portés sur la réalité dans la mesure où ils étaient pensés et exigeaient qu'ils appliquent à eux-mêmes le jugement par lequel ils pensaient leur pensée.
Bien plus. En exerçant ce jugement, elle devait reconnaître que le jugement de vérité animant la parole, ne reposait que sur lui-même et ne faisait qu'utiliser cette faculté philosophique de juger pour faire toute expérience. Telle semblait être la seule vérité partagée par la philosophie analytique et l'herméneutique. Mais si tel était le cas, en quoi la faculté philosophique de juger ancrée dans le langage différait-elle de celle que l'idéalisme avait érigée en faculté ultime de la pensée ?
Bien plus. En exerçant ce jugement, elle devait reconnaître que le jugement de vérité animant la parole, ne reposait que sur lui-même et ne faisait qu'utiliser cette faculté philosophique de juger pour faire toute expérience. Telle semblait être la seule vérité partagée par la philosophie analytique et l'herméneutique. Mais si tel était le cas, en quoi la faculté philosophique de juger ancrée dans le langage différait-elle de celle que l'idéalisme avait érigée en faculté ultime de la pensée ?
Le vingtième siècle semble avoir mis fin à l'errance de la philosophie. En découvrant que la pensée trouve sa source dans l'usage du langage, la philosophie découvrait que son usage de la faculté de juger était déjà balisé par la logique des énoncés et la performativité de la parole. Son propre discours ne pouvait donc plus s'exclure des jugements de vérité portés sur la réalité dans la mesure où ils étaient pensés et exigeaient qu'ils appliquent à eux-mêmes le jugement par lequel ils pensaient leur pensée.
Bien plus. En exerçant ce jugement, elle devait reconnaître que le jugement de vérité animant la parole, ne reposait que sur lui-même et ne faisait qu'utiliser cette faculté philosophique de juger pour faire toute expérience. Telle semblait être la seule vérité partagée par la philosophie analytique et l'herméneutique. Mais si tel était le cas, en quoi la faculté philosophique de juger ancrée dans le langage différait-elle de celle que l'idéalisme avait érigée en faculté ultime de la pensée ?
Bien plus. En exerçant ce jugement, elle devait reconnaître que le jugement de vérité animant la parole, ne reposait que sur lui-même et ne faisait qu'utiliser cette faculté philosophique de juger pour faire toute expérience. Telle semblait être la seule vérité partagée par la philosophie analytique et l'herméneutique. Mais si tel était le cas, en quoi la faculté philosophique de juger ancrée dans le langage différait-elle de celle que l'idéalisme avait érigée en faculté ultime de la pensée ?