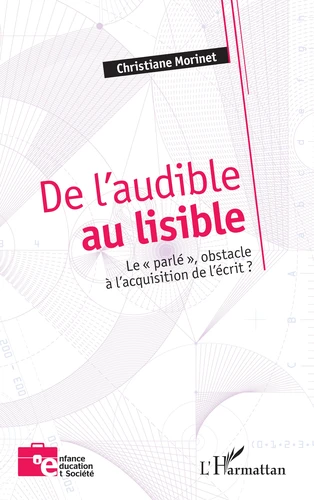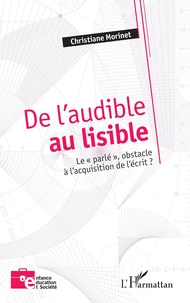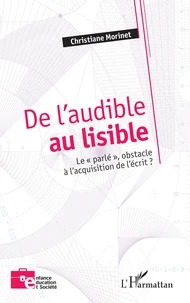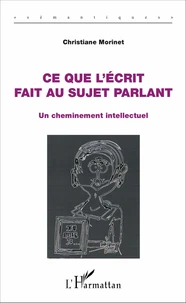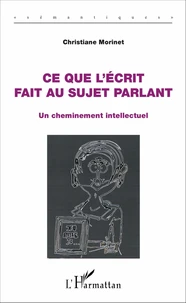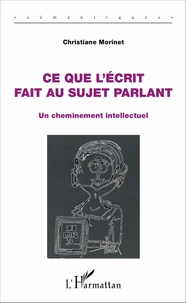De l’audible au lisible. Le « parlé », obstacle à l’acquisition de l’écrit ?
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages257
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.325 kg
- Dimensions13,6 cm × 21,5 cm × 2,0 cm
- ISBN978-2-14-034134-2
- EAN9782140341342
- Date de parution23/11/2023
- CollectionEnfance, éducation et société
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Comment pouvons-nous à la fois parler et écrire ? Est-ce à cette jonction que se niche un obstacle au déploiement de l'écrit dans ses conséquences intellectuelles, qui expliquerait les inégalités langagières au seuil de l'université ? Entrer dans ce problème par la conversion de la parole (l'audible) en écriture (le lisible) fait apparaitre une notion : le "parlé" , qui distingue deux états de productions orales.
L'une acquise dès l'enfance et donnant naissance au psychisme en langue, acquisition préscolaire, et l'autre constitutive d'un oral orienté vers la dimension heuristique de la scripturalité, sorte d' "oral pour écrire" , acquisition essentiellement scolaire. Ce clivage, résultat d'une production langagière au-delà du corps physique de l'énonciateur, ne dit pas le travail énonciatif nécessaire pour articuler les productions orales aux productions écrites.
Ce non-dit se révèle un obstacle si l'a ffranchissement de la technique n'est pas suffisamment accompagné en discours.
L'une acquise dès l'enfance et donnant naissance au psychisme en langue, acquisition préscolaire, et l'autre constitutive d'un oral orienté vers la dimension heuristique de la scripturalité, sorte d' "oral pour écrire" , acquisition essentiellement scolaire. Ce clivage, résultat d'une production langagière au-delà du corps physique de l'énonciateur, ne dit pas le travail énonciatif nécessaire pour articuler les productions orales aux productions écrites.
Ce non-dit se révèle un obstacle si l'a ffranchissement de la technique n'est pas suffisamment accompagné en discours.
Comment pouvons-nous à la fois parler et écrire ? Est-ce à cette jonction que se niche un obstacle au déploiement de l'écrit dans ses conséquences intellectuelles, qui expliquerait les inégalités langagières au seuil de l'université ? Entrer dans ce problème par la conversion de la parole (l'audible) en écriture (le lisible) fait apparaitre une notion : le "parlé" , qui distingue deux états de productions orales.
L'une acquise dès l'enfance et donnant naissance au psychisme en langue, acquisition préscolaire, et l'autre constitutive d'un oral orienté vers la dimension heuristique de la scripturalité, sorte d' "oral pour écrire" , acquisition essentiellement scolaire. Ce clivage, résultat d'une production langagière au-delà du corps physique de l'énonciateur, ne dit pas le travail énonciatif nécessaire pour articuler les productions orales aux productions écrites.
Ce non-dit se révèle un obstacle si l'a ffranchissement de la technique n'est pas suffisamment accompagné en discours.
L'une acquise dès l'enfance et donnant naissance au psychisme en langue, acquisition préscolaire, et l'autre constitutive d'un oral orienté vers la dimension heuristique de la scripturalité, sorte d' "oral pour écrire" , acquisition essentiellement scolaire. Ce clivage, résultat d'une production langagière au-delà du corps physique de l'énonciateur, ne dit pas le travail énonciatif nécessaire pour articuler les productions orales aux productions écrites.
Ce non-dit se révèle un obstacle si l'a ffranchissement de la technique n'est pas suffisamment accompagné en discours.