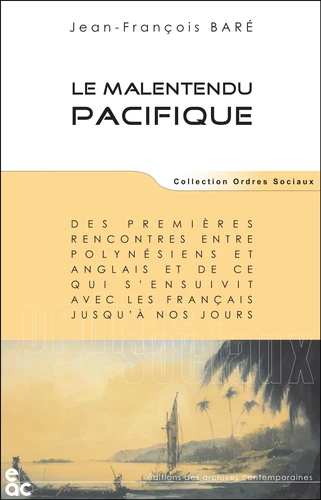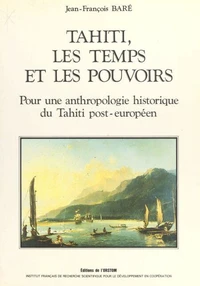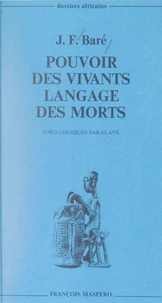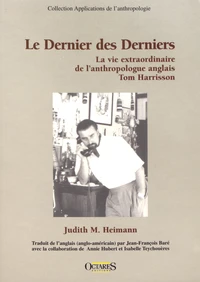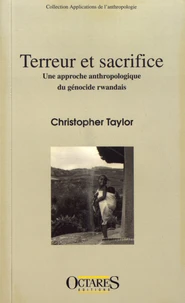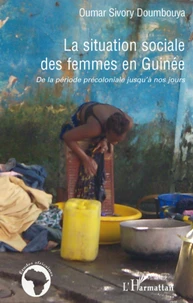La malentendu pacifique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages274
- PrésentationBroché
- Poids0.36 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,0 cm × 1,7 cm
- ISBN2-914610-17-3
- EAN9782914610179
- Date de parution15/07/2002
- CollectionOrdres sociaux
- ÉditeurArchives Contemporaines
Résumé
Voici le Tahiti des années 1980, archipels perdus au fin fond de l'immense Pacifique. Qu'est-ce que Tahiti ? Qu'est-ce qu'être Tahitien ? " Une souche de cocotier qui sort de la terre ", comme le disait un jour son ami Ruroa à fauteur, sceptique - car des Anglais, des Américains, des Chinois, des Français nés à Tahiti y avaient fait souche ; étaient-ils pour autant Tahitiens ? Est-ce appartenir à l'Eglise protestante qui apparaît paradoxalement comme le dernier rempart de l'identité ? Est-ce être citoyen français ?
Si l'identité polynésienne actuelle et hétérogène, ambiguë, si les communautés autochtones de Tahiti sont en quelque sorte devenues étrangères chez elles, c'est certes à la suite d'un processus colonial classique.
L'histoire montre pourtant que bien avant la colonisation, dès la " découverte " de Tahiti, dès les premiers échanges, le malentendu s'instaure comme règle de la communication. Hawaii, souvent mentionné, tonnait de semblables péripéties. Tout commencerait alors en juin 1766 dans le dock de Deptford, en aval de Londres, alors qu'on arme une frégate en partance pour ce qu'on croit toujours être le continent austral, frégate que les Tahitiens allaient comparer à une île flottante.
L'histoire montre pourtant que bien avant la colonisation, dès la " découverte " de Tahiti, dès les premiers échanges, le malentendu s'instaure comme règle de la communication. Hawaii, souvent mentionné, tonnait de semblables péripéties. Tout commencerait alors en juin 1766 dans le dock de Deptford, en aval de Londres, alors qu'on arme une frégate en partance pour ce qu'on croit toujours être le continent austral, frégate que les Tahitiens allaient comparer à une île flottante.
Voici le Tahiti des années 1980, archipels perdus au fin fond de l'immense Pacifique. Qu'est-ce que Tahiti ? Qu'est-ce qu'être Tahitien ? " Une souche de cocotier qui sort de la terre ", comme le disait un jour son ami Ruroa à fauteur, sceptique - car des Anglais, des Américains, des Chinois, des Français nés à Tahiti y avaient fait souche ; étaient-ils pour autant Tahitiens ? Est-ce appartenir à l'Eglise protestante qui apparaît paradoxalement comme le dernier rempart de l'identité ? Est-ce être citoyen français ?
Si l'identité polynésienne actuelle et hétérogène, ambiguë, si les communautés autochtones de Tahiti sont en quelque sorte devenues étrangères chez elles, c'est certes à la suite d'un processus colonial classique.
L'histoire montre pourtant que bien avant la colonisation, dès la " découverte " de Tahiti, dès les premiers échanges, le malentendu s'instaure comme règle de la communication. Hawaii, souvent mentionné, tonnait de semblables péripéties. Tout commencerait alors en juin 1766 dans le dock de Deptford, en aval de Londres, alors qu'on arme une frégate en partance pour ce qu'on croit toujours être le continent austral, frégate que les Tahitiens allaient comparer à une île flottante.
L'histoire montre pourtant que bien avant la colonisation, dès la " découverte " de Tahiti, dès les premiers échanges, le malentendu s'instaure comme règle de la communication. Hawaii, souvent mentionné, tonnait de semblables péripéties. Tout commencerait alors en juin 1766 dans le dock de Deptford, en aval de Londres, alors qu'on arme une frégate en partance pour ce qu'on croit toujours être le continent austral, frégate que les Tahitiens allaient comparer à une île flottante.