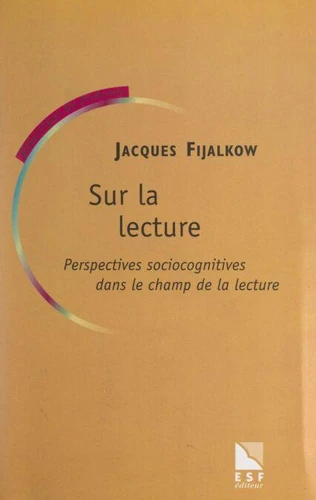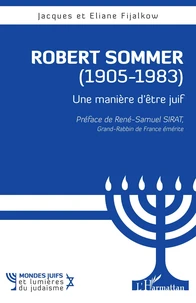Sur la lecture. Perspectives sociocognitives dans le champ de la lecture-écriture
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages212
- FormatePub
- ISBN2-307-22540-4
- EAN9782307225409
- Date de parution01/01/2000
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille952 Ko
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurFeniXX réédition numérique (ESF)
Résumé
Traversés par des discours multiples et contradictoires, les professionnels de la lecture expriment leur embarras croissant à y voir clair « sur la lecture ». Cet ouvrage vise donc à permettre au non-chercheur - mais-intéressé-par-la-recherche - de mettre un peu d'ordre dans le petit monde si agité de la littératie. L'ouvrage présente celui-ci comme un champ, comportant différentes catégories d'acteurs, en centrant l'analyse sur celui qui suscite - tour à tour - irritation et respect, parce qu'on le connaît mal, le chercheur.
Le champ ainsi délimité, la deuxième partie prend - pour angle d'attaque - la psychologie cognitive, mais c'est pour montrer qu'elle n'est pas une, mais plurielle. Les débats sont vifs. Ils ne le sont pas moins quand se pose, pour le pédagogue, la question des choix qu'il doit faire, dans sa classe et par rapport aux autres intervenants. L'ouvrage se propose alors, dans la troisième partie, d'élucider quelques-uns des fondements théoriques de ces choix.
Et si on voulait que les recherches contribuent vraiment à la résolution des problèmes, comment faudrait-il les conduire ? C'est l'objet de la dernière partie.
Le champ ainsi délimité, la deuxième partie prend - pour angle d'attaque - la psychologie cognitive, mais c'est pour montrer qu'elle n'est pas une, mais plurielle. Les débats sont vifs. Ils ne le sont pas moins quand se pose, pour le pédagogue, la question des choix qu'il doit faire, dans sa classe et par rapport aux autres intervenants. L'ouvrage se propose alors, dans la troisième partie, d'élucider quelques-uns des fondements théoriques de ces choix.
Et si on voulait que les recherches contribuent vraiment à la résolution des problèmes, comment faudrait-il les conduire ? C'est l'objet de la dernière partie.
Traversés par des discours multiples et contradictoires, les professionnels de la lecture expriment leur embarras croissant à y voir clair « sur la lecture ». Cet ouvrage vise donc à permettre au non-chercheur - mais-intéressé-par-la-recherche - de mettre un peu d'ordre dans le petit monde si agité de la littératie. L'ouvrage présente celui-ci comme un champ, comportant différentes catégories d'acteurs, en centrant l'analyse sur celui qui suscite - tour à tour - irritation et respect, parce qu'on le connaît mal, le chercheur.
Le champ ainsi délimité, la deuxième partie prend - pour angle d'attaque - la psychologie cognitive, mais c'est pour montrer qu'elle n'est pas une, mais plurielle. Les débats sont vifs. Ils ne le sont pas moins quand se pose, pour le pédagogue, la question des choix qu'il doit faire, dans sa classe et par rapport aux autres intervenants. L'ouvrage se propose alors, dans la troisième partie, d'élucider quelques-uns des fondements théoriques de ces choix.
Et si on voulait que les recherches contribuent vraiment à la résolution des problèmes, comment faudrait-il les conduire ? C'est l'objet de la dernière partie.
Le champ ainsi délimité, la deuxième partie prend - pour angle d'attaque - la psychologie cognitive, mais c'est pour montrer qu'elle n'est pas une, mais plurielle. Les débats sont vifs. Ils ne le sont pas moins quand se pose, pour le pédagogue, la question des choix qu'il doit faire, dans sa classe et par rapport aux autres intervenants. L'ouvrage se propose alors, dans la troisième partie, d'élucider quelques-uns des fondements théoriques de ces choix.
Et si on voulait que les recherches contribuent vraiment à la résolution des problèmes, comment faudrait-il les conduire ? C'est l'objet de la dernière partie.