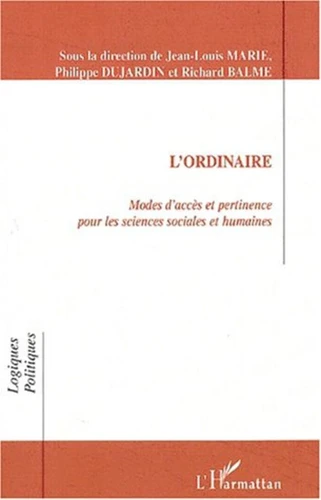L'ordinaire. Modes d'accès et pertinence pour les sciences sociales et humaines
Par : , , ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages342
- FormatPDF
- ISBN2-296-29857-5
- EAN9782296298576
- Date de parution01/09/2002
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille11 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Il s'agit dans cet ouvrage d'ouvrir une large discussion méthodologique et conceptuelle sur les modes d'accès à la notion d'ordinaire et sur sa pertinence pour les sciences sociales et humaines. On constate en effet dans ces disciplines une mise en question grandissante d'un type de pensée qu'on appellera soit objectiviste, soit positiviste, soit même, rationaliste. Mise en question ouverte dès le début de ce siècle, notamment par la phénoménologie.
Des espaces d'interrogation ont ainsi été dégagés sous des notions telles que le pré-réflexif, le rapport pratique au monde, le sensible, l'informel. La science politique n'échappe pas à ce mouvement d'ensemble et elle est amenée aujourd'hui à reconsidérer ses objets constitués. Elle sollicite des ressources travaillées par les autres disciplines et peut ainsi débattre avec elles de questions comme les temporalités de la quotidienneté et des routines, la continuité entre modes d'action des professionnels et des profanes ou celle entre connaissance savante et connaissance commune.
Elle contribue ainsi, pour sa part, à interroger les relations entre philosophie et sciences sociales sous un jour renouvelé. L'historien, l'économiste, le philosophe, le sociologue, le linguiste et le politologue confrontent ici leurs expériences et leurs points de vue.
Des espaces d'interrogation ont ainsi été dégagés sous des notions telles que le pré-réflexif, le rapport pratique au monde, le sensible, l'informel. La science politique n'échappe pas à ce mouvement d'ensemble et elle est amenée aujourd'hui à reconsidérer ses objets constitués. Elle sollicite des ressources travaillées par les autres disciplines et peut ainsi débattre avec elles de questions comme les temporalités de la quotidienneté et des routines, la continuité entre modes d'action des professionnels et des profanes ou celle entre connaissance savante et connaissance commune.
Elle contribue ainsi, pour sa part, à interroger les relations entre philosophie et sciences sociales sous un jour renouvelé. L'historien, l'économiste, le philosophe, le sociologue, le linguiste et le politologue confrontent ici leurs expériences et leurs points de vue.
Il s'agit dans cet ouvrage d'ouvrir une large discussion méthodologique et conceptuelle sur les modes d'accès à la notion d'ordinaire et sur sa pertinence pour les sciences sociales et humaines. On constate en effet dans ces disciplines une mise en question grandissante d'un type de pensée qu'on appellera soit objectiviste, soit positiviste, soit même, rationaliste. Mise en question ouverte dès le début de ce siècle, notamment par la phénoménologie.
Des espaces d'interrogation ont ainsi été dégagés sous des notions telles que le pré-réflexif, le rapport pratique au monde, le sensible, l'informel. La science politique n'échappe pas à ce mouvement d'ensemble et elle est amenée aujourd'hui à reconsidérer ses objets constitués. Elle sollicite des ressources travaillées par les autres disciplines et peut ainsi débattre avec elles de questions comme les temporalités de la quotidienneté et des routines, la continuité entre modes d'action des professionnels et des profanes ou celle entre connaissance savante et connaissance commune.
Elle contribue ainsi, pour sa part, à interroger les relations entre philosophie et sciences sociales sous un jour renouvelé. L'historien, l'économiste, le philosophe, le sociologue, le linguiste et le politologue confrontent ici leurs expériences et leurs points de vue.
Des espaces d'interrogation ont ainsi été dégagés sous des notions telles que le pré-réflexif, le rapport pratique au monde, le sensible, l'informel. La science politique n'échappe pas à ce mouvement d'ensemble et elle est amenée aujourd'hui à reconsidérer ses objets constitués. Elle sollicite des ressources travaillées par les autres disciplines et peut ainsi débattre avec elles de questions comme les temporalités de la quotidienneté et des routines, la continuité entre modes d'action des professionnels et des profanes ou celle entre connaissance savante et connaissance commune.
Elle contribue ainsi, pour sa part, à interroger les relations entre philosophie et sciences sociales sous un jour renouvelé. L'historien, l'économiste, le philosophe, le sociologue, le linguiste et le politologue confrontent ici leurs expériences et leurs points de vue.