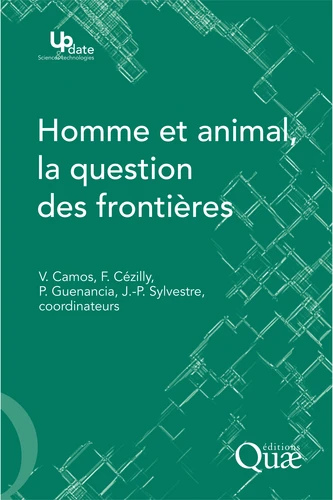Homme et animal, la question des frontières
Par : , , ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages214
- FormatMulti-format
- ISBN978-2-7592-0323-9
- EAN9782759203239
- Date de parution10/07/2009
- Protection num.NC
- Infos supplémentairesMulti-format incluant PDF avec W...
- ÉditeurQuae éditions
Résumé
Deux grands types de critiques convergent aujourd'hui pour remettre en question la thèse de la singularité radicale de l'homme. Au plan scientifique d'abord, de nombreux primatologues tendent à mettre en évidence que, du point de vue de l'identité psychologique comme de celui des performances cognitives, la différence entre les grands singes et l'homme ne serait pas de nature mais seulement de degrés.
D'une manière générale, la biologie de l'évolution ne nie pas l'existence de différences majeures entre l'homme et les animaux, même supérieurs, mais elle les réintroduit dans un paradigme continuiste, évolutionniste et non anthropocentré. La distinction entre l'homme et les autres animaux peut être maintenue, non pas tant comme une différence entre nature et culture, mais comme un ensemble de différences dans la nature.
Au plan éthique, des formes inédites d'appropriation des animaux vivants par l'homme ont conduit à instrumentaliser ces derniers. À cela s'ajoutent les menaces pesant sur les espèces sauvages en raison du développement des sociétés industrielles. Certains en viennent ainsi à admettre une véritable solidarité entre les formes de vie humaines et animales permettant de reconsidérer en profondeur les normes morales ou juridiques qui régentent et régulent l'ensemble des relations entre humains et non-humains.
Ce recueil n'a pas pour vocation d'apporter une réponse univoque à l'ensemble des problèmes posés. Il réunit des textes à caractère spéculatif et des observations plus empiriques. Écrit par des philosophes, des éthologues, des sociologues et des biologistes, il s'adresse aux étudiants et spécialistes des disciplines abordées ainsi qu'à tous les lecteurs que ce sujet, actuellement en débat, intéresse.
D'une manière générale, la biologie de l'évolution ne nie pas l'existence de différences majeures entre l'homme et les animaux, même supérieurs, mais elle les réintroduit dans un paradigme continuiste, évolutionniste et non anthropocentré. La distinction entre l'homme et les autres animaux peut être maintenue, non pas tant comme une différence entre nature et culture, mais comme un ensemble de différences dans la nature.
Au plan éthique, des formes inédites d'appropriation des animaux vivants par l'homme ont conduit à instrumentaliser ces derniers. À cela s'ajoutent les menaces pesant sur les espèces sauvages en raison du développement des sociétés industrielles. Certains en viennent ainsi à admettre une véritable solidarité entre les formes de vie humaines et animales permettant de reconsidérer en profondeur les normes morales ou juridiques qui régentent et régulent l'ensemble des relations entre humains et non-humains.
Ce recueil n'a pas pour vocation d'apporter une réponse univoque à l'ensemble des problèmes posés. Il réunit des textes à caractère spéculatif et des observations plus empiriques. Écrit par des philosophes, des éthologues, des sociologues et des biologistes, il s'adresse aux étudiants et spécialistes des disciplines abordées ainsi qu'à tous les lecteurs que ce sujet, actuellement en débat, intéresse.
Deux grands types de critiques convergent aujourd'hui pour remettre en question la thèse de la singularité radicale de l'homme. Au plan scientifique d'abord, de nombreux primatologues tendent à mettre en évidence que, du point de vue de l'identité psychologique comme de celui des performances cognitives, la différence entre les grands singes et l'homme ne serait pas de nature mais seulement de degrés.
D'une manière générale, la biologie de l'évolution ne nie pas l'existence de différences majeures entre l'homme et les animaux, même supérieurs, mais elle les réintroduit dans un paradigme continuiste, évolutionniste et non anthropocentré. La distinction entre l'homme et les autres animaux peut être maintenue, non pas tant comme une différence entre nature et culture, mais comme un ensemble de différences dans la nature.
Au plan éthique, des formes inédites d'appropriation des animaux vivants par l'homme ont conduit à instrumentaliser ces derniers. À cela s'ajoutent les menaces pesant sur les espèces sauvages en raison du développement des sociétés industrielles. Certains en viennent ainsi à admettre une véritable solidarité entre les formes de vie humaines et animales permettant de reconsidérer en profondeur les normes morales ou juridiques qui régentent et régulent l'ensemble des relations entre humains et non-humains.
Ce recueil n'a pas pour vocation d'apporter une réponse univoque à l'ensemble des problèmes posés. Il réunit des textes à caractère spéculatif et des observations plus empiriques. Écrit par des philosophes, des éthologues, des sociologues et des biologistes, il s'adresse aux étudiants et spécialistes des disciplines abordées ainsi qu'à tous les lecteurs que ce sujet, actuellement en débat, intéresse.
D'une manière générale, la biologie de l'évolution ne nie pas l'existence de différences majeures entre l'homme et les animaux, même supérieurs, mais elle les réintroduit dans un paradigme continuiste, évolutionniste et non anthropocentré. La distinction entre l'homme et les autres animaux peut être maintenue, non pas tant comme une différence entre nature et culture, mais comme un ensemble de différences dans la nature.
Au plan éthique, des formes inédites d'appropriation des animaux vivants par l'homme ont conduit à instrumentaliser ces derniers. À cela s'ajoutent les menaces pesant sur les espèces sauvages en raison du développement des sociétés industrielles. Certains en viennent ainsi à admettre une véritable solidarité entre les formes de vie humaines et animales permettant de reconsidérer en profondeur les normes morales ou juridiques qui régentent et régulent l'ensemble des relations entre humains et non-humains.
Ce recueil n'a pas pour vocation d'apporter une réponse univoque à l'ensemble des problèmes posés. Il réunit des textes à caractère spéculatif et des observations plus empiriques. Écrit par des philosophes, des éthologues, des sociologues et des biologistes, il s'adresse aux étudiants et spécialistes des disciplines abordées ainsi qu'à tous les lecteurs que ce sujet, actuellement en débat, intéresse.