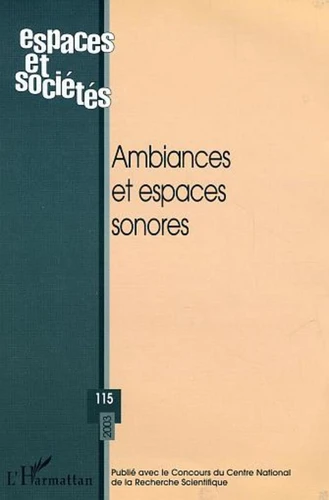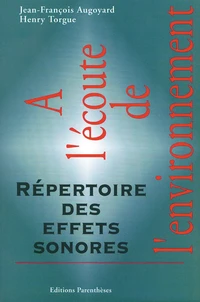Espaces et sociétés N° 115/2003
Ambiances et espaces sonores
Par : , , , , Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages268
- FormatPDF
- ISBN978-2-296-35316-9
- EAN9782296353169
- Date de parution04/04/2012
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille6 Mo
- Infos supplémentairespdf
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Ce numéro a pour but de faire connaître des travaux de sociologie, de psychologie, d'architecture, d'urbanisme, de géographie urbaine sur le bruit, et plus largement sur les ambiances et les espaces sonores, puisque les auteurs se sont réunis dans un commun refus de réduire le bruit à sa dimension négative. Les lectures diverses du phénomène sonore dans sa diversité donnent à penser qu'il faudrait construire une représentation plus qualitative et plus partagée de la gêne sonore.
Ce numéro a pour but de faire connaître des travaux de sociologie, de psychologie, d'architecture, d'urbanisme, de géographie urbaine sur le bruit, et plus largement sur les ambiances et les espaces sonores, puisque les auteurs se sont réunis dans un commun refus de réduire le bruit à sa dimension négative. Les lectures diverses du phénomène sonore dans sa diversité donnent à penser qu'il faudrait construire une représentation plus qualitative et plus partagée de la gêne sonore.