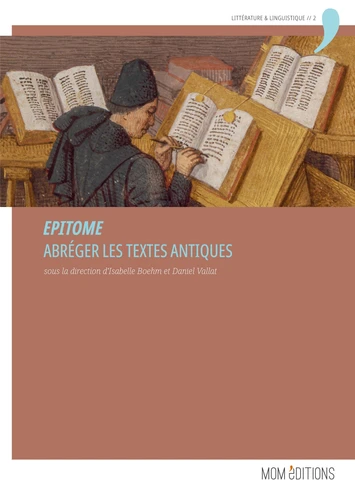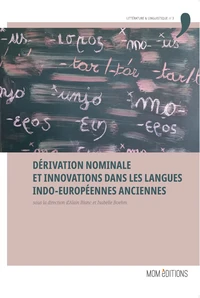Epitome. Abréger les textes antiques. Actes du colloque international de Lyon, 3 - 5 mai 2017
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages260
- FormatMulti-format
- ISBN978-2-35668-174-4
- EAN9782356681744
- Date de parution18/01/2021
- Protection num.NC
- Infos supplémentairesMulti-format incluant PDF avec W...
- ÉditeurMOM éditions
Résumé
L'usage de versions abrégées des ouvres littéraires de tous les domaines, de l'ouvrage de botanique à l'ensemble de l'ouvre d'un historien comme Tite-Live, est extrêmement courant dans l'Antiquité. Ces résumés ont des formes variées, qui vont des « sommaires » (periochae) à la sélection d'extraits (épitomé), en passant, entre autres, par la paraphrase ; l'absence de cadre théorique, dans le monde gréco-romain, explique une telle diversité.
Les contributeurs de ce volume se sont intéressés à des cas particuliers de résumés antiques, en s'interrogeant sur les pratiques à l'ouvre dans des domaines précis : les ouvrages scientifiques et techniques (médecine, astronomie, histoire) et le contexte rhétorique et scolaire (poésie, commentaires scolaires). Ils observent, chez les Anciens, un usage surprenant, pour le scientifique moderne, du résumé.
En effet certains savants, en Grèce et à Rome, au cours de la rédaction d'un ouvrage, n'hésitent pas à puiser dans des résumés, et non dans les ouvres intégrales, tandis que d'autres vont jusqu'à ajouter des éléments aux sources qu'ils abrègent, voire à « réinventer » l'ouvre qu'ils résument. Dans le contexte scolaire, les résumés ont un rôle particulièrement important, dont les épitomateurs anciens sont souvent parfaitement conscients : les suppressions et les modifications manifestent une attention particulière à tel ou tel lectorat et le résumé a ses propres enjeux dans la transmission de toutes les formes de littérature.
Les contributeurs de ce volume se sont intéressés à des cas particuliers de résumés antiques, en s'interrogeant sur les pratiques à l'ouvre dans des domaines précis : les ouvrages scientifiques et techniques (médecine, astronomie, histoire) et le contexte rhétorique et scolaire (poésie, commentaires scolaires). Ils observent, chez les Anciens, un usage surprenant, pour le scientifique moderne, du résumé.
En effet certains savants, en Grèce et à Rome, au cours de la rédaction d'un ouvrage, n'hésitent pas à puiser dans des résumés, et non dans les ouvres intégrales, tandis que d'autres vont jusqu'à ajouter des éléments aux sources qu'ils abrègent, voire à « réinventer » l'ouvre qu'ils résument. Dans le contexte scolaire, les résumés ont un rôle particulièrement important, dont les épitomateurs anciens sont souvent parfaitement conscients : les suppressions et les modifications manifestent une attention particulière à tel ou tel lectorat et le résumé a ses propres enjeux dans la transmission de toutes les formes de littérature.
L'usage de versions abrégées des ouvres littéraires de tous les domaines, de l'ouvrage de botanique à l'ensemble de l'ouvre d'un historien comme Tite-Live, est extrêmement courant dans l'Antiquité. Ces résumés ont des formes variées, qui vont des « sommaires » (periochae) à la sélection d'extraits (épitomé), en passant, entre autres, par la paraphrase ; l'absence de cadre théorique, dans le monde gréco-romain, explique une telle diversité.
Les contributeurs de ce volume se sont intéressés à des cas particuliers de résumés antiques, en s'interrogeant sur les pratiques à l'ouvre dans des domaines précis : les ouvrages scientifiques et techniques (médecine, astronomie, histoire) et le contexte rhétorique et scolaire (poésie, commentaires scolaires). Ils observent, chez les Anciens, un usage surprenant, pour le scientifique moderne, du résumé.
En effet certains savants, en Grèce et à Rome, au cours de la rédaction d'un ouvrage, n'hésitent pas à puiser dans des résumés, et non dans les ouvres intégrales, tandis que d'autres vont jusqu'à ajouter des éléments aux sources qu'ils abrègent, voire à « réinventer » l'ouvre qu'ils résument. Dans le contexte scolaire, les résumés ont un rôle particulièrement important, dont les épitomateurs anciens sont souvent parfaitement conscients : les suppressions et les modifications manifestent une attention particulière à tel ou tel lectorat et le résumé a ses propres enjeux dans la transmission de toutes les formes de littérature.
Les contributeurs de ce volume se sont intéressés à des cas particuliers de résumés antiques, en s'interrogeant sur les pratiques à l'ouvre dans des domaines précis : les ouvrages scientifiques et techniques (médecine, astronomie, histoire) et le contexte rhétorique et scolaire (poésie, commentaires scolaires). Ils observent, chez les Anciens, un usage surprenant, pour le scientifique moderne, du résumé.
En effet certains savants, en Grèce et à Rome, au cours de la rédaction d'un ouvrage, n'hésitent pas à puiser dans des résumés, et non dans les ouvres intégrales, tandis que d'autres vont jusqu'à ajouter des éléments aux sources qu'ils abrègent, voire à « réinventer » l'ouvre qu'ils résument. Dans le contexte scolaire, les résumés ont un rôle particulièrement important, dont les épitomateurs anciens sont souvent parfaitement conscients : les suppressions et les modifications manifestent une attention particulière à tel ou tel lectorat et le résumé a ses propres enjeux dans la transmission de toutes les formes de littérature.