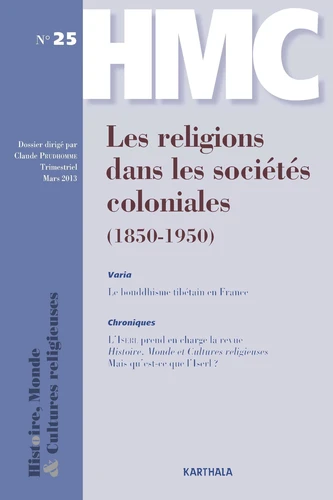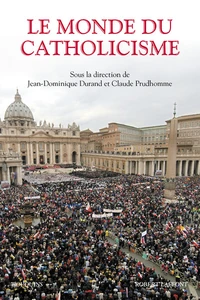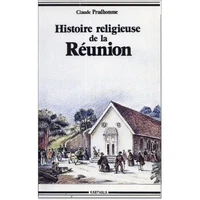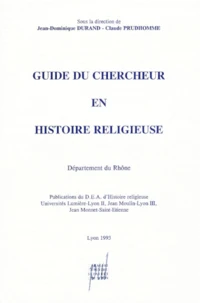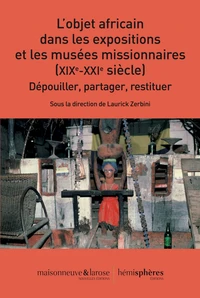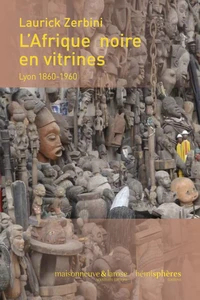Histoire, Monde et Cultures religieuses N° 25
Les religions dans les sociétés coloniales (1850 - 1950)
Par : Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages190
- PrésentationBroché
- Poids0.22 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,0 cm
- ISBN978-2-8111-0927-1
- EAN9782811109271
- Date de parution29/05/2013
- ÉditeurKarthala
Résumé
Dirigé par Claude Prudhomme, avec les contributions de Philippe Delisle, Jean Pirotte, Oissila Saaïdia. La décision de mettre au programme des concours destinés au recrutement des enseignants d’histoire (Capes et agrégation) l’étude des sociétés coloniales entre 1850 et 1950 s’inscrit dans un mouvement international pour reprendre l’étude du fait colonial à partir de nouvelles approches. Le succès rencontré dans le monde anglo-saxon et dans les pays de langue française par les post-colonial studies ou études postcoloniales n’y est sans doute pas étranger.
Mais il ne faudrait pas y voir un simple effet de mode. La colonisation a constitué une étape essentielle dans la globalisation et l’Empire britannique a été le premier exemple d’un système monde. Le choix des sociétés coloniales souligne en outre la volonté de mettre au centre de l’étude les hommes et les femmes qui ont vécu dans cette configuration historique particulière. La question invite à réfléchir à tous les domaines de leur existence individuelle ou collective, en particulier dans leur dimension religieuse.
C’est à un bilan des travaux consacrés aux religions dans les colonies que ce dossier s’attache avant de présenter trois configurations différentes : les sociétés créoles insulaires (Antilles et Mascareignes), le Congo belge, les mondes musulmans sous colonisation britannique et française.
Mais il ne faudrait pas y voir un simple effet de mode. La colonisation a constitué une étape essentielle dans la globalisation et l’Empire britannique a été le premier exemple d’un système monde. Le choix des sociétés coloniales souligne en outre la volonté de mettre au centre de l’étude les hommes et les femmes qui ont vécu dans cette configuration historique particulière. La question invite à réfléchir à tous les domaines de leur existence individuelle ou collective, en particulier dans leur dimension religieuse.
C’est à un bilan des travaux consacrés aux religions dans les colonies que ce dossier s’attache avant de présenter trois configurations différentes : les sociétés créoles insulaires (Antilles et Mascareignes), le Congo belge, les mondes musulmans sous colonisation britannique et française.
Dirigé par Claude Prudhomme, avec les contributions de Philippe Delisle, Jean Pirotte, Oissila Saaïdia. La décision de mettre au programme des concours destinés au recrutement des enseignants d’histoire (Capes et agrégation) l’étude des sociétés coloniales entre 1850 et 1950 s’inscrit dans un mouvement international pour reprendre l’étude du fait colonial à partir de nouvelles approches. Le succès rencontré dans le monde anglo-saxon et dans les pays de langue française par les post-colonial studies ou études postcoloniales n’y est sans doute pas étranger.
Mais il ne faudrait pas y voir un simple effet de mode. La colonisation a constitué une étape essentielle dans la globalisation et l’Empire britannique a été le premier exemple d’un système monde. Le choix des sociétés coloniales souligne en outre la volonté de mettre au centre de l’étude les hommes et les femmes qui ont vécu dans cette configuration historique particulière. La question invite à réfléchir à tous les domaines de leur existence individuelle ou collective, en particulier dans leur dimension religieuse.
C’est à un bilan des travaux consacrés aux religions dans les colonies que ce dossier s’attache avant de présenter trois configurations différentes : les sociétés créoles insulaires (Antilles et Mascareignes), le Congo belge, les mondes musulmans sous colonisation britannique et française.
Mais il ne faudrait pas y voir un simple effet de mode. La colonisation a constitué une étape essentielle dans la globalisation et l’Empire britannique a été le premier exemple d’un système monde. Le choix des sociétés coloniales souligne en outre la volonté de mettre au centre de l’étude les hommes et les femmes qui ont vécu dans cette configuration historique particulière. La question invite à réfléchir à tous les domaines de leur existence individuelle ou collective, en particulier dans leur dimension religieuse.
C’est à un bilan des travaux consacrés aux religions dans les colonies que ce dossier s’attache avant de présenter trois configurations différentes : les sociétés créoles insulaires (Antilles et Mascareignes), le Congo belge, les mondes musulmans sous colonisation britannique et française.