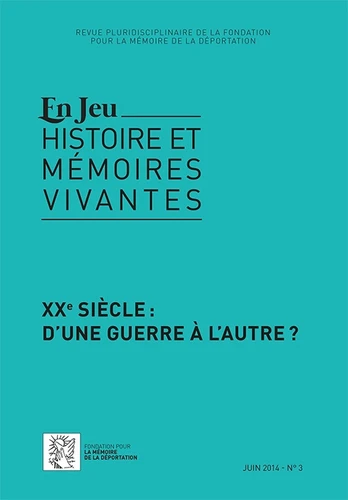En Jeu N° 3, juin 2014
XXe siècle : d'une guerre à l'autre ?
Par : , Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages196
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Dimensions16,0 cm × 23,0 cm × 0,0 cm
- ISBN978-2-9509877-2-3
- EAN9782950987723
- Date de parution01/06/2014
- ÉditeurFondation mémoire déportation
Résumé
Au-delà de la concomitance en 2014 de commémorations liées aux eux guerres mondiales, le présent dossier propose de nous pencher sur l'analyse critique des séquençages chronologiques, des constructions causales et des liens téléologiques qui président aux périodisations historiques et à la mise en évidence des aspects dits "matriciels" d'un XXe siècle guerrier. Si la focale du dossier est centrée sur la séquence 1914-1945, nous avons tenu à élargir l'ère aussi bien géopolitique que chronologique de ce questionnement global, en désenclavant cette séquence devenue "canonique" .
Ainsi, en complément des contributions abordant de façon privilégiée les configurations historiographiques propres à l'Ouest européen (Fréderic Rousseau et notre entretien avec les historiens André Loez et Nicolas Mariot), on trouvera des éclairages particulièrement féconds sur l'évolution des mémoires et des historiographies à l'Est (Francoise Mayer et Helena Trnkova). Animés par ce même souci d'élargissement de notre questionnaire dans le temps et dans l'espace, nous avons fait place à des analyses de conflits guerriers plus singuliers - mais non moins importants - comme la guerre de Corée (Laurent Quisefit) et les conflits des Grands Lacs en Afrique (Agathe Plauchut).
Il en ressort une complexité chargée de tensions interprétatives loin des simplifications et des partis pris idéologiques que charrient les doxas et les vulgates en cours. La guerre n'étant pas la "propriété" des historiens, nous avons voulu voir également comment la littérature, et singulièrement le roman historique engagé, abordent ce XXe siècle guerrier et quel pourrait être leur apport à l'historiographie critique (Aurore Peyroles).
Enfin, pour clore de dossier, notre "Chronique des enjeux d'histoire scolaire" s'attache à analyser la confusion des deux guerres mondiales comme obstacle à l'intelligibilité du XXe siècle, non seulement dans l'espace public mais aussi dans l'enseignement (Laurence De Cock et Chales Heimberg).
Ainsi, en complément des contributions abordant de façon privilégiée les configurations historiographiques propres à l'Ouest européen (Fréderic Rousseau et notre entretien avec les historiens André Loez et Nicolas Mariot), on trouvera des éclairages particulièrement féconds sur l'évolution des mémoires et des historiographies à l'Est (Francoise Mayer et Helena Trnkova). Animés par ce même souci d'élargissement de notre questionnaire dans le temps et dans l'espace, nous avons fait place à des analyses de conflits guerriers plus singuliers - mais non moins importants - comme la guerre de Corée (Laurent Quisefit) et les conflits des Grands Lacs en Afrique (Agathe Plauchut).
Il en ressort une complexité chargée de tensions interprétatives loin des simplifications et des partis pris idéologiques que charrient les doxas et les vulgates en cours. La guerre n'étant pas la "propriété" des historiens, nous avons voulu voir également comment la littérature, et singulièrement le roman historique engagé, abordent ce XXe siècle guerrier et quel pourrait être leur apport à l'historiographie critique (Aurore Peyroles).
Enfin, pour clore de dossier, notre "Chronique des enjeux d'histoire scolaire" s'attache à analyser la confusion des deux guerres mondiales comme obstacle à l'intelligibilité du XXe siècle, non seulement dans l'espace public mais aussi dans l'enseignement (Laurence De Cock et Chales Heimberg).
Au-delà de la concomitance en 2014 de commémorations liées aux eux guerres mondiales, le présent dossier propose de nous pencher sur l'analyse critique des séquençages chronologiques, des constructions causales et des liens téléologiques qui président aux périodisations historiques et à la mise en évidence des aspects dits "matriciels" d'un XXe siècle guerrier. Si la focale du dossier est centrée sur la séquence 1914-1945, nous avons tenu à élargir l'ère aussi bien géopolitique que chronologique de ce questionnement global, en désenclavant cette séquence devenue "canonique" .
Ainsi, en complément des contributions abordant de façon privilégiée les configurations historiographiques propres à l'Ouest européen (Fréderic Rousseau et notre entretien avec les historiens André Loez et Nicolas Mariot), on trouvera des éclairages particulièrement féconds sur l'évolution des mémoires et des historiographies à l'Est (Francoise Mayer et Helena Trnkova). Animés par ce même souci d'élargissement de notre questionnaire dans le temps et dans l'espace, nous avons fait place à des analyses de conflits guerriers plus singuliers - mais non moins importants - comme la guerre de Corée (Laurent Quisefit) et les conflits des Grands Lacs en Afrique (Agathe Plauchut).
Il en ressort une complexité chargée de tensions interprétatives loin des simplifications et des partis pris idéologiques que charrient les doxas et les vulgates en cours. La guerre n'étant pas la "propriété" des historiens, nous avons voulu voir également comment la littérature, et singulièrement le roman historique engagé, abordent ce XXe siècle guerrier et quel pourrait être leur apport à l'historiographie critique (Aurore Peyroles).
Enfin, pour clore de dossier, notre "Chronique des enjeux d'histoire scolaire" s'attache à analyser la confusion des deux guerres mondiales comme obstacle à l'intelligibilité du XXe siècle, non seulement dans l'espace public mais aussi dans l'enseignement (Laurence De Cock et Chales Heimberg).
Ainsi, en complément des contributions abordant de façon privilégiée les configurations historiographiques propres à l'Ouest européen (Fréderic Rousseau et notre entretien avec les historiens André Loez et Nicolas Mariot), on trouvera des éclairages particulièrement féconds sur l'évolution des mémoires et des historiographies à l'Est (Francoise Mayer et Helena Trnkova). Animés par ce même souci d'élargissement de notre questionnaire dans le temps et dans l'espace, nous avons fait place à des analyses de conflits guerriers plus singuliers - mais non moins importants - comme la guerre de Corée (Laurent Quisefit) et les conflits des Grands Lacs en Afrique (Agathe Plauchut).
Il en ressort une complexité chargée de tensions interprétatives loin des simplifications et des partis pris idéologiques que charrient les doxas et les vulgates en cours. La guerre n'étant pas la "propriété" des historiens, nous avons voulu voir également comment la littérature, et singulièrement le roman historique engagé, abordent ce XXe siècle guerrier et quel pourrait être leur apport à l'historiographie critique (Aurore Peyroles).
Enfin, pour clore de dossier, notre "Chronique des enjeux d'histoire scolaire" s'attache à analyser la confusion des deux guerres mondiales comme obstacle à l'intelligibilité du XXe siècle, non seulement dans l'espace public mais aussi dans l'enseignement (Laurence De Cock et Chales Heimberg).