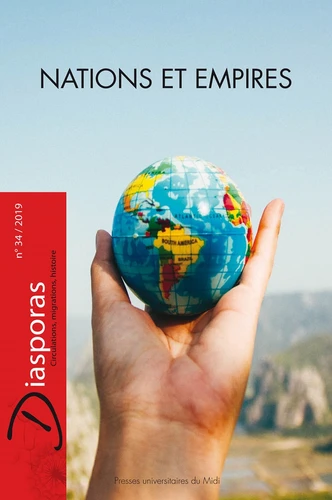Diasporas N° 34/2019
Nations et empires
Par : , Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages156
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.268 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 0,9 cm
- ISBN978-2-8107-0658-7
- EAN9782810706587
- Date de parution03/01/2020
- ÉditeurPresses universitaires du Midi
Résumé
Longtemps considéré à l'aune des modèles grecs et juifs, et des revendications que certains groupes portaient pour un Etat-nation aux XIXe et XXe siècles, le rapport entre diasporas, nations et Etat-nation a longtemps semblé évident. La prolifération des études diasporiques et la nouvelle histoire des empires a fini par rendre ce rapport plus complexe et compliqué. Ce volume met en perspective les époques modernes et contemporaines, les espace européens, américains et africains : comment imaginait-on "nation" et "Etat" dans l'Europe de l'époque moderne, puis avec les révolutions atlantiques et l'émergence de l'Etat-nation vers la fin du XVIIIe siècle ? A l'époque moderne, les empires utilisaient des groupes diasporiques, des "nations étrangères" , dans le processus d'expansion européenne.
Elles devenaient "des agents et des victimes des empires" (J. Israel). Qu'en est-il, pour les XIXe et XXe siècles, de l'exil des "nationalistes" italiens ou polonais à Paris et à Bruxelles qui produisent des "nationalismes" internationaux (M. Isabella) et mettent ainsi en avant l'aspect transnational des nationalismes ? Et qu'en est-il des contextes postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle ? Les contributions de ce numéro, qui envisage une approche chronologique large (du XVe au XXIe siècle), permettront de faire dialoguer des champs historiographiques, histoire de l'Europe moderne, histoire de l'Etat-nation du XIXe siècle, Etats africains postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle, qui ne se croisent que rarement.
Elles devenaient "des agents et des victimes des empires" (J. Israel). Qu'en est-il, pour les XIXe et XXe siècles, de l'exil des "nationalistes" italiens ou polonais à Paris et à Bruxelles qui produisent des "nationalismes" internationaux (M. Isabella) et mettent ainsi en avant l'aspect transnational des nationalismes ? Et qu'en est-il des contextes postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle ? Les contributions de ce numéro, qui envisage une approche chronologique large (du XVe au XXIe siècle), permettront de faire dialoguer des champs historiographiques, histoire de l'Europe moderne, histoire de l'Etat-nation du XIXe siècle, Etats africains postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle, qui ne se croisent que rarement.
Longtemps considéré à l'aune des modèles grecs et juifs, et des revendications que certains groupes portaient pour un Etat-nation aux XIXe et XXe siècles, le rapport entre diasporas, nations et Etat-nation a longtemps semblé évident. La prolifération des études diasporiques et la nouvelle histoire des empires a fini par rendre ce rapport plus complexe et compliqué. Ce volume met en perspective les époques modernes et contemporaines, les espace européens, américains et africains : comment imaginait-on "nation" et "Etat" dans l'Europe de l'époque moderne, puis avec les révolutions atlantiques et l'émergence de l'Etat-nation vers la fin du XVIIIe siècle ? A l'époque moderne, les empires utilisaient des groupes diasporiques, des "nations étrangères" , dans le processus d'expansion européenne.
Elles devenaient "des agents et des victimes des empires" (J. Israel). Qu'en est-il, pour les XIXe et XXe siècles, de l'exil des "nationalistes" italiens ou polonais à Paris et à Bruxelles qui produisent des "nationalismes" internationaux (M. Isabella) et mettent ainsi en avant l'aspect transnational des nationalismes ? Et qu'en est-il des contextes postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle ? Les contributions de ce numéro, qui envisage une approche chronologique large (du XVe au XXIe siècle), permettront de faire dialoguer des champs historiographiques, histoire de l'Europe moderne, histoire de l'Etat-nation du XIXe siècle, Etats africains postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle, qui ne se croisent que rarement.
Elles devenaient "des agents et des victimes des empires" (J. Israel). Qu'en est-il, pour les XIXe et XXe siècles, de l'exil des "nationalistes" italiens ou polonais à Paris et à Bruxelles qui produisent des "nationalismes" internationaux (M. Isabella) et mettent ainsi en avant l'aspect transnational des nationalismes ? Et qu'en est-il des contextes postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle ? Les contributions de ce numéro, qui envisage une approche chronologique large (du XVe au XXIe siècle), permettront de faire dialoguer des champs historiographiques, histoire de l'Europe moderne, histoire de l'Etat-nation du XIXe siècle, Etats africains postcoloniaux de la deuxième moitié du XXe siècle, qui ne se croisent que rarement.