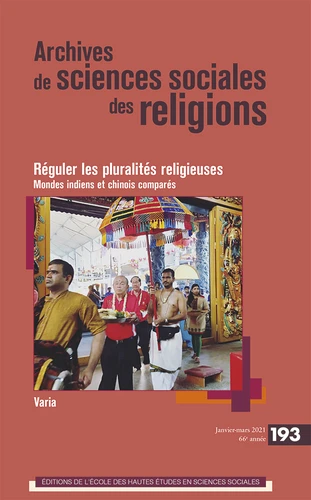Archives de sciences sociales des religions N° 193, janvier - mars 2021
Réguler les pluralités religieuses. Mondes indiens et chinois comparés
Par : , , , Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages256
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.42 kg
- Dimensions15,7 cm × 24,0 cm × 1,6 cm
- ISBN978-2-7132-2870-4
- EAN9782713228704
- Date de parution22/04/2021
- ÉditeurEHESS
Résumé
La comparaison directe entre les mondes religieux chinois et indien a rarement été conduite. C'est un paradoxe, car l'une des caractéristiques fondamentales communes aux sociétés indienne et chinoise est la cohabitation très ancienne de toutes les formes de religion : cultes médiumniques, de possession et de guérison ; cultes sacrificiels à des divinités locales ; cultes des ancêtres ou des défunts ; traditions ascétiques, monastiques ou spirituelles ; institutions religieuses supra-locales de type "Eglise" , structurées et reconnues par l'Etat ; mouvements de réforme religieuse modernes et contemporains, certains nationalistes, d'autres universalistes.
Ces traits communs ne doivent pourtant pas dissimuler la profondeur des écarts : d'un monde à l'autre, les modalités de division du travail religieux diffèrent autant que les modes de régulation des pratiques religieuses par l'Etat. C'est à ce travail de comparaison que s'attachent historiens et anthropologues réunis dans le dossier thématique "Réguler les pluralités religieuses : mondes indiens et chinois comparés" .
Le dossier est suivi de deux "varias" , "Modalités de l'extension d'une temporalité sacrée : la marche d'Arba'? n en Iran contemporain, entre logiques spirituelles et sociopolitiques" et "Le crime de sollicitation réinventé : Le Saint-Office face aux crimes sexuels des clercs (1916-1939)" .
Ces traits communs ne doivent pourtant pas dissimuler la profondeur des écarts : d'un monde à l'autre, les modalités de division du travail religieux diffèrent autant que les modes de régulation des pratiques religieuses par l'Etat. C'est à ce travail de comparaison que s'attachent historiens et anthropologues réunis dans le dossier thématique "Réguler les pluralités religieuses : mondes indiens et chinois comparés" .
Le dossier est suivi de deux "varias" , "Modalités de l'extension d'une temporalité sacrée : la marche d'Arba'? n en Iran contemporain, entre logiques spirituelles et sociopolitiques" et "Le crime de sollicitation réinventé : Le Saint-Office face aux crimes sexuels des clercs (1916-1939)" .
La comparaison directe entre les mondes religieux chinois et indien a rarement été conduite. C'est un paradoxe, car l'une des caractéristiques fondamentales communes aux sociétés indienne et chinoise est la cohabitation très ancienne de toutes les formes de religion : cultes médiumniques, de possession et de guérison ; cultes sacrificiels à des divinités locales ; cultes des ancêtres ou des défunts ; traditions ascétiques, monastiques ou spirituelles ; institutions religieuses supra-locales de type "Eglise" , structurées et reconnues par l'Etat ; mouvements de réforme religieuse modernes et contemporains, certains nationalistes, d'autres universalistes.
Ces traits communs ne doivent pourtant pas dissimuler la profondeur des écarts : d'un monde à l'autre, les modalités de division du travail religieux diffèrent autant que les modes de régulation des pratiques religieuses par l'Etat. C'est à ce travail de comparaison que s'attachent historiens et anthropologues réunis dans le dossier thématique "Réguler les pluralités religieuses : mondes indiens et chinois comparés" .
Le dossier est suivi de deux "varias" , "Modalités de l'extension d'une temporalité sacrée : la marche d'Arba'? n en Iran contemporain, entre logiques spirituelles et sociopolitiques" et "Le crime de sollicitation réinventé : Le Saint-Office face aux crimes sexuels des clercs (1916-1939)" .
Ces traits communs ne doivent pourtant pas dissimuler la profondeur des écarts : d'un monde à l'autre, les modalités de division du travail religieux diffèrent autant que les modes de régulation des pratiques religieuses par l'Etat. C'est à ce travail de comparaison que s'attachent historiens et anthropologues réunis dans le dossier thématique "Réguler les pluralités religieuses : mondes indiens et chinois comparés" .
Le dossier est suivi de deux "varias" , "Modalités de l'extension d'une temporalité sacrée : la marche d'Arba'? n en Iran contemporain, entre logiques spirituelles et sociopolitiques" et "Le crime de sollicitation réinventé : Le Saint-Office face aux crimes sexuels des clercs (1916-1939)" .