Retour



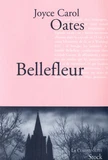
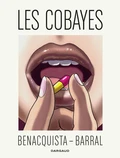
Les dernières notes et avis
Notes et avis 1 à 8 sur un total de 56
La Part de l'autre
Avis posté le 2014-06-22
Adolf H.
Grosse prise de risque pour l'auteur et véritable coup de cœur à l'arrivée !
Eric-Emmanuel Schmitt a décidé de prendre Hitler comme sujet de son roman. Comme il l'explique dans son journal, contre l'avis de certains de ses proches, il a voulu comprendre le dictateur. Comme il le dit : "Comprendre n'est pas justifier".
La construction du roman participe à sa réussite. L'auteur raconte en parallèle la vie d'Hitler, le vrai, celui qui rate le concours d'entrée à l'Ecole des Beaux-Arts et qui se suicidera dans son bunker et la vie d'Adolf H. qui est accepté à l'Ecole des Beaux-Arts, qui vivra tant bien que mal de sa peinture.
Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que l'auteur ne considère pas que le hasard seul a créé un tel monstre. Tout est une question de choix. Hitler ne perçoit pas le refus des Beaux-Arts comme il le devrait. Au lieu de réaliser ses lacunes et son absence de talent, il y voit la bêtise et le mauvais goût de ses professeurs. Adolf H. a conscience du travail à effectuer. Hitler a un problème avec les femmes qu'il ne réglera jamais. Longtemps vierge, il déteste son corps et celui des autres. Les femmes qui l'aimeront se suicideront ou tenteront de se suicides. Adolf H. a également un problème avec les femmes et la nudité mais se fera soigner. L'auteur invente alors une scène improbable entre Hitler et Freud.
Alors que nous sommes évidemment horrifiés par la naissance d'Hitler, homme sans charme, sans charisme, et à qui seul la haine, et en particulier l'antisémitisme, donnera l'éloquence. Mais Adolf F. nous ressemble, ressent des émotions que nous connaissons, à tel point que l'on oublie qu'il est Hitler, lui aussi. Ce sont les personnages de femmes en particulier qui rendent Adolf F. si humain. Le personnage Onze Heure Trente est charmant, touchant, attachant. Dans son journal, l'auteur nous fait comprendre qu'elle est inspirée d'une femme qu'il a aimée et ça se ressent !
L'auteur ne s'attarde pas sur l'antisémitisme ou les camps de la mort. Pourtant, les faits historiques sont là et le contexte est justement rapporté. Autre originalité du roman, l'auteur a voulu imaginer le monde sans Hitler, en particulier l'Allemagne sans Hitler. En effet, dans le monde d' Adolf H., pas de dictature, pas de déportation. Il imagine alors une Allemagne surpuissante, un Allemand marchant pour la première fois sur la Lune !
En résumé un excellent roman, construit avec beaucoup d’intelligence, et avec une écriture très agréable. J’avais déjà pu apprécier le style de l’auteur dans Oscar et la dame en rose, je suis désormais totalement conquise !
« Il n’y a aucun arbitraire mais un principe philosophique et une visée éthique : j’élabore un double portrait antagoniste. Adolf H. cherche à se comprendre tandis que le véritable Hitler s’ignore. Adolf H. reconnait en lui l’existence de problèmes tandis qu’Hitler les enterre. Adolf H. guérit et s’ouvre aux autres tandis qu’Hitler s’enfonce dans sa névrose en se coupant de tous rapports humains. Adolf H. affronte la réalité tandis qu’Hitler la nie dès qu’elle contrarie ses désirs. Adolf F. apprend l’humilité tandis qu’Hitler devient le Führer, un dieu vivant. Adolf H. s’ouvre au monde ; Hitler le détruit pour le refaire »
Journal de La part de l’autre publié en postface
Grosse prise de risque pour l'auteur et véritable coup de cœur à l'arrivée !
Eric-Emmanuel Schmitt a décidé de prendre Hitler comme sujet de son roman. Comme il l'explique dans son journal, contre l'avis de certains de ses proches, il a voulu comprendre le dictateur. Comme il le dit : "Comprendre n'est pas justifier".
La construction du roman participe à sa réussite. L'auteur raconte en parallèle la vie d'Hitler, le vrai, celui qui rate le concours d'entrée à l'Ecole des Beaux-Arts et qui se suicidera dans son bunker et la vie d'Adolf H. qui est accepté à l'Ecole des Beaux-Arts, qui vivra tant bien que mal de sa peinture.
Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que l'auteur ne considère pas que le hasard seul a créé un tel monstre. Tout est une question de choix. Hitler ne perçoit pas le refus des Beaux-Arts comme il le devrait. Au lieu de réaliser ses lacunes et son absence de talent, il y voit la bêtise et le mauvais goût de ses professeurs. Adolf H. a conscience du travail à effectuer. Hitler a un problème avec les femmes qu'il ne réglera jamais. Longtemps vierge, il déteste son corps et celui des autres. Les femmes qui l'aimeront se suicideront ou tenteront de se suicides. Adolf H. a également un problème avec les femmes et la nudité mais se fera soigner. L'auteur invente alors une scène improbable entre Hitler et Freud.
Alors que nous sommes évidemment horrifiés par la naissance d'Hitler, homme sans charme, sans charisme, et à qui seul la haine, et en particulier l'antisémitisme, donnera l'éloquence. Mais Adolf F. nous ressemble, ressent des émotions que nous connaissons, à tel point que l'on oublie qu'il est Hitler, lui aussi. Ce sont les personnages de femmes en particulier qui rendent Adolf F. si humain. Le personnage Onze Heure Trente est charmant, touchant, attachant. Dans son journal, l'auteur nous fait comprendre qu'elle est inspirée d'une femme qu'il a aimée et ça se ressent !
L'auteur ne s'attarde pas sur l'antisémitisme ou les camps de la mort. Pourtant, les faits historiques sont là et le contexte est justement rapporté. Autre originalité du roman, l'auteur a voulu imaginer le monde sans Hitler, en particulier l'Allemagne sans Hitler. En effet, dans le monde d' Adolf H., pas de dictature, pas de déportation. Il imagine alors une Allemagne surpuissante, un Allemand marchant pour la première fois sur la Lune !
En résumé un excellent roman, construit avec beaucoup d’intelligence, et avec une écriture très agréable. J’avais déjà pu apprécier le style de l’auteur dans Oscar et la dame en rose, je suis désormais totalement conquise !
« Il n’y a aucun arbitraire mais un principe philosophique et une visée éthique : j’élabore un double portrait antagoniste. Adolf H. cherche à se comprendre tandis que le véritable Hitler s’ignore. Adolf H. reconnait en lui l’existence de problèmes tandis qu’Hitler les enterre. Adolf H. guérit et s’ouvre aux autres tandis qu’Hitler s’enfonce dans sa névrose en se coupant de tous rapports humains. Adolf H. affronte la réalité tandis qu’Hitler la nie dès qu’elle contrarie ses désirs. Adolf F. apprend l’humilité tandis qu’Hitler devient le Führer, un dieu vivant. Adolf H. s’ouvre au monde ; Hitler le détruit pour le refaire »
Journal de La part de l’autre publié en postface

Le roman du mariage
Avis posté le 2014-06-09
Roman du triangle amoureux
Dans l’Amérique des années 1980, une fille et deux garçons sont sur le point de recevoir leur diplôme sur le campus de Brown. Madeleine, passionnée de littérature et surtout de romans de l’époque victorienne, étudie la question du mariage dans le roman anglais. Le jour de la remise des diplômes, elle renoue avec Mitchell, étudiant en théologie, qu’elle a repoussé quelques temps auparavant et se retrouve au chevet de Léonard, son ex-petit ami maniaco-dépressif. Madeleine se retrouve au cœur d’un dilemme : doit-elle choisir le brillant et ténébreux Léonard ou bien Mitchell, le prétendant idéal ?
Le roman du mariage est le deuxième roman de Jeffrey Eugenides que je lis. Ma première découverte avec cet auteur a eu lieu autour de Virgin Suicides. J’avais adoré ce film et avais naturellement voulu découvrir ses origines. Je pense que mon amour pour le film m’a empêchée d’aimer le roman. Malgré tout, j’avais trouvé le style de l’auteur intéressant. Je n’ai donc pas lu son chef-d’œuvre Middlesex. Une fois encore, je suis séduite par le style de l’auteur. Par sa capacité à décrire avec finesse ses personnages et à les mettre en scène, son roman m’a fait penser à Freedom de Jonathan Franzen.
J’aime particulièrement les romans « campus », tout simplement parce que je me rêve moi-même étudiante à Yale ! Ici, le cadre permet à l’auteur de nous offrir tout un tas de références littéraires de façon subtile et documentée : on croise entre autres Jane Austen, Roland Barthes, Saint-Augustin,… Mais les trois personnages doivent apprendre à vivre avec leur temps et se détacher de ces grands noms. Madeleine tombe de haut quand elle découvre qu’en épousant Léonard, elle épouse sa maladie. Léonard, quant à lui, est sans arrêt sur un fil, se raccrochant désespérément à Madeleine, qui n’avait pas envisagé son entrée dans le monde des adultes de cette manière. De son côté Mitchell est en quête de spiritualité. Il cherche surtout à oublier Madeleine après avoir déjà essuyé quelques refus. Les descriptions des personnages de Jeffrey Eugenides sont assez cliniques, pourtant il parvient à les rendre vivants et surtout humains, avec leurs qualités mais surtout leurs failles.
Plus qu’un « roman du mariage », il s’agit d’un « roman d’amours ». Le thème du triangle amoureux a été vu et revu mais l’auteur réussit à le prendre sous un angle nouveau. Il n’y a qu’un couple dans ce livre : Madeleine et Léonard. Mitchell gravite autour, vit seul ses propres sentiments. Parfois évidemment, et sinon ce ne serait pas un triangle, Mitchell et Madeleine se rapprochent mais comme nous ne sommes pas dans un roman Harlequin une histoire d’amour ne vient pas en chasser une autre. Mitchell semble représenter les aspirations réelles de Madeleine, tandis que Léonard est du côté du fantasme, du danger, de la rébellion. Là encore, on tiendrait le scénario idéal pour un mauvais roman à l’eau de rose si l’auteur ne dépassait pas cet intrigue basique pour dire plus, pour raconter une époque (les années 1980 aux Etats-Unis), pour confronter des idéaux à une réalité plus cruelle. Madeleine n’est pas une héroïne romantique, elle est un personnage ancré dans son époque, saisie à une étape charnière de sa vie (la fin de l’université) qui va devoir faire un choix.
Il y a malgré tout quelques longueurs dans ce livre, notamment lors de certaines étapes du cheminement spirituel de Mitchell. Son voyage à travers l’Europe puis l’Asie est beaucoup mieux raconté et plus offre plus d’intérêt.
En résumé, je conseille cette lecture, car l’auteur parvient très vite à nous entraîner dans son récit. Les personnages sont parfois insupportables, preuve qu’ils sont réalistes. Les sentiments sont décrits de manière chirurgicale mais sont rendus avec beaucoup de justesse.
Dans l’Amérique des années 1980, une fille et deux garçons sont sur le point de recevoir leur diplôme sur le campus de Brown. Madeleine, passionnée de littérature et surtout de romans de l’époque victorienne, étudie la question du mariage dans le roman anglais. Le jour de la remise des diplômes, elle renoue avec Mitchell, étudiant en théologie, qu’elle a repoussé quelques temps auparavant et se retrouve au chevet de Léonard, son ex-petit ami maniaco-dépressif. Madeleine se retrouve au cœur d’un dilemme : doit-elle choisir le brillant et ténébreux Léonard ou bien Mitchell, le prétendant idéal ?
Le roman du mariage est le deuxième roman de Jeffrey Eugenides que je lis. Ma première découverte avec cet auteur a eu lieu autour de Virgin Suicides. J’avais adoré ce film et avais naturellement voulu découvrir ses origines. Je pense que mon amour pour le film m’a empêchée d’aimer le roman. Malgré tout, j’avais trouvé le style de l’auteur intéressant. Je n’ai donc pas lu son chef-d’œuvre Middlesex. Une fois encore, je suis séduite par le style de l’auteur. Par sa capacité à décrire avec finesse ses personnages et à les mettre en scène, son roman m’a fait penser à Freedom de Jonathan Franzen.
J’aime particulièrement les romans « campus », tout simplement parce que je me rêve moi-même étudiante à Yale ! Ici, le cadre permet à l’auteur de nous offrir tout un tas de références littéraires de façon subtile et documentée : on croise entre autres Jane Austen, Roland Barthes, Saint-Augustin,… Mais les trois personnages doivent apprendre à vivre avec leur temps et se détacher de ces grands noms. Madeleine tombe de haut quand elle découvre qu’en épousant Léonard, elle épouse sa maladie. Léonard, quant à lui, est sans arrêt sur un fil, se raccrochant désespérément à Madeleine, qui n’avait pas envisagé son entrée dans le monde des adultes de cette manière. De son côté Mitchell est en quête de spiritualité. Il cherche surtout à oublier Madeleine après avoir déjà essuyé quelques refus. Les descriptions des personnages de Jeffrey Eugenides sont assez cliniques, pourtant il parvient à les rendre vivants et surtout humains, avec leurs qualités mais surtout leurs failles.
Plus qu’un « roman du mariage », il s’agit d’un « roman d’amours ». Le thème du triangle amoureux a été vu et revu mais l’auteur réussit à le prendre sous un angle nouveau. Il n’y a qu’un couple dans ce livre : Madeleine et Léonard. Mitchell gravite autour, vit seul ses propres sentiments. Parfois évidemment, et sinon ce ne serait pas un triangle, Mitchell et Madeleine se rapprochent mais comme nous ne sommes pas dans un roman Harlequin une histoire d’amour ne vient pas en chasser une autre. Mitchell semble représenter les aspirations réelles de Madeleine, tandis que Léonard est du côté du fantasme, du danger, de la rébellion. Là encore, on tiendrait le scénario idéal pour un mauvais roman à l’eau de rose si l’auteur ne dépassait pas cet intrigue basique pour dire plus, pour raconter une époque (les années 1980 aux Etats-Unis), pour confronter des idéaux à une réalité plus cruelle. Madeleine n’est pas une héroïne romantique, elle est un personnage ancré dans son époque, saisie à une étape charnière de sa vie (la fin de l’université) qui va devoir faire un choix.
Il y a malgré tout quelques longueurs dans ce livre, notamment lors de certaines étapes du cheminement spirituel de Mitchell. Son voyage à travers l’Europe puis l’Asie est beaucoup mieux raconté et plus offre plus d’intérêt.
En résumé, je conseille cette lecture, car l’auteur parvient très vite à nous entraîner dans son récit. Les personnages sont parfois insupportables, preuve qu’ils sont réalistes. Les sentiments sont décrits de manière chirurgicale mais sont rendus avec beaucoup de justesse.

La servante du Seigneur
Avis posté le 2014-05-27
Complainte d'un père à sa fille
Marie, la fille de Jean-Louis Fournier, a quitté son travail et son ancienne vie pour entrer en religion. Ou plutôt sous l'emprise d'un pseudo-gourou. Avec beaucoup d'humour et parfois de tendresse, le père se souvient de la fille qu'il aimait tant, et l'attaque à certains moments avec plus de rudesse, car sa fille ne l'épargne pas elle non plus.
Sans le style très agréable de l'auteur, ce livre n'aurait aucun intérêt. Il y a pourtant quelque chose de fascinant dans les sectes et leurs victimes. Mais il ne s'agit pas ici d'une enquête, ni d'un roman qui aborderait les différentes étapes de l'endoctrinement. Il s'agit d'une lettre d'amour et de colère d'un père à sa fille. Finalement, pourquoi pas ? Sauf que ce n'est pas assez... Les chapitres sont très brefs, le livre très petit, la police énorme. Il y a pourtant de très belles formules, drôles, ironiques, parfois un peu cruelles mais on referme vite ce livre sans qu'il nous laisse un souvenir impérissable.
L'auteur a accepté de laisser le dernier mot à sa fille. La réponse de cette dernière nous met mal à l'aise. Comme si on avait oublié un instant que nous étions des indiscrets regardant par le trou de la serrure d'une histoire familiale.
Marie, la fille de Jean-Louis Fournier, a quitté son travail et son ancienne vie pour entrer en religion. Ou plutôt sous l'emprise d'un pseudo-gourou. Avec beaucoup d'humour et parfois de tendresse, le père se souvient de la fille qu'il aimait tant, et l'attaque à certains moments avec plus de rudesse, car sa fille ne l'épargne pas elle non plus.
Sans le style très agréable de l'auteur, ce livre n'aurait aucun intérêt. Il y a pourtant quelque chose de fascinant dans les sectes et leurs victimes. Mais il ne s'agit pas ici d'une enquête, ni d'un roman qui aborderait les différentes étapes de l'endoctrinement. Il s'agit d'une lettre d'amour et de colère d'un père à sa fille. Finalement, pourquoi pas ? Sauf que ce n'est pas assez... Les chapitres sont très brefs, le livre très petit, la police énorme. Il y a pourtant de très belles formules, drôles, ironiques, parfois un peu cruelles mais on referme vite ce livre sans qu'il nous laisse un souvenir impérissable.
L'auteur a accepté de laisser le dernier mot à sa fille. La réponse de cette dernière nous met mal à l'aise. Comme si on avait oublié un instant que nous étions des indiscrets regardant par le trou de la serrure d'une histoire familiale.

La curée
Avis posté le 2014-05-27
Saccard chez les Rougon-Macquart
Après le coup d’état qui a mis à la tête du pays et de l’empire Napoléon III, Aristide Rougon quitte Plassans pour Paris dans l’espoir de s’enrichir. Il y retrouve son frère Eugène, désormais ministre et homme d’influence à qui il demande de faire jouer ses relations pour lui offrir une bonne situation. Eugène lui recommande de changer de nom pour ne pas le compromettre – il devient Aristide Saccard – et lui offre un poste d’agent voyer. Aristide, impatient de faire fortune, est très déçu et frustré de n’avoir pas immédiatement la vie bourgeoise dont il rêve. Il finit par comprendre tout l’intérêt qu’il peut y avoir dans ce poste puisqu’il est très vite dans la confidence des futurs travaux qui révolutionneront Paris. Il se livrera alors sans complexe à la spéculation immobilière. Mais pour pouvoir débuter ses activités, il a besoin d’un premier apport financier. Il demande de l’aide à sa sœur Sidonie, femme d’intrigue dont on ne sait au final bien peu de choses. Celle-ci lui fait rencontrer la jeune Renée Béraud-Duchâtel au lendemain de la mort de sa première épouse. Renée se retrouve dans une situation fort délicate suite au viol qu’elle a subi. Peu à peu, Aristide, son fils Maxime et Renée vivront dans la richesse et l’opulence. Aristide escroque à tout va, Maxime jouit de sa jeunesse et de sa fougue, Renée s’ennuie dans ces plaisirs bourgeois qui ne la satisfont plus jusqu’au jour où elle tombe amoureuse de son beau-fils.
Après Plassans, paysage principal de La Fortune des Rougon, nous voilà à Paris. La ville joue dans ce roman un rôle très important. Elle est le siège des spéculations immobilières des nouveaux riches, le terrain privilégié des balades bourgeoises, l’oreille attentive des ragots, la terre de l’Empereur. Loin d’être immobile, elle est saisie ici dans ce qui sera sa plus grande reconstruction.
Dans ce deuxième tome de la série, c’est le personnage d’Aristide Saccard qui fait le lien avec les Rougon-Macquart (Eugène Rougon n’apparaissant qu’à de brèves occasions). D’ailleurs, le changement de son nom surprend, tendant à l’éloigner de son ascendance. Autre aspect intéressant, le fait que ce nouveau nom se rapproche par ses sonorités de « Macquart » et s’éloigne de « Rougon ». Tant et si bien que j’avais presque oublié à certains moments qu’Aristide était un Rougon. Mais son caractère est là pour nous le rappeler : fourbe, escroc, sans morale, Aristide est un personnage détestable, même si on peut apprécier son évolution (très rapide !) au tout début du roman quand il découvre les bienfaits de la patience. Personnage si immorale qu'il fermera les yeux sur l’adultère du moment qu’il aura obtenu ce qu’il voulait financièrement de son épouse.
Mais le personnage central de ce roman est en fait Renée. La jeune femme, fille d’un veuf et élevée par sa tante, avec sa sœur, a longtemps vécu dans un pensionnat avant de tomber enceinte après un viol. Suite aux manigances de sa tante aimante, elle épouse Saccard afin de retrouver son honneur perdu. Au début, Renée est heureuse dans les fastes de la bourgeoisie jusqu’à ce qu’elle s’ennuie, désirant autre chose qui la ferait vibrer. Elle retrouve de l’intérêt à sa vie, lorsque le fils de son mari, Maxime, s’installe avec eux. Très vite, ce jeune homme deviendra son confident. Les amies de Renée adorent ce garçon androgyne, au goût pour la mode très prononcé. Ils partagent ensemble soirées huppées et confidences. Jusqu’au jour où l’amitié se transforme en inceste. Pour la première fois, c’est une Renée amoureuse que nous rencontrons, une Renée semblant retrouver une étincelle qu’elle-même pensait disparue. Dans cet acte criminel, Renée se prélasse avec plaisir. Ce personnage est le plus développé par Zola. Elle est la victime de l’intrigue, la victime de l’alliance involontaire du père et du fils. L’un en veut à sa fortune, l’autre bien conscient de leur faute s’apprête à tout instant à l’abandonner. Finalement, Renée se retrouve seule, observant avec angoisse à la fin du livre le cortège des bourgeois qu’elle fréquente habituellement, se sentant loin de ce monde. Elle retournera auprès de son père dans sa maison d’enfance avant de s’éteindre un an plus tard.
Encore une fois, j’ai adoré ce roman. Pourtant, je n’ai pas toujours tout compris aux ruses de Saccard, aux différentes spéculations immobilières qui l’enrichissent, mais le style de Zola permet de ne pas se laisser décourager par certains passages un peu plus complexes. Et puis très vite, on retrouve le personnage passionnant de Renée, le Paris qu’elle partage avec Maxime, leur amour interdite. Je suis triste de laisser là Renée, que j’aurais aimé suivre encore. Mais j’ai hâte de poursuivre mes lectures pour être charmée, intriguée, émue par d’autres personnages.
"Mais elle ne voyait que ses cuisses roses, ses hanches roses, cette étrange femme de soie rose qu'elle avait devant elle, et dont la peau de fine étoffe, aux mailles serrées, semblait faite pour des amours de pantins et de poupées."
Après le coup d’état qui a mis à la tête du pays et de l’empire Napoléon III, Aristide Rougon quitte Plassans pour Paris dans l’espoir de s’enrichir. Il y retrouve son frère Eugène, désormais ministre et homme d’influence à qui il demande de faire jouer ses relations pour lui offrir une bonne situation. Eugène lui recommande de changer de nom pour ne pas le compromettre – il devient Aristide Saccard – et lui offre un poste d’agent voyer. Aristide, impatient de faire fortune, est très déçu et frustré de n’avoir pas immédiatement la vie bourgeoise dont il rêve. Il finit par comprendre tout l’intérêt qu’il peut y avoir dans ce poste puisqu’il est très vite dans la confidence des futurs travaux qui révolutionneront Paris. Il se livrera alors sans complexe à la spéculation immobilière. Mais pour pouvoir débuter ses activités, il a besoin d’un premier apport financier. Il demande de l’aide à sa sœur Sidonie, femme d’intrigue dont on ne sait au final bien peu de choses. Celle-ci lui fait rencontrer la jeune Renée Béraud-Duchâtel au lendemain de la mort de sa première épouse. Renée se retrouve dans une situation fort délicate suite au viol qu’elle a subi. Peu à peu, Aristide, son fils Maxime et Renée vivront dans la richesse et l’opulence. Aristide escroque à tout va, Maxime jouit de sa jeunesse et de sa fougue, Renée s’ennuie dans ces plaisirs bourgeois qui ne la satisfont plus jusqu’au jour où elle tombe amoureuse de son beau-fils.
Après Plassans, paysage principal de La Fortune des Rougon, nous voilà à Paris. La ville joue dans ce roman un rôle très important. Elle est le siège des spéculations immobilières des nouveaux riches, le terrain privilégié des balades bourgeoises, l’oreille attentive des ragots, la terre de l’Empereur. Loin d’être immobile, elle est saisie ici dans ce qui sera sa plus grande reconstruction.
Dans ce deuxième tome de la série, c’est le personnage d’Aristide Saccard qui fait le lien avec les Rougon-Macquart (Eugène Rougon n’apparaissant qu’à de brèves occasions). D’ailleurs, le changement de son nom surprend, tendant à l’éloigner de son ascendance. Autre aspect intéressant, le fait que ce nouveau nom se rapproche par ses sonorités de « Macquart » et s’éloigne de « Rougon ». Tant et si bien que j’avais presque oublié à certains moments qu’Aristide était un Rougon. Mais son caractère est là pour nous le rappeler : fourbe, escroc, sans morale, Aristide est un personnage détestable, même si on peut apprécier son évolution (très rapide !) au tout début du roman quand il découvre les bienfaits de la patience. Personnage si immorale qu'il fermera les yeux sur l’adultère du moment qu’il aura obtenu ce qu’il voulait financièrement de son épouse.
Mais le personnage central de ce roman est en fait Renée. La jeune femme, fille d’un veuf et élevée par sa tante, avec sa sœur, a longtemps vécu dans un pensionnat avant de tomber enceinte après un viol. Suite aux manigances de sa tante aimante, elle épouse Saccard afin de retrouver son honneur perdu. Au début, Renée est heureuse dans les fastes de la bourgeoisie jusqu’à ce qu’elle s’ennuie, désirant autre chose qui la ferait vibrer. Elle retrouve de l’intérêt à sa vie, lorsque le fils de son mari, Maxime, s’installe avec eux. Très vite, ce jeune homme deviendra son confident. Les amies de Renée adorent ce garçon androgyne, au goût pour la mode très prononcé. Ils partagent ensemble soirées huppées et confidences. Jusqu’au jour où l’amitié se transforme en inceste. Pour la première fois, c’est une Renée amoureuse que nous rencontrons, une Renée semblant retrouver une étincelle qu’elle-même pensait disparue. Dans cet acte criminel, Renée se prélasse avec plaisir. Ce personnage est le plus développé par Zola. Elle est la victime de l’intrigue, la victime de l’alliance involontaire du père et du fils. L’un en veut à sa fortune, l’autre bien conscient de leur faute s’apprête à tout instant à l’abandonner. Finalement, Renée se retrouve seule, observant avec angoisse à la fin du livre le cortège des bourgeois qu’elle fréquente habituellement, se sentant loin de ce monde. Elle retournera auprès de son père dans sa maison d’enfance avant de s’éteindre un an plus tard.
Encore une fois, j’ai adoré ce roman. Pourtant, je n’ai pas toujours tout compris aux ruses de Saccard, aux différentes spéculations immobilières qui l’enrichissent, mais le style de Zola permet de ne pas se laisser décourager par certains passages un peu plus complexes. Et puis très vite, on retrouve le personnage passionnant de Renée, le Paris qu’elle partage avec Maxime, leur amour interdite. Je suis triste de laisser là Renée, que j’aurais aimé suivre encore. Mais j’ai hâte de poursuivre mes lectures pour être charmée, intriguée, émue par d’autres personnages.
"Mais elle ne voyait que ses cuisses roses, ses hanches roses, cette étrange femme de soie rose qu'elle avait devant elle, et dont la peau de fine étoffe, aux mailles serrées, semblait faite pour des amours de pantins et de poupées."
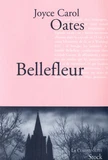
Bellefleur
Avis posté le 2014-05-12
- Passionnant
- Eblouissant
Bellefleur
"Ceci est une oeuvre de l'imagination, et doit obéir, avec humilité et audace, aux lois de l'imagination. Que le temps se noue et se déploie, puis d'efface, pour redevenir formidablement présent ; que le "dialogue" se fonde parfois dans le récit, et dans d'autres conversations présentées de façon conventionnelle ; que l'invraisemblable fasse autorité et soit investi d'une complexité habituellement réservée à la fiction réaliste : l'auteur l'a voulu ainsi. Bellefleur est une région, un état de l'âme et il existe réellement ; ces lois, sacro-saintes, sont tout à fait logiques."
Voilà la note de l'auteur en introduction de ce roman de Joyce Carol Oates. Bellefleur a été écrit en 1981, il est un des premiers romans de l'auteur, écrit notamment en réaction à certains critiques qui qualifièrent ces premiers romans de gothique. Cette note nous prévient : inutile de chercher dans ce roman une logique temporelle ou factuelle. Il n'y en a pas et ce n'est pas ce que l'on demande à cette oeuvre.
JCO décrit l'histoire de la famille de Bellefleur sur plusieurs générations, à partir de Jean-Pierre Bellefleur à la fin du XVIIIe siècle. Chaque chapitre se concentre sur une époque, parfois sur un personnage. D'autres chapitres encore sont plus thématiques et présentent par exemple les différentes automobiles au fil du temps. Mais attention rien n'est anecdotique. On sent bien que tout à un sens, les événements s'entrecroisent et se répondent. On aimerait parfois avoir la clé pour comprendre les nombreux mystères de ce roman. Mais c'est là toute la magie de JCO : même en l'absence de réponses, on se laisse emporter, bercés par cet univers gothique, souvent inquiétant, toujours éblouissant.
La famille Bellefleur semble être victime d'une malédiction. Ou bien est-ce le château lui-même, personnage phare du roman ? Quoi qu'il en soit les morts s'enchaînent : accidents mystérieux, suicide, disparition surprenante. Les destins des personnages sont voués au drame. Seuls moyens pour eux d'y échapper ? Prendre la fuite ? Chercher le salut auprès d'un individu qui ne serait pas un Bellefleur ? Les Bellefleur n'aiment pas les étrangers et les mariages ont souvent lieu entre cousins, de quoi faire perdurer encore la malédiction.
C'est un livre prenant, passionnant. Certes un pavé de plus de 900 pages mais qu'on ne sent pas passer tant la lecture est agréable et l'histoire poignante.
"Ceci est une oeuvre de l'imagination, et doit obéir, avec humilité et audace, aux lois de l'imagination. Que le temps se noue et se déploie, puis d'efface, pour redevenir formidablement présent ; que le "dialogue" se fonde parfois dans le récit, et dans d'autres conversations présentées de façon conventionnelle ; que l'invraisemblable fasse autorité et soit investi d'une complexité habituellement réservée à la fiction réaliste : l'auteur l'a voulu ainsi. Bellefleur est une région, un état de l'âme et il existe réellement ; ces lois, sacro-saintes, sont tout à fait logiques."
Voilà la note de l'auteur en introduction de ce roman de Joyce Carol Oates. Bellefleur a été écrit en 1981, il est un des premiers romans de l'auteur, écrit notamment en réaction à certains critiques qui qualifièrent ces premiers romans de gothique. Cette note nous prévient : inutile de chercher dans ce roman une logique temporelle ou factuelle. Il n'y en a pas et ce n'est pas ce que l'on demande à cette oeuvre.
JCO décrit l'histoire de la famille de Bellefleur sur plusieurs générations, à partir de Jean-Pierre Bellefleur à la fin du XVIIIe siècle. Chaque chapitre se concentre sur une époque, parfois sur un personnage. D'autres chapitres encore sont plus thématiques et présentent par exemple les différentes automobiles au fil du temps. Mais attention rien n'est anecdotique. On sent bien que tout à un sens, les événements s'entrecroisent et se répondent. On aimerait parfois avoir la clé pour comprendre les nombreux mystères de ce roman. Mais c'est là toute la magie de JCO : même en l'absence de réponses, on se laisse emporter, bercés par cet univers gothique, souvent inquiétant, toujours éblouissant.
La famille Bellefleur semble être victime d'une malédiction. Ou bien est-ce le château lui-même, personnage phare du roman ? Quoi qu'il en soit les morts s'enchaînent : accidents mystérieux, suicide, disparition surprenante. Les destins des personnages sont voués au drame. Seuls moyens pour eux d'y échapper ? Prendre la fuite ? Chercher le salut auprès d'un individu qui ne serait pas un Bellefleur ? Les Bellefleur n'aiment pas les étrangers et les mariages ont souvent lieu entre cousins, de quoi faire perdurer encore la malédiction.
C'est un livre prenant, passionnant. Certes un pavé de plus de 900 pages mais qu'on ne sent pas passer tant la lecture est agréable et l'histoire poignante.
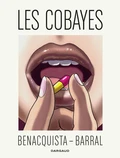
Les cobayes
Avis posté le 2014-04-24
Les Cobayes
Un laboratoire pharmaceutique est à la recherche de cobayes pour tester un nouvel antidépresseur. De leur côté, Daniel, Romain et Moïra ont besoin d'argent et les 3 500 euros proposés par le laboratoire les aideraient bien.
Retenus pour les tests, très vite, les trois deviennent amis. Une amitié qui leur permettra de passer les épreuves pas toujours simples liés aux tests. Au fil de ces tests, leurs caractères changent, ils retrouvent ce qu'ils pensaient perdus, deviennent plus forts, plus affirmés.
Difficile d'en dire plus sans tout dévoiler...
J'ai trouvé l'idée et le traitement de cette histoire très intéressants dans un premier temps. Les personnages prennent très vite de l'ampleur, on s'y attache assez vite. L'écriture est efficace, très scénaristique. Les dessins sont soignés et expressifs. Mais malheureusement la fin de la BD gâche un peu le plaisir de la lecture. Trop abrupt, pas assez développé. On reste sur notre faim....
A lire quand même pour l'originalité de l'histoire et la maîtrise dans la création des personnages.
Un laboratoire pharmaceutique est à la recherche de cobayes pour tester un nouvel antidépresseur. De leur côté, Daniel, Romain et Moïra ont besoin d'argent et les 3 500 euros proposés par le laboratoire les aideraient bien.
Retenus pour les tests, très vite, les trois deviennent amis. Une amitié qui leur permettra de passer les épreuves pas toujours simples liés aux tests. Au fil de ces tests, leurs caractères changent, ils retrouvent ce qu'ils pensaient perdus, deviennent plus forts, plus affirmés.
Difficile d'en dire plus sans tout dévoiler...
J'ai trouvé l'idée et le traitement de cette histoire très intéressants dans un premier temps. Les personnages prennent très vite de l'ampleur, on s'y attache assez vite. L'écriture est efficace, très scénaristique. Les dessins sont soignés et expressifs. Mais malheureusement la fin de la BD gâche un peu le plaisir de la lecture. Trop abrupt, pas assez développé. On reste sur notre faim....
A lire quand même pour l'originalité de l'histoire et la maîtrise dans la création des personnages.