Les derniers avis
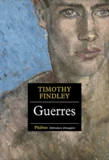
Guerres
Avis posté le 2014-06-08
Nature writing et guerre
S’il est un peu difficile d’entrer dans ce roman, avec sa forme assez particulière, ses numérotations inhabituelles, on s’y fait rapidement et, une fois les personnages campés, le texte coule plus de source. L’histoire se développe en sortes de petits tableaux qui créent le contexte familial autour de Robert Ross, jeune canadien engagé pour combattre en Belgique en 1915. S’ensuivent des tableaux de la préparation militaire et de la traversée… L’auteur est de ceux qui savent créer des images, celles qu’engrange Robert avant son départ, ordinaires ou triviales, mais avec toujours un petit quelque chose en plus… Un coyote qui trottine dans un vallon, un jeune homme hésitant les pieds dans une flaque d’eau, des indiens le long d’une voie de chemin de fer, une chambre de bordel, ces instantanés restent en mémoire…
Ensuite, cela se complique avec des retours en arrière, et à l’arrière, la rencontre d’une femme fatale, guère utile au propos sur la guerre. L’auteur a sans doute voulu mettre trop de choses dans son roman, trop d’époques, trop de personnages, d’où le titre Guerres au pluriel, qui évoque différentes situations cruciales affrontées par Robert. Le roman contient toutefois de très belles phrases et de beaux passages. Il aurait presque mieux valu que je me perde en route, car je n’ai pas aimé la fin, n’y ai pas vu beaucoup d’intérêt, et certaines scènes m’ont semblé plaquées artificiellement sur le texte.
C’est, plus encore que d’habitude, un sentiment tout à fait personnel et ce livre pourrait très certainement plaire à d’autres, pour son côté « nature writing à la guerre… »
S’il est un peu difficile d’entrer dans ce roman, avec sa forme assez particulière, ses numérotations inhabituelles, on s’y fait rapidement et, une fois les personnages campés, le texte coule plus de source. L’histoire se développe en sortes de petits tableaux qui créent le contexte familial autour de Robert Ross, jeune canadien engagé pour combattre en Belgique en 1915. S’ensuivent des tableaux de la préparation militaire et de la traversée… L’auteur est de ceux qui savent créer des images, celles qu’engrange Robert avant son départ, ordinaires ou triviales, mais avec toujours un petit quelque chose en plus… Un coyote qui trottine dans un vallon, un jeune homme hésitant les pieds dans une flaque d’eau, des indiens le long d’une voie de chemin de fer, une chambre de bordel, ces instantanés restent en mémoire…
Ensuite, cela se complique avec des retours en arrière, et à l’arrière, la rencontre d’une femme fatale, guère utile au propos sur la guerre. L’auteur a sans doute voulu mettre trop de choses dans son roman, trop d’époques, trop de personnages, d’où le titre Guerres au pluriel, qui évoque différentes situations cruciales affrontées par Robert. Le roman contient toutefois de très belles phrases et de beaux passages. Il aurait presque mieux valu que je me perde en route, car je n’ai pas aimé la fin, n’y ai pas vu beaucoup d’intérêt, et certaines scènes m’ont semblé plaquées artificiellement sur le texte.
C’est, plus encore que d’habitude, un sentiment tout à fait personnel et ce livre pourrait très certainement plaire à d’autres, pour son côté « nature writing à la guerre… »
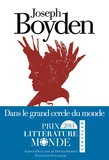
Dans le grand cercle du monde
Avis posté le 2014-05-10
Parfois dur, mais superbe
En plein XVIIème siècle, lorsque les missionnaires jésuites commencèrent à s’immiscer en Nouvelle-France pour tenter de convertir les populations locales. Leur intérêt se porta d’abord sur les groupes d’agriculteurs dont le mode de vie paraissait plus proche de celui des français, plutôt que les chasseurs. C’est ainsi qu’ils tentèrent d’approcher les Hurons et de les convertir.
Trois voix alternent dans ce roman, celle d’un jésuite « pionnier », un des tout premiers « Corbeaux » à entrer en territoire indien, celle de Chute-de-Neige, une toute jeune fille enlevée par une tribu ennemie, celle d’Oiseau, chef de cette tribu de Hurons.
Les points de vues, les sentiments, la spiritualité de chacun est ainsi vécue de l’intérieur d’une manière étonnante. Que cela ne vous laisse pas croire qu’il s’agit d’un livre contemplatif, vraiment pas, les évènements s’y succèdent sans laisser le temps de reprendre pied. Pour les âmes sensibles, sachez que les actes qui sont perpétrés entre ces pages sont parfois insoutenables (j’ai laissé deux ou trois fois glisser mon regard un paragraphe plus bas pour les éviter) mais vraiment pas de manière gratuite. Hurons et iroquois se menaient une guerre impitoyable, et de par leurs traditions, avaient à cœur de montrer le courage de leurs adversaires en les poussant jusqu’aux dernières limites de la douleur. L’auteur, dans un entretien que j’ai lu, avoue avoir hésité à décrire ces séquences, mais s’être senti obligé de ne pas les passer sous silence. Les scènes de vie quotidienne, d’entraide, de respect mutuel, d’amitié, viennent heureusement en atténuer le choc.
En plein XVIIème siècle, lorsque les missionnaires jésuites commencèrent à s’immiscer en Nouvelle-France pour tenter de convertir les populations locales. Leur intérêt se porta d’abord sur les groupes d’agriculteurs dont le mode de vie paraissait plus proche de celui des français, plutôt que les chasseurs. C’est ainsi qu’ils tentèrent d’approcher les Hurons et de les convertir.
Trois voix alternent dans ce roman, celle d’un jésuite « pionnier », un des tout premiers « Corbeaux » à entrer en territoire indien, celle de Chute-de-Neige, une toute jeune fille enlevée par une tribu ennemie, celle d’Oiseau, chef de cette tribu de Hurons.
Les points de vues, les sentiments, la spiritualité de chacun est ainsi vécue de l’intérieur d’une manière étonnante. Que cela ne vous laisse pas croire qu’il s’agit d’un livre contemplatif, vraiment pas, les évènements s’y succèdent sans laisser le temps de reprendre pied. Pour les âmes sensibles, sachez que les actes qui sont perpétrés entre ces pages sont parfois insoutenables (j’ai laissé deux ou trois fois glisser mon regard un paragraphe plus bas pour les éviter) mais vraiment pas de manière gratuite. Hurons et iroquois se menaient une guerre impitoyable, et de par leurs traditions, avaient à cœur de montrer le courage de leurs adversaires en les poussant jusqu’aux dernières limites de la douleur. L’auteur, dans un entretien que j’ai lu, avoue avoir hésité à décrire ces séquences, mais s’être senti obligé de ne pas les passer sous silence. Les scènes de vie quotidienne, d’entraide, de respect mutuel, d’amitié, viennent heureusement en atténuer le choc.