Retour




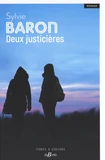
Les dernières notes et avis
Notes et avis 1 à 8 sur un total de 209
Vue mer
Avis posté le 2023-03-16
Un magnifique roman mystérieux
« A louer, vue mer, appartement semi-indépendant dans maison de maître, à quinze minutes du continent. Navette maritime assurée à heures régulières. Hommes s’abstenir. » (p. 16)
Laurette est âgée de 85 ans. Propriétaire d’une maison sur une île méditerranéenne, elle loue des chambres à des femmes. Curieusement, ces dernières ne s’attardent pas. La dernière est même partie, subitement, en abandonnant une partie de ses affaires. Seule Magalie est installée depuis plusieurs années.
Robert, le fils de Laurette, est chargé de sélectionner les locataires. Ce jour-là, il reçoit Natacha. Comme toutes les candidates, elle a une vision idyllique de la proposition. Mais elle ne connaît pas sa future logeuse. Séduit par son profil et emporté par son enthousiasme, Robert l’emmène visiter le studio, sans même avertir sa mère. Pour cet homme, écrasé par la domination maternelle, c’est un acte de rébellion qui le rend, à la fois, fébrile et fier.
En effet, il sait que Laurette n’acceptera pas cet affront, mais il ne peut pas anticiper de quelle manière elle l’exprimera. Elle est imprévisible, mais, terriblement, maligne et manipulatrice. Au début, j’ai adoré la détester. Son caractère acariâtre et sa personnalité tempétueuse m’amusaient. Par moments, elle m’attendrissait. Je la trouvais insupportable, mais je l’aimais bien. Comme elle, j’étais versatile : mes sentiments envers elle ont évolué au fil des révélations.
Selon les interlocuteurs, Laurette n’adopte pas la même attitude. Avec ses enfants, elle est condescendante et autoritaire ; avec Agathe, sa petite-fille, elle est patiente, indulgente et paraît même éprouver un peu d’admiration pour sa vivacité. Les histoires qu’elle raconte sont des anecdotes merveilleuses et sensationnelles pour Agathe, des élucubrations pour Magalie et des mensonges pour Robert. Personne ne sait qui est, réellement, la vieille dame. Chacun a une perception contraire.
Plusieurs voix relatent les faits. Les phrasés et les mélodies des pensées sont reconnaissables. C’est très subtil. De plus, la psychologie des personnages est approfondie. Ils n’ont pas le même chemin de vie, ni les mêmes sensibilités et plusieurs d’entre eux cachent des douleurs enfouies. J’ai été, particulièrement, touchée par celles de Robert : malgré son âge, il est toujours un petit garçon en quête d’amour maternel. Magalie, quant à elle, recherche l’apaisement et l’acceptation d’elle-même.
L’ambiance est un élément essentiel du roman. Au départ, elle semble légère (je souriais énormément), mais au fil des mystères évoqués, l’atmosphère s’opacifie et se noircit. Des textes sibyllins, des confidences énigmatiques, des mots équivoques, des pensées nébuleuses m’ont entraînée sur un versant inquiétant, dont je ne discernais pas l’issue. J’analysais chaque indice, mes émotions étaient chahutées et effectuaient des volte-face. Elles s’opposaient et ne sont affirmées que lorsque le tableau a été complet. Au cœur du climat ténébreux, des piques d’humour se glissent : ce contraste est jubilatoire et provoque des éclats de rire, alors que le contexte s’assombrit.
J’ai eu un coup de cœur pour ce magnifique roman psychologique dans lequel des secrets insoupçonnables et épouvantables se dévoilent avec parcimonie. Leur révélation, est-elle une libération ou un emprisonnement ?
« A louer, vue mer, appartement semi-indépendant dans maison de maître, à quinze minutes du continent. Navette maritime assurée à heures régulières. Hommes s’abstenir. » (p. 16)
Laurette est âgée de 85 ans. Propriétaire d’une maison sur une île méditerranéenne, elle loue des chambres à des femmes. Curieusement, ces dernières ne s’attardent pas. La dernière est même partie, subitement, en abandonnant une partie de ses affaires. Seule Magalie est installée depuis plusieurs années.
Robert, le fils de Laurette, est chargé de sélectionner les locataires. Ce jour-là, il reçoit Natacha. Comme toutes les candidates, elle a une vision idyllique de la proposition. Mais elle ne connaît pas sa future logeuse. Séduit par son profil et emporté par son enthousiasme, Robert l’emmène visiter le studio, sans même avertir sa mère. Pour cet homme, écrasé par la domination maternelle, c’est un acte de rébellion qui le rend, à la fois, fébrile et fier.
En effet, il sait que Laurette n’acceptera pas cet affront, mais il ne peut pas anticiper de quelle manière elle l’exprimera. Elle est imprévisible, mais, terriblement, maligne et manipulatrice. Au début, j’ai adoré la détester. Son caractère acariâtre et sa personnalité tempétueuse m’amusaient. Par moments, elle m’attendrissait. Je la trouvais insupportable, mais je l’aimais bien. Comme elle, j’étais versatile : mes sentiments envers elle ont évolué au fil des révélations.
Selon les interlocuteurs, Laurette n’adopte pas la même attitude. Avec ses enfants, elle est condescendante et autoritaire ; avec Agathe, sa petite-fille, elle est patiente, indulgente et paraît même éprouver un peu d’admiration pour sa vivacité. Les histoires qu’elle raconte sont des anecdotes merveilleuses et sensationnelles pour Agathe, des élucubrations pour Magalie et des mensonges pour Robert. Personne ne sait qui est, réellement, la vieille dame. Chacun a une perception contraire.
Plusieurs voix relatent les faits. Les phrasés et les mélodies des pensées sont reconnaissables. C’est très subtil. De plus, la psychologie des personnages est approfondie. Ils n’ont pas le même chemin de vie, ni les mêmes sensibilités et plusieurs d’entre eux cachent des douleurs enfouies. J’ai été, particulièrement, touchée par celles de Robert : malgré son âge, il est toujours un petit garçon en quête d’amour maternel. Magalie, quant à elle, recherche l’apaisement et l’acceptation d’elle-même.
L’ambiance est un élément essentiel du roman. Au départ, elle semble légère (je souriais énormément), mais au fil des mystères évoqués, l’atmosphère s’opacifie et se noircit. Des textes sibyllins, des confidences énigmatiques, des mots équivoques, des pensées nébuleuses m’ont entraînée sur un versant inquiétant, dont je ne discernais pas l’issue. J’analysais chaque indice, mes émotions étaient chahutées et effectuaient des volte-face. Elles s’opposaient et ne sont affirmées que lorsque le tableau a été complet. Au cœur du climat ténébreux, des piques d’humour se glissent : ce contraste est jubilatoire et provoque des éclats de rire, alors que le contexte s’assombrit.
J’ai eu un coup de cœur pour ce magnifique roman psychologique dans lequel des secrets insoupçonnables et épouvantables se dévoilent avec parcimonie. Leur révélation, est-elle une libération ou un emprisonnement ?

Le palais des mille vents Tome 2
Les nuits de Saint-Petersbourg
Les nuits de Saint-Petersbourg
Avis posté le 2022-11-20
Une aventure merveilleuse
1848, dans la région de Saint-Pétersbourg. La Princesse Iéléna Vatchenko fuit sa vaste demeure, à cheval, accompagnée de ses chiens. Elle a besoin de s’éloigner pour pleurer. Quelques jours plus tôt, elle a donné naissance à des jumeaux et l’un d’eux est décédé. Elle ne veut pas assister à la cérémonie d’adieu. Sa chevauchée est stoppée par un spectacle horrible : la neige est ensanglantée et une troïka est renversée. Sur les lieux de l’accident, elle entend les pleurs d’un bébé. « Ce ne pouvait être un hasard. Cet enfant était là pour elle, pour combler ce vide qui, depuis la nuit dernière, l’empêchait de respirer. » (p. 41) Elle est persuadée qu’il est la réincarnation de Alekseï. Elle convainc son époux, Vassili, d’élever le petit, comme leur propre fils, auprès de Viktor. Cette décision scelle leur destin.
Les deux bébés sont élevés comme des frères. Ils grandissent heureux, sans soupçonner la vérité. Le prince et la princesse respectent les personnes qui travaillent pour eux, aussi, celles-ci leur sont dévouées et fidèles : leur secret n’est pas éventé. Pavel, un moujik (paysan) et son fils Nikolaï veillent sur leurs maîtres. Seul le frère cadet de Vassili représente un danger, en raison de sa jalousie au sujet de l’héritage familial. Par appât du gain, il est prêt à tout pour se venger de son aîné. Il se jure de prendre sa place. Hélas, la quiétude du domaine est ébranlée par la guerre en Crimée. « Les Français et les Britanniques menacent de gagner, il faut des troupes fraîches » (p. 168).
Les nuits de Saint-Pétersbourg est le deuxième tome de la saga Le Palais des Mille vents. Cependant, ce sont de nouveaux personnages qui sont au cœur de l’intrigue, bien que la quête du précédent opus soit présente en filigrane.
Je me suis énormément attachée à cette famille qui nous est présentée. Iéléna est une femme sensible et forte. Son instinct maternel lui insuffle un courage qu’elle ne s’imagine pas posséder. Par amour, que ce soit pour ses fils, pour son époux, pour ses employés ou pour ses animaux, elle affronte les épreuves avec ardeur et témérité. Rien ne lui fait peur, même pas la mort, quand il s’agit de protéger les siens. Sa gentillesse, sa générosité et, surtout, la considération pour ceux qui travaillent pour elle lui apportent leur affection et leur attachement. Aussi, ils sont prêts à tous les sacrifices pour le bonheur de leur maîtresse. Vassili possède les mêmes qualités que son épouse. C’est un homme aimable, un mari aimant et un père présent. Il ne recule pas devant son devoir. Sa bonté est reconnue par Pavel, qui n’abandonne jamais son maître. J’ai aimé la fidélité de ce moujik tendre et discret. Il a transmis ses valeurs à son fils. Celui-ci, Nikolaï, m’a émue par son abnégation et par la pureté de ses sentiments.
De nombreuses épreuves constituent l’essence des Nuits de Saint-Pétersbourg. De nombreuses fois, un cri de détresse et d’effroi s’est échappé de ma gorge. J’étais tant emportée par l’histoire que je la vivais avec mes tripes. J’ai été remuée par les drames qui émaillent le récit, d’autant qu’ils se produisent, souvent, lorsque la situation semble apaisée. Je ne les anticipais pas et je les découvrais avec surprise et émotion.
Comme dans les ouvrages précédents de l’auteure, le paysage et le climat sont des personnages à part entière du récit. L’écriture est très cinématographique : chaque scène s’infiltre dans notre pupille, notre imagination est attisée, tous nos sens sont éveillés et les descriptions s’inscrivent dans les évènements. La lecture de ce roman est une aventure merveilleuse. Kate McAlistair a une plume exceptionnelle : chaque phrase génère une sensation ou un sentiment.
J’ai eu un immense coup de cœur pour Les Nuits de Saint-Pétersbourg.
1848, dans la région de Saint-Pétersbourg. La Princesse Iéléna Vatchenko fuit sa vaste demeure, à cheval, accompagnée de ses chiens. Elle a besoin de s’éloigner pour pleurer. Quelques jours plus tôt, elle a donné naissance à des jumeaux et l’un d’eux est décédé. Elle ne veut pas assister à la cérémonie d’adieu. Sa chevauchée est stoppée par un spectacle horrible : la neige est ensanglantée et une troïka est renversée. Sur les lieux de l’accident, elle entend les pleurs d’un bébé. « Ce ne pouvait être un hasard. Cet enfant était là pour elle, pour combler ce vide qui, depuis la nuit dernière, l’empêchait de respirer. » (p. 41) Elle est persuadée qu’il est la réincarnation de Alekseï. Elle convainc son époux, Vassili, d’élever le petit, comme leur propre fils, auprès de Viktor. Cette décision scelle leur destin.
Les deux bébés sont élevés comme des frères. Ils grandissent heureux, sans soupçonner la vérité. Le prince et la princesse respectent les personnes qui travaillent pour eux, aussi, celles-ci leur sont dévouées et fidèles : leur secret n’est pas éventé. Pavel, un moujik (paysan) et son fils Nikolaï veillent sur leurs maîtres. Seul le frère cadet de Vassili représente un danger, en raison de sa jalousie au sujet de l’héritage familial. Par appât du gain, il est prêt à tout pour se venger de son aîné. Il se jure de prendre sa place. Hélas, la quiétude du domaine est ébranlée par la guerre en Crimée. « Les Français et les Britanniques menacent de gagner, il faut des troupes fraîches » (p. 168).
Les nuits de Saint-Pétersbourg est le deuxième tome de la saga Le Palais des Mille vents. Cependant, ce sont de nouveaux personnages qui sont au cœur de l’intrigue, bien que la quête du précédent opus soit présente en filigrane.
Je me suis énormément attachée à cette famille qui nous est présentée. Iéléna est une femme sensible et forte. Son instinct maternel lui insuffle un courage qu’elle ne s’imagine pas posséder. Par amour, que ce soit pour ses fils, pour son époux, pour ses employés ou pour ses animaux, elle affronte les épreuves avec ardeur et témérité. Rien ne lui fait peur, même pas la mort, quand il s’agit de protéger les siens. Sa gentillesse, sa générosité et, surtout, la considération pour ceux qui travaillent pour elle lui apportent leur affection et leur attachement. Aussi, ils sont prêts à tous les sacrifices pour le bonheur de leur maîtresse. Vassili possède les mêmes qualités que son épouse. C’est un homme aimable, un mari aimant et un père présent. Il ne recule pas devant son devoir. Sa bonté est reconnue par Pavel, qui n’abandonne jamais son maître. J’ai aimé la fidélité de ce moujik tendre et discret. Il a transmis ses valeurs à son fils. Celui-ci, Nikolaï, m’a émue par son abnégation et par la pureté de ses sentiments.
De nombreuses épreuves constituent l’essence des Nuits de Saint-Pétersbourg. De nombreuses fois, un cri de détresse et d’effroi s’est échappé de ma gorge. J’étais tant emportée par l’histoire que je la vivais avec mes tripes. J’ai été remuée par les drames qui émaillent le récit, d’autant qu’ils se produisent, souvent, lorsque la situation semble apaisée. Je ne les anticipais pas et je les découvrais avec surprise et émotion.
Comme dans les ouvrages précédents de l’auteure, le paysage et le climat sont des personnages à part entière du récit. L’écriture est très cinématographique : chaque scène s’infiltre dans notre pupille, notre imagination est attisée, tous nos sens sont éveillés et les descriptions s’inscrivent dans les évènements. La lecture de ce roman est une aventure merveilleuse. Kate McAlistair a une plume exceptionnelle : chaque phrase génère une sensation ou un sentiment.
J’ai eu un immense coup de cœur pour Les Nuits de Saint-Pétersbourg.

Sous les soleils de Kyiv
Avis posté le 2022-11-04
Un roman poignant sur l’Holodomor
En 2014, Cassie, une jeune veuve, s’installe chez sa grand-mère, avec sa fille, en Illinois. Le comportement de son aïeule l’interpelle : elle cache de la nourriture, écrit des listes en ukrainien, etc. La jeune femme s’inquiète, mais sa Bobby ne répond pas à ses interrogations. La vieille dame n’a jamais parlé de sa jeunesse. Cependant, elle confie un carnet à Cassie dans lequel celle-ci découvre les souffrances du peuple ukrainien. Le récit comporte une double temporalité. La première se déroule en 2014 et concerne les douleurs de Cassie, après la perte de son époux dans un accident ; la deuxième se passe soixante-dix ans plus tôt, en Ukraine. Les chapitres sont une alternance des deux époques.
Katya vit heureuse avec sa famille, dans un village d’Ukraine. Elle est amoureuse de Pavlo et ses sentiments sont partagés. En septembre 1929, le jour du mariage de sa cousine, elle surprend une conversation inquiétante : les militants envahissent les villages, déportent certains habitants, en Sibérie, et obligent les autres à adhérer au kolkhoze. « L’Ukraine est une région fertile, une terre d’abondance, et Staline estime que nous devons être la corbeille à pain de l’Union soviétique. » (p. 26)
En janvier 1930, les militants pénètrent dans Sonyashnyky. Dès la première nuit, des hommes sont déportés, leurs femmes et leurs enfants reçoivent l’ordre de quitter le village et leurs maisons sont investies par les hommes de Staline. Les premiers mois, l’adhésion au kolkhoze n’est pas obligatoire, mais la pression est forte pour convaincre les derniers récalcitrants : taxes plus élevées, fusillades, déportations, etc. Quand tous les villageois sont forcés de participer au kolkhoze, ils n’ont déjà plus rien. Pourtant, le système est déterminé à leur prendre encore plus. Plus rien ne leur appartient, tout est à l’Etat : le moindre grain de blé, la plus petite souris dans le jardin, les animaux de la forêt, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans les rivières… Le peuple n’a rien à manger et ceux qui ont encore la force de résister sont déportés ou tués.
Ce roman raconte l’Holodomor. « Entre 1932 et 1933, un Ukrainien sur huit est mort d’une famine provoquée par l’homme. Et uniquement par l’homme. » (p. 440) Staline a tenté d’exterminer le peuple ukrainien par la faim. La première fois que j’ai entendu parler de ce fait, c’était après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. J’avais été choquée et meurtrie. Cependant, même si les mots étaient brutaux, je n’avais pas pris conscience à quel point ils étaient justes. Ce roman m’a ouvert les yeux sur les véritables souffrances et sur la réalité des faits. J’ai ressenti la mort qui s’infiltrait dans les corps et les âmes, les forces qui s’éteignaient, j’ai vu les cadavres qui s’amoncelaient, révélant que certains avaient tenté de survivre, mais que leur organisme les avait abandonnés avant l’espoir. La population avait peu de chances de survie, car s’ils étaient surpris à manger des possessions de l’Etat, alors que même la nature appartenait au système, ils étaient abattus. La mort ou la mort : le choix était restreint. Alors que les récoltes étaient abondantes, Staline a instauré un génocide par la faim.
Ce livre montre, avec émotion, la résilience du peuple ukrainien. L’histoire de Katya et de ses proches, montre leur espoir de vie, leur instinct de survie et l’éternité des sentiments. J’ai aimé ces êtres, qui, plongés au cœur de la tyrannie et de la déshumanisation, n’ont, pourtant, pas perdu leur humanité et leurs espérances. J’ai été bouleversée par le récit de leurs souffrances et émue par l’amour qui n’a jamais quitté leur âme, qu’il soit fraternel, filial ou amoureux. Sous les soleils de Kyiv est un roman poignant sur une tragédie désirée et réalisée par un homme : Joseph Staline ; c’est un devoir de mémoire qui m’a ébranlée.
Erin Litteken indique que la parution de son roman a coïncidé avec l’agression de l’Ukraine par la Russie. Ces mots, prononcés par le père de Katya, avant l’arrivée des militants, dans son village, m’ont frappée en raison de sa résonance avec la guerre actuelle : « C’est la même histoire chaque fois. Depuis des siècles. Tout le monde veut la terre fertile d’Ukraine pour son propre compte et personne ne veut laisser les Ukrainiens libres de se gouverner. » (p. 43)
J’ai eu un coup de cœur pour Sous les soleils de Kyiv.
En 2014, Cassie, une jeune veuve, s’installe chez sa grand-mère, avec sa fille, en Illinois. Le comportement de son aïeule l’interpelle : elle cache de la nourriture, écrit des listes en ukrainien, etc. La jeune femme s’inquiète, mais sa Bobby ne répond pas à ses interrogations. La vieille dame n’a jamais parlé de sa jeunesse. Cependant, elle confie un carnet à Cassie dans lequel celle-ci découvre les souffrances du peuple ukrainien. Le récit comporte une double temporalité. La première se déroule en 2014 et concerne les douleurs de Cassie, après la perte de son époux dans un accident ; la deuxième se passe soixante-dix ans plus tôt, en Ukraine. Les chapitres sont une alternance des deux époques.
Katya vit heureuse avec sa famille, dans un village d’Ukraine. Elle est amoureuse de Pavlo et ses sentiments sont partagés. En septembre 1929, le jour du mariage de sa cousine, elle surprend une conversation inquiétante : les militants envahissent les villages, déportent certains habitants, en Sibérie, et obligent les autres à adhérer au kolkhoze. « L’Ukraine est une région fertile, une terre d’abondance, et Staline estime que nous devons être la corbeille à pain de l’Union soviétique. » (p. 26)
En janvier 1930, les militants pénètrent dans Sonyashnyky. Dès la première nuit, des hommes sont déportés, leurs femmes et leurs enfants reçoivent l’ordre de quitter le village et leurs maisons sont investies par les hommes de Staline. Les premiers mois, l’adhésion au kolkhoze n’est pas obligatoire, mais la pression est forte pour convaincre les derniers récalcitrants : taxes plus élevées, fusillades, déportations, etc. Quand tous les villageois sont forcés de participer au kolkhoze, ils n’ont déjà plus rien. Pourtant, le système est déterminé à leur prendre encore plus. Plus rien ne leur appartient, tout est à l’Etat : le moindre grain de blé, la plus petite souris dans le jardin, les animaux de la forêt, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans les rivières… Le peuple n’a rien à manger et ceux qui ont encore la force de résister sont déportés ou tués.
Ce roman raconte l’Holodomor. « Entre 1932 et 1933, un Ukrainien sur huit est mort d’une famine provoquée par l’homme. Et uniquement par l’homme. » (p. 440) Staline a tenté d’exterminer le peuple ukrainien par la faim. La première fois que j’ai entendu parler de ce fait, c’était après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. J’avais été choquée et meurtrie. Cependant, même si les mots étaient brutaux, je n’avais pas pris conscience à quel point ils étaient justes. Ce roman m’a ouvert les yeux sur les véritables souffrances et sur la réalité des faits. J’ai ressenti la mort qui s’infiltrait dans les corps et les âmes, les forces qui s’éteignaient, j’ai vu les cadavres qui s’amoncelaient, révélant que certains avaient tenté de survivre, mais que leur organisme les avait abandonnés avant l’espoir. La population avait peu de chances de survie, car s’ils étaient surpris à manger des possessions de l’Etat, alors que même la nature appartenait au système, ils étaient abattus. La mort ou la mort : le choix était restreint. Alors que les récoltes étaient abondantes, Staline a instauré un génocide par la faim.
Ce livre montre, avec émotion, la résilience du peuple ukrainien. L’histoire de Katya et de ses proches, montre leur espoir de vie, leur instinct de survie et l’éternité des sentiments. J’ai aimé ces êtres, qui, plongés au cœur de la tyrannie et de la déshumanisation, n’ont, pourtant, pas perdu leur humanité et leurs espérances. J’ai été bouleversée par le récit de leurs souffrances et émue par l’amour qui n’a jamais quitté leur âme, qu’il soit fraternel, filial ou amoureux. Sous les soleils de Kyiv est un roman poignant sur une tragédie désirée et réalisée par un homme : Joseph Staline ; c’est un devoir de mémoire qui m’a ébranlée.
Erin Litteken indique que la parution de son roman a coïncidé avec l’agression de l’Ukraine par la Russie. Ces mots, prononcés par le père de Katya, avant l’arrivée des militants, dans son village, m’ont frappée en raison de sa résonance avec la guerre actuelle : « C’est la même histoire chaque fois. Depuis des siècles. Tout le monde veut la terre fertile d’Ukraine pour son propre compte et personne ne veut laisser les Ukrainiens libres de se gouverner. » (p. 43)
J’ai eu un coup de cœur pour Sous les soleils de Kyiv.

Le Chant des reines
Avis posté le 2022-10-27
Un roman sensible et délicat
Depuis quatre ans, Fanny possède une ferme apicole. Elle vit seule avec sa chienne Glinka, mais elle se rend, régulièrement, au bar de l’Ecluse, tenu par son amie Suzanne. Cette dernière connaît le passé que fuit l’apicultrice. Elle sait aussi ses attentes et ses espoirs. Elle est la détentrice de ses secrets sur lesquels elle veille sans, pourtant, les parcourir.
Cet été, Fanny décide de prendre une stagiaire. C’est le premier jour d’Angora, intéressée par l’élevage d’abeilles. Au début, les questions personnelles de la jeune fille gênent sa maître de stage, pour qui il est difficile de renoncer à la solitude. « Une douce sauvage qui s’est retirée du monde, c’est à cela que Fanny lui fait penser. » (p. 48) Mais, lorsqu’elle décrit son métier et présente ses installations, elle se transforme. Enthousiaste, elle transmet sa passion avec pédagogie et exaltation. J’ai été fascinée par ses explications sur le fonctionnement des abeilles, sur le rôle de chacune au sein de la ruche. J’ai été émerveillée par ses éclaircissements au sujet de la hiérarchie et les besoins de chacune. Fanny mêle la magie et la rationalité : elle est captivante. J’ai aussi aimé le respect qu’elle témoigne à la nature.
Ancienne infirmière, Fanny a quitté la région parisienne pour tenter de se reconstruire. Entièrement dévouée à ses abeilles, elle exprime ses douleurs dans ses peintures et ses écrits. Elle extériorise le manque provoqué par la disparition de son fils. Au début, le défaut d’informations m’a fait imaginer une histoire éloignée de la réalité. Puis, des phrases glissées, avec parcimonie, m’ont orientée dans une autre direction. Fanny entoure ses souffrances d’un voile de pudeur, aussi, ses confidences sont morcelées. Ce sont les choix de mots ou l’absence de ceux-ci qui m’ont révélé, par petits bouts, son passé. J’ai été touchée par sa sensibilité, par ses épreuves, par sa force et par sa mansuétude.
Le Chant des reines a reçu le Prix Jeune Talent Jeannine Balland. J’ai, énormément, aimé la plume sensible et délicate de Sarah Bell. J’ai été émue par la personnalité douce et pudique de Fanny et j’ai été passionnée par ses descriptions du monde apicole. J’ai adoré ce roman.
Depuis quatre ans, Fanny possède une ferme apicole. Elle vit seule avec sa chienne Glinka, mais elle se rend, régulièrement, au bar de l’Ecluse, tenu par son amie Suzanne. Cette dernière connaît le passé que fuit l’apicultrice. Elle sait aussi ses attentes et ses espoirs. Elle est la détentrice de ses secrets sur lesquels elle veille sans, pourtant, les parcourir.
Cet été, Fanny décide de prendre une stagiaire. C’est le premier jour d’Angora, intéressée par l’élevage d’abeilles. Au début, les questions personnelles de la jeune fille gênent sa maître de stage, pour qui il est difficile de renoncer à la solitude. « Une douce sauvage qui s’est retirée du monde, c’est à cela que Fanny lui fait penser. » (p. 48) Mais, lorsqu’elle décrit son métier et présente ses installations, elle se transforme. Enthousiaste, elle transmet sa passion avec pédagogie et exaltation. J’ai été fascinée par ses explications sur le fonctionnement des abeilles, sur le rôle de chacune au sein de la ruche. J’ai été émerveillée par ses éclaircissements au sujet de la hiérarchie et les besoins de chacune. Fanny mêle la magie et la rationalité : elle est captivante. J’ai aussi aimé le respect qu’elle témoigne à la nature.
Ancienne infirmière, Fanny a quitté la région parisienne pour tenter de se reconstruire. Entièrement dévouée à ses abeilles, elle exprime ses douleurs dans ses peintures et ses écrits. Elle extériorise le manque provoqué par la disparition de son fils. Au début, le défaut d’informations m’a fait imaginer une histoire éloignée de la réalité. Puis, des phrases glissées, avec parcimonie, m’ont orientée dans une autre direction. Fanny entoure ses souffrances d’un voile de pudeur, aussi, ses confidences sont morcelées. Ce sont les choix de mots ou l’absence de ceux-ci qui m’ont révélé, par petits bouts, son passé. J’ai été touchée par sa sensibilité, par ses épreuves, par sa force et par sa mansuétude.
Le Chant des reines a reçu le Prix Jeune Talent Jeannine Balland. J’ai, énormément, aimé la plume sensible et délicate de Sarah Bell. J’ai été émue par la personnalité douce et pudique de Fanny et j’ai été passionnée par ses descriptions du monde apicole. J’ai adoré ce roman.

La doublure
Avis posté le 2022-10-16
Subjuguant
« La première fois que j’ai entendu parler de Clara Manan alias calypso Montant, c’était en septembre 2018. » (p. 13) Cela faisait cinq ans que la vie d’Evie était rythmée par les retours de Jean, son petit ami marin. Elle lui avait sacrifié son existence, pourtant, il l’a quitté. Aussi, poussée par un besoin de s’éloigner de Marseille, la ville de leur amour, elle projette de se faire embaucher sur un yacht. Sur le port, elle rencontre Pierre Manan : il lui propose un emploi particulier. Son épouse est peintre : elle se consacre, entièrement, à son art et délaisse les tâches administratives, telles que les réponses aux invitations, les réservations de salles pour les expositions, etc. « Elle aurait besoin d’un bras droit, quelqu’un qui fasse tout cela pour elle, à sa place. Comme une doublure. » (p. 20)
Les œuvres de Clara, alias Calypso, sont à l’image de sa personnalité. Elles s’inspirent du romantisme noir. Leur observation crée un malaise accompagné d’une fascination. Le fonctionnement du couple Manan est, lui aussi, empreint d’une cette noirceur magnétique, dans laquelle Evie plonge avec innocence. Hypnotisée par la personnalité de ses hôtes et employeurs, elle pénètre dans un monde malsain, aux règles déroutantes, dangereuses et perverses. Envoûtée, elle navigue des enfers aux paradis, souvent artificiels. La pureté d’Evie se fissure : elle l’assume.
Les quatre premiers romans de Mélissa Da Costa étaient emplis d’humanité, de douceur et d’émotion. La doublure est un miroir des précédents livres : un voile composé de toxicité, de manipulation, de sadisme, de perversion, d’emprise, d’égoïsme et de dépendance, se déploie et finit par tout recouvrir, même la beauté et l’innocence. L’atmosphère est sombre, hypnotique et lascive. C’est un envoûtement diabolique qui malmène le lecteur, qui se sent oppressé, mais qui, comme Evie, ne peut plus partir : il est piégé par le besoin de connaître l’issue, il est captivé par le franchissement des limites de la morale et les calculs de la perversité.
Avec La Doublure, Mélissa Da Costa nous entraîne dans l’obscurité de l’âme et dans celle des relations humaines. Au départ, cette facette de son talent déstabilise, puis elle nous subjugue. J’ai adoré.
« La première fois que j’ai entendu parler de Clara Manan alias calypso Montant, c’était en septembre 2018. » (p. 13) Cela faisait cinq ans que la vie d’Evie était rythmée par les retours de Jean, son petit ami marin. Elle lui avait sacrifié son existence, pourtant, il l’a quitté. Aussi, poussée par un besoin de s’éloigner de Marseille, la ville de leur amour, elle projette de se faire embaucher sur un yacht. Sur le port, elle rencontre Pierre Manan : il lui propose un emploi particulier. Son épouse est peintre : elle se consacre, entièrement, à son art et délaisse les tâches administratives, telles que les réponses aux invitations, les réservations de salles pour les expositions, etc. « Elle aurait besoin d’un bras droit, quelqu’un qui fasse tout cela pour elle, à sa place. Comme une doublure. » (p. 20)
Les œuvres de Clara, alias Calypso, sont à l’image de sa personnalité. Elles s’inspirent du romantisme noir. Leur observation crée un malaise accompagné d’une fascination. Le fonctionnement du couple Manan est, lui aussi, empreint d’une cette noirceur magnétique, dans laquelle Evie plonge avec innocence. Hypnotisée par la personnalité de ses hôtes et employeurs, elle pénètre dans un monde malsain, aux règles déroutantes, dangereuses et perverses. Envoûtée, elle navigue des enfers aux paradis, souvent artificiels. La pureté d’Evie se fissure : elle l’assume.
Les quatre premiers romans de Mélissa Da Costa étaient emplis d’humanité, de douceur et d’émotion. La doublure est un miroir des précédents livres : un voile composé de toxicité, de manipulation, de sadisme, de perversion, d’emprise, d’égoïsme et de dépendance, se déploie et finit par tout recouvrir, même la beauté et l’innocence. L’atmosphère est sombre, hypnotique et lascive. C’est un envoûtement diabolique qui malmène le lecteur, qui se sent oppressé, mais qui, comme Evie, ne peut plus partir : il est piégé par le besoin de connaître l’issue, il est captivé par le franchissement des limites de la morale et les calculs de la perversité.
Avec La Doublure, Mélissa Da Costa nous entraîne dans l’obscurité de l’âme et dans celle des relations humaines. Au départ, cette facette de son talent déstabilise, puis elle nous subjugue. J’ai adoré.
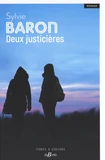
Deux justicières
Avis posté le 2022-10-01
Passionnant et émouvant
Elles ne se connaissent pas, pourtant, elles sont reliées par un destin terrible. Toutes deux essaient de survivre, chacune à sa manière. Leurs filles sont décédées le même soir, victimes du même chauffard. Kathleen et Lydia étaient âgées de dix-sept ans. Elles sortaient de leur cours de théâtre, quand « un bolide incontrôlable » les a renversées et écrasées, avant de prendre la fuite. Le meurtrier n’a jamais été retrouvé.
Un an après le drame, Joséfa a la sensation que la gendarmerie a, depuis longtemps, clos le dossier. Elle décide de contacter Alice, l’autre maman, pour la convaincre d’enquêter ensemble. Elles n’étaient pas faites pour se rencontrer. Elles ne vivent pas dans les mêmes quartiers ; la première cumule les emplois de ménage pour s’alimenter, la deuxième, architecte d’intérieur, a un niveau de vie aisé. Joséfa a un caractère impétueux ; Alice est discrète et les médicaments effacent sa personnalité. Leurs souffrances de mères dépassent les différences. L’union de leurs douleurs crée un duo improbable, mais déterminé à découvrir la vérité pour que la justice soit rendue.
Les deux femmes découvrent des pans cachés de la vie de Lydia et Kathleen, mais aussi qu’elles poursuivaient un objectif similaire au leur. Ces secrets, trop lourds pour leur âge, rendent ces adolescentes attachantes et admirables. Mères et filles ont témoigné du même courage dans l’adversité, oubliant toute notion de sécurité. Plusieurs intrigues alimentent le suspense de ce roman.
Les méthodes de Joséfa et Alice différent autant que leur personnalité. L’une est impulsive et brusque, l’autre est réservée et respecte les règles. Cependant, elles apprennent à s’écouter, à se respecter et veillent l’une sur l’autre. Guidées par le même désir de faire parler les murs, elles deviennent inséparables. De la solidarité et de la peine naît une amitié émouvante, dans laquelle nous espérons que toutes deux trouveront la force de survivre à l’incommensurable tragédie. Hélas, leurs investigations révèlent des faits qui les bouleversent. Malgré leur deuil impossible, leurs cœurs ne sont pas fermés et leur empathie n’est pas éteinte. Avec pudeur, Sylvie Baron traite de thèmes douloureux. J’ai été touchée par sa sensibilité et sa délicatesse. Les faits sont décrits avec la perception des victimes, l’humain est au centre de chaque acte et de chaque ressenti.
Deux justicières est la réédition d’un des premiers romans de Sylvie Baron. Une fois encore, c’est un coup de cœur pour moi.
Elles ne se connaissent pas, pourtant, elles sont reliées par un destin terrible. Toutes deux essaient de survivre, chacune à sa manière. Leurs filles sont décédées le même soir, victimes du même chauffard. Kathleen et Lydia étaient âgées de dix-sept ans. Elles sortaient de leur cours de théâtre, quand « un bolide incontrôlable » les a renversées et écrasées, avant de prendre la fuite. Le meurtrier n’a jamais été retrouvé.
Un an après le drame, Joséfa a la sensation que la gendarmerie a, depuis longtemps, clos le dossier. Elle décide de contacter Alice, l’autre maman, pour la convaincre d’enquêter ensemble. Elles n’étaient pas faites pour se rencontrer. Elles ne vivent pas dans les mêmes quartiers ; la première cumule les emplois de ménage pour s’alimenter, la deuxième, architecte d’intérieur, a un niveau de vie aisé. Joséfa a un caractère impétueux ; Alice est discrète et les médicaments effacent sa personnalité. Leurs souffrances de mères dépassent les différences. L’union de leurs douleurs crée un duo improbable, mais déterminé à découvrir la vérité pour que la justice soit rendue.
Les deux femmes découvrent des pans cachés de la vie de Lydia et Kathleen, mais aussi qu’elles poursuivaient un objectif similaire au leur. Ces secrets, trop lourds pour leur âge, rendent ces adolescentes attachantes et admirables. Mères et filles ont témoigné du même courage dans l’adversité, oubliant toute notion de sécurité. Plusieurs intrigues alimentent le suspense de ce roman.
Les méthodes de Joséfa et Alice différent autant que leur personnalité. L’une est impulsive et brusque, l’autre est réservée et respecte les règles. Cependant, elles apprennent à s’écouter, à se respecter et veillent l’une sur l’autre. Guidées par le même désir de faire parler les murs, elles deviennent inséparables. De la solidarité et de la peine naît une amitié émouvante, dans laquelle nous espérons que toutes deux trouveront la force de survivre à l’incommensurable tragédie. Hélas, leurs investigations révèlent des faits qui les bouleversent. Malgré leur deuil impossible, leurs cœurs ne sont pas fermés et leur empathie n’est pas éteinte. Avec pudeur, Sylvie Baron traite de thèmes douloureux. J’ai été touchée par sa sensibilité et sa délicatesse. Les faits sont décrits avec la perception des victimes, l’humain est au centre de chaque acte et de chaque ressenti.
Deux justicières est la réédition d’un des premiers romans de Sylvie Baron. Une fois encore, c’est un coup de cœur pour moi.