Retour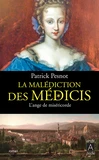

Les dernières notes et avis
Notes et avis 1 à 6 sur un total de 6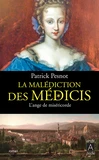
La malédiction des Médicis Tome 3
L'ange de miséricorde
L'ange de miséricorde
Avis posté le 2019-04-13
L'ange de miséricorde
L' « Ange de miséricorde » est le troisième et dernier tome de « La Malédiction des Médicis ». L'action se déroule près d'un siècle après la fin du deuxième volet « Les lys de sang ». Une fois encore, Patrick Pesnot délivre un roman de très bonne facture, au style très fluide.
Si le premier tome relatait l'apogée des Médicis et le second son déclin, le dernier caractérise la déchéance du clan.
Etonnamment, c'est non à Florence, mais à la cour de Louis XIV que débute le roman. Pour des raisons politiques, le roi impose à sa cousine, Marguerite-Louise, un mariage avec Cosme de Médicis, fils du grand-duc Ferdinando II. Union, non pour le meilleur, mais bien pour le pire tant le caractère rebelle de Marguerite-Louise et celui dévot de Cosme sont incompatibles.
Ces derniers donnent néanmoins naissance à trois enfants qui porteront chacun à leur façon les stigmates de l'union désastreuse de leurs parents : Ferdinando (mais ce dernier est-il vraiment le fils de Cosme ?), Anna Maria Luisa, et Gian-Gastone. L'aîné est marié avec une princesse allemande, intelligente et simple, Violante-Béatrice de Bavière.
Si on y ajoute le personnage de Vittoria della Rovere, le lecteur est ainsi en présence des principaux protagonistes de ce roman, dont il suit l'évolution principalement pendant le règne de Cosme, devenu Cosimo III, dans une cité des lys où de grandes faveurs sont accordées au clergé alors que le peuple de Florence est dans le même temps accablé d'impôts.
On constate dans ce livre une approche de l'auteur différente de celle adoptée dans les deux premiers tomes. Là où « le Prince sans couronne » se consacrait quasi exclusivement à la personne de Lorenzo le Magnifique, « Les Fleurs de Lys » principalement à celle de Cosimo Ier, « L'ange de miséricorde » s'intéresse à une multitude de membres du clan Medicis, mettant en exergue qu'aucun des protagonistes de ce dernier tome ne peut à lui seul rivaliser avec la flamboyance ou la tyrannie des premiers.
Le thème de la dualité est également très présent dans le roman.
La différence de caractère entre personnages masculins et féminins est ainsi très frappante.
Les premiers sont, dans l'ensemble, faibles et lâches : Cosimo III, incapable de tenir tête à sa mère excessivement pieuse, Fernandino se livrant à une vie de débauche et Gian-Gastone suivant finalement le même chemin que son frère.
A l'inverse, les secondes, bien que très différentes les unes des autres, sont présentées comme des femmes de caractère : Vittoria Della Rovere et Anna Maria Luisa (de même que, quoique moins présente, Anne-Marie Françoise de Saxe Lauenburg) par leur austérité, Marguerite-Louise par son insoumission, Violante-Béatrice par sa sagesse et même Ménica, jeune paysanne qui devient une poétesse reconnues.
De même, l'opposition entre « vice » et « vertu » est omniprésente. D'un côté, les excès de débauche, chez Marguerite-Louise, Ferdinando et Gian-Gastone. de l'autre les excès religieux, chez Vittoria Della Rovere, Cosimo III et Anna Maria Luisa. Et au centre, Violante-Béatrice, voix de la raison et souffle d'air frais tout au long du roman.
Enfin, la quasi-absence de l'art dans ce volet apparaît comme un signe annonciateur supplémentaire de la fin des Médicis.
Et, à titre personnel, pour avoir éprouvé la sensation d'être projeté au coeur de l'action, je pense que je garderai longtemps en mémoire la scène du face à face entre Gian-Gastone et le marquis Serristori.
L' « Ange de miséricorde » est le troisième et dernier tome de « La Malédiction des Médicis ». L'action se déroule près d'un siècle après la fin du deuxième volet « Les lys de sang ». Une fois encore, Patrick Pesnot délivre un roman de très bonne facture, au style très fluide.
Si le premier tome relatait l'apogée des Médicis et le second son déclin, le dernier caractérise la déchéance du clan.
Etonnamment, c'est non à Florence, mais à la cour de Louis XIV que débute le roman. Pour des raisons politiques, le roi impose à sa cousine, Marguerite-Louise, un mariage avec Cosme de Médicis, fils du grand-duc Ferdinando II. Union, non pour le meilleur, mais bien pour le pire tant le caractère rebelle de Marguerite-Louise et celui dévot de Cosme sont incompatibles.
Ces derniers donnent néanmoins naissance à trois enfants qui porteront chacun à leur façon les stigmates de l'union désastreuse de leurs parents : Ferdinando (mais ce dernier est-il vraiment le fils de Cosme ?), Anna Maria Luisa, et Gian-Gastone. L'aîné est marié avec une princesse allemande, intelligente et simple, Violante-Béatrice de Bavière.
Si on y ajoute le personnage de Vittoria della Rovere, le lecteur est ainsi en présence des principaux protagonistes de ce roman, dont il suit l'évolution principalement pendant le règne de Cosme, devenu Cosimo III, dans une cité des lys où de grandes faveurs sont accordées au clergé alors que le peuple de Florence est dans le même temps accablé d'impôts.
On constate dans ce livre une approche de l'auteur différente de celle adoptée dans les deux premiers tomes. Là où « le Prince sans couronne » se consacrait quasi exclusivement à la personne de Lorenzo le Magnifique, « Les Fleurs de Lys » principalement à celle de Cosimo Ier, « L'ange de miséricorde » s'intéresse à une multitude de membres du clan Medicis, mettant en exergue qu'aucun des protagonistes de ce dernier tome ne peut à lui seul rivaliser avec la flamboyance ou la tyrannie des premiers.
Le thème de la dualité est également très présent dans le roman.
La différence de caractère entre personnages masculins et féminins est ainsi très frappante.
Les premiers sont, dans l'ensemble, faibles et lâches : Cosimo III, incapable de tenir tête à sa mère excessivement pieuse, Fernandino se livrant à une vie de débauche et Gian-Gastone suivant finalement le même chemin que son frère.
A l'inverse, les secondes, bien que très différentes les unes des autres, sont présentées comme des femmes de caractère : Vittoria Della Rovere et Anna Maria Luisa (de même que, quoique moins présente, Anne-Marie Françoise de Saxe Lauenburg) par leur austérité, Marguerite-Louise par son insoumission, Violante-Béatrice par sa sagesse et même Ménica, jeune paysanne qui devient une poétesse reconnues.
De même, l'opposition entre « vice » et « vertu » est omniprésente. D'un côté, les excès de débauche, chez Marguerite-Louise, Ferdinando et Gian-Gastone. de l'autre les excès religieux, chez Vittoria Della Rovere, Cosimo III et Anna Maria Luisa. Et au centre, Violante-Béatrice, voix de la raison et souffle d'air frais tout au long du roman.
Enfin, la quasi-absence de l'art dans ce volet apparaît comme un signe annonciateur supplémentaire de la fin des Médicis.
Et, à titre personnel, pour avoir éprouvé la sensation d'être projeté au coeur de l'action, je pense que je garderai longtemps en mémoire la scène du face à face entre Gian-Gastone et le marquis Serristori.

La malédiction des Médicis Tome 2
Les lys de sang
Les lys de sang
Avis posté le 2019-04-13
Les lys de sang
Ce livre est le deuxième tome du triptyque de Patrick Pesnot dédié à la famille Médicis. S’il peut être lu indépendamment (vingt ans séparent les deux histoires), la lecture des trois ouvrages offre une mise en perspective de l’histoire des Médicis des plus intéressantes.
Ce volet est consacré à la vie de Cosimo Ier. Mais là où dans le premier tome, l’attention du lecteur se centrait quasi exclusivement sur Lorenzo le Magnifique, on s’attache un peu plus ici à découvrir d’autres personnages du clan et, pour ma part, je retiendrai plus particulièrement, quoique pour des raisons très différentes, les deux papes – Léon X et Clément VII – ou bien encore Maria Salviati.
Si l’ouvrage s’ouvre sur la déconfiture connue par les Médicis après le décès de Lorenzo, celle-ci ne sera que temporaire.
Bientôt le lecteur découvre Cosimo, prétendant potentiel au duché de Florence, menacé dès son enfance par un membre de son clan, le pape Clément VII, qui souhaite que le pouvoir revienne à son fils illégitime, Alessandro. Pour protéger Cosimo, sa mère le tient éloigné de Florence. Mais lorsqu’Alessandro, devenu duc, est assassiné par son propre cousin, Cosimo est finalement porté au pouvoir.
C’est alors que le lecteur, tout comme les patriciens de la cité toscane, commence à prendre la mesure de la personnalité de Cosimo, alors tout juste âgé de 17 ans. On le croyait malléable, on le découvre calculateur, ingrat, froid, cruel et pétri d’orgueil.
A l’instar du peuple de Florence, là où, au travers de la plume de Patrick Pesnot, on s’attachait à Lorenzo le Magnifique dans le premier tome, on ne ressent ici aucune sympathie pour ce tyran qui considère que le pouvoir doit s’exercer par la crainte.
Dans ce volet, l’art, de même que les guerres et les alliances politiques, sont un peu moins présents, l’auteur privilégiant les nombreuses querelles intestines empoisonnant la famille et, à la vue du sang qui coule abondamment au fil des pages, on comprend mieux le titre « Les Lys de sang ».
Au travers d’un roman bien construit et d’une plume alerte, on ressort avec l’impression, qu’après le règne de Lorenzo, symbole de l’apogée des Médicis, celui de Cosimo Ier pourrait être le commencement d’un lent déclin.
Ce livre est le deuxième tome du triptyque de Patrick Pesnot dédié à la famille Médicis. S’il peut être lu indépendamment (vingt ans séparent les deux histoires), la lecture des trois ouvrages offre une mise en perspective de l’histoire des Médicis des plus intéressantes.
Ce volet est consacré à la vie de Cosimo Ier. Mais là où dans le premier tome, l’attention du lecteur se centrait quasi exclusivement sur Lorenzo le Magnifique, on s’attache un peu plus ici à découvrir d’autres personnages du clan et, pour ma part, je retiendrai plus particulièrement, quoique pour des raisons très différentes, les deux papes – Léon X et Clément VII – ou bien encore Maria Salviati.
Si l’ouvrage s’ouvre sur la déconfiture connue par les Médicis après le décès de Lorenzo, celle-ci ne sera que temporaire.
Bientôt le lecteur découvre Cosimo, prétendant potentiel au duché de Florence, menacé dès son enfance par un membre de son clan, le pape Clément VII, qui souhaite que le pouvoir revienne à son fils illégitime, Alessandro. Pour protéger Cosimo, sa mère le tient éloigné de Florence. Mais lorsqu’Alessandro, devenu duc, est assassiné par son propre cousin, Cosimo est finalement porté au pouvoir.
C’est alors que le lecteur, tout comme les patriciens de la cité toscane, commence à prendre la mesure de la personnalité de Cosimo, alors tout juste âgé de 17 ans. On le croyait malléable, on le découvre calculateur, ingrat, froid, cruel et pétri d’orgueil.
A l’instar du peuple de Florence, là où, au travers de la plume de Patrick Pesnot, on s’attachait à Lorenzo le Magnifique dans le premier tome, on ne ressent ici aucune sympathie pour ce tyran qui considère que le pouvoir doit s’exercer par la crainte.
Dans ce volet, l’art, de même que les guerres et les alliances politiques, sont un peu moins présents, l’auteur privilégiant les nombreuses querelles intestines empoisonnant la famille et, à la vue du sang qui coule abondamment au fil des pages, on comprend mieux le titre « Les Lys de sang ».
Au travers d’un roman bien construit et d’une plume alerte, on ressort avec l’impression, qu’après le règne de Lorenzo, symbole de l’apogée des Médicis, celui de Cosimo Ier pourrait être le commencement d’un lent déclin.