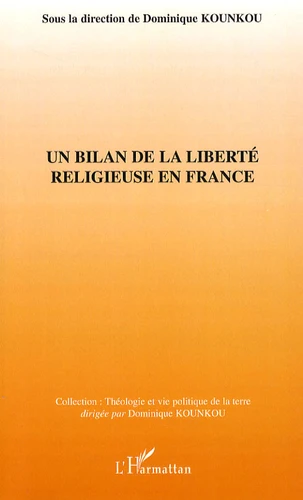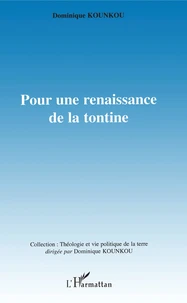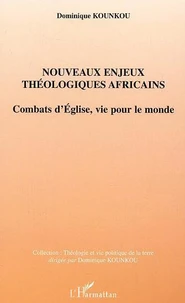Un bilan de la liberté religieuse en France
Par : , , ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 3 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 7 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 3 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages123
- PrésentationBroché
- Poids0.145 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 0,8 cm
- ISBN978-2-296-06970-1
- EAN9782296069701
- Date de parution04/12/2008
- CollectionThéologie et vie politique
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
La France, pays des droits de l'homme... En matière de liberté religieuse, tout irait donc bien dans le meilleur des mondes ? Voire ! Depuis une quarantaine d'années, on assiste à une singulière restriction de cette liberté, qui ne s'appliquerait pas aux mouvements que certains appellent " secte ", mais que les sociologues des religions, refusant tout préjugé, préfèrent appeler " nouveaux mouvements religieux ". Se départant de sa neutralité, l'Etat finance des associations militantes qui luttent contre ces mouvements et n'hésitent pas à se moquer de leurs croyances. En 2001, une loi dite About-Picard a créé un nouveau délit, celui de sujétion psychologique, s'inspirant du concept mussolinien de plagio ", au grand dam des associations internationales de défense des libertés, telle la Fédération internationale d'Helsinki. Le 15 mars 2004, une nouvelle loi a encadré pour la première fois le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. De l'exigence de neutralité des serviteurs de l'Etat, on est ainsi brutalement passé à une exigence de neutralité qui s'appliquerait au simple consommateur des services de l'État, c'est-à-dire au simple citoyen. De là à interdire toute manifestation religieuse dans la sphère publique, la frontière est ténue. D'ailleurs, certains n'hésitent plus à la franchir, proposant de reléguer strictement la religion dans la sphère privée. On le voit, la liberté religieuse n'est pas acquise. C'est le mérite du pasteur Dominique Kounkou, président du Conseil des communautés chrétiennes d'expression africaine en Europe, d'avoir su réunir, au cours d'un colloque organisé le 4 octobre 2006 à Paris, des personnalités aussi diverses que des pasteurs, des juristes, des avocats, des représentants de minorités religieuses pour dresser un bilan de cette liberté en France.
La France, pays des droits de l'homme... En matière de liberté religieuse, tout irait donc bien dans le meilleur des mondes ? Voire ! Depuis une quarantaine d'années, on assiste à une singulière restriction de cette liberté, qui ne s'appliquerait pas aux mouvements que certains appellent " secte ", mais que les sociologues des religions, refusant tout préjugé, préfèrent appeler " nouveaux mouvements religieux ". Se départant de sa neutralité, l'Etat finance des associations militantes qui luttent contre ces mouvements et n'hésitent pas à se moquer de leurs croyances. En 2001, une loi dite About-Picard a créé un nouveau délit, celui de sujétion psychologique, s'inspirant du concept mussolinien de plagio ", au grand dam des associations internationales de défense des libertés, telle la Fédération internationale d'Helsinki. Le 15 mars 2004, une nouvelle loi a encadré pour la première fois le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. De l'exigence de neutralité des serviteurs de l'Etat, on est ainsi brutalement passé à une exigence de neutralité qui s'appliquerait au simple consommateur des services de l'État, c'est-à-dire au simple citoyen. De là à interdire toute manifestation religieuse dans la sphère publique, la frontière est ténue. D'ailleurs, certains n'hésitent plus à la franchir, proposant de reléguer strictement la religion dans la sphère privée. On le voit, la liberté religieuse n'est pas acquise. C'est le mérite du pasteur Dominique Kounkou, président du Conseil des communautés chrétiennes d'expression africaine en Europe, d'avoir su réunir, au cours d'un colloque organisé le 4 octobre 2006 à Paris, des personnalités aussi diverses que des pasteurs, des juristes, des avocats, des représentants de minorités religieuses pour dresser un bilan de cette liberté en France.