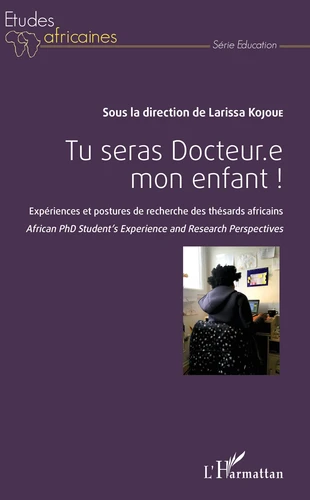Tu seras docteur.e mon enfant !. Expériences et postures de recherche des thésards africains
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 5 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 7 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 5 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages278
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.423 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,6 cm
- ISBN978-2-343-12964-8
- EAN9782343129648
- Date de parution01/12/2017
- CollectionEtudes africaines
- ÉditeurL'Harmattan
- PréfacierMahaman Tidjani Alou
- PostfacierLaurent Vidal
Résumé
L'économie mondiale du savoir auquel l'Afrique devrait contribuer passe nécessairement par le renforcement de la formation doctorale et le soutien à la recherche. Rédiger une thèse de doctorat demande ainsi du temps, de trois ans à plus de dix ans (la tendance globale actuelle est de la limiter à quatre ans maximum), un encadrement institutionnel, des moyens matériels et financiers, de l'autonomie, et de la discipline.
Cependant, contrairement à nos homologues européens, asiatiques ou américains, nous nous engageons la plupart du temps dans une thèse sans repères, sans date butoir, sans bibliothèque, sans financements, sans ordinateurs, sans un encadrement effectif, sans surveillance et surtout sans autres moyens que la volonté d'y arriver. Les motivations varient d'un candidat à l'autre, d'un contexte à un autre.
Cependant, une question demeure : concrètement, comment rédige-t-on une thèse de Doctorat en Afrique aujourd'hui ? Comment devient-on Docteur(e) en sciences sociales à Yaoundé, à Ouagadougou, à Dakar, à Tunis ou à Maputo ? Les expériences sont diverses et singulières. En mettant ensemble quelques-unes d'entre elles par delà nos spécificités culturelles, géographiques, voire disciplinaires, nous essayons d'engager un processus de communication et d'échanges dont le but ultime est de diffuser et d'éclairer un public plus large sur les spécificités et les enjeux du Doctorat en Afrique.
Ce titre volontairement positif est un cri d'encouragement, une promesse et un présage.
Cependant, contrairement à nos homologues européens, asiatiques ou américains, nous nous engageons la plupart du temps dans une thèse sans repères, sans date butoir, sans bibliothèque, sans financements, sans ordinateurs, sans un encadrement effectif, sans surveillance et surtout sans autres moyens que la volonté d'y arriver. Les motivations varient d'un candidat à l'autre, d'un contexte à un autre.
Cependant, une question demeure : concrètement, comment rédige-t-on une thèse de Doctorat en Afrique aujourd'hui ? Comment devient-on Docteur(e) en sciences sociales à Yaoundé, à Ouagadougou, à Dakar, à Tunis ou à Maputo ? Les expériences sont diverses et singulières. En mettant ensemble quelques-unes d'entre elles par delà nos spécificités culturelles, géographiques, voire disciplinaires, nous essayons d'engager un processus de communication et d'échanges dont le but ultime est de diffuser et d'éclairer un public plus large sur les spécificités et les enjeux du Doctorat en Afrique.
Ce titre volontairement positif est un cri d'encouragement, une promesse et un présage.
L'économie mondiale du savoir auquel l'Afrique devrait contribuer passe nécessairement par le renforcement de la formation doctorale et le soutien à la recherche. Rédiger une thèse de doctorat demande ainsi du temps, de trois ans à plus de dix ans (la tendance globale actuelle est de la limiter à quatre ans maximum), un encadrement institutionnel, des moyens matériels et financiers, de l'autonomie, et de la discipline.
Cependant, contrairement à nos homologues européens, asiatiques ou américains, nous nous engageons la plupart du temps dans une thèse sans repères, sans date butoir, sans bibliothèque, sans financements, sans ordinateurs, sans un encadrement effectif, sans surveillance et surtout sans autres moyens que la volonté d'y arriver. Les motivations varient d'un candidat à l'autre, d'un contexte à un autre.
Cependant, une question demeure : concrètement, comment rédige-t-on une thèse de Doctorat en Afrique aujourd'hui ? Comment devient-on Docteur(e) en sciences sociales à Yaoundé, à Ouagadougou, à Dakar, à Tunis ou à Maputo ? Les expériences sont diverses et singulières. En mettant ensemble quelques-unes d'entre elles par delà nos spécificités culturelles, géographiques, voire disciplinaires, nous essayons d'engager un processus de communication et d'échanges dont le but ultime est de diffuser et d'éclairer un public plus large sur les spécificités et les enjeux du Doctorat en Afrique.
Ce titre volontairement positif est un cri d'encouragement, une promesse et un présage.
Cependant, contrairement à nos homologues européens, asiatiques ou américains, nous nous engageons la plupart du temps dans une thèse sans repères, sans date butoir, sans bibliothèque, sans financements, sans ordinateurs, sans un encadrement effectif, sans surveillance et surtout sans autres moyens que la volonté d'y arriver. Les motivations varient d'un candidat à l'autre, d'un contexte à un autre.
Cependant, une question demeure : concrètement, comment rédige-t-on une thèse de Doctorat en Afrique aujourd'hui ? Comment devient-on Docteur(e) en sciences sociales à Yaoundé, à Ouagadougou, à Dakar, à Tunis ou à Maputo ? Les expériences sont diverses et singulières. En mettant ensemble quelques-unes d'entre elles par delà nos spécificités culturelles, géographiques, voire disciplinaires, nous essayons d'engager un processus de communication et d'échanges dont le but ultime est de diffuser et d'éclairer un public plus large sur les spécificités et les enjeux du Doctorat en Afrique.
Ce titre volontairement positif est un cri d'encouragement, une promesse et un présage.