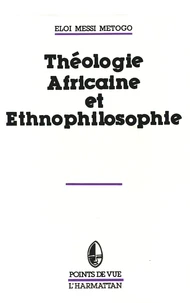La stérilité et la monotonie du discours théologique africain provoquent déjà une accablante lassitude. Comment en serait-il autrement quand il repose sur un double malentendu au sujet de l'Afrique à évangéliser et du christianisme ? D'une part, la théologie africaine sous sa forme la plus répandue se situe dans la ligne de la négritude et de l'ethnophilosophie dont elle plaque les schémas ethnologiques sur les sociétés africaines en pleine mutation.
Bien plus, on a remarqué que ce sont des ecclésiastiques qui ont élaboré les premières systématisations ethnophilosophiques : Tempels, Kagamé, Mulago, Mbiti... Un nombre de plus en plus important de philosophes africains critiquent leur dogmatisme et leur refus de l'histoire. La théologie africaine va-t-elle devenir le dernier bastion de l'ethnophilosophie ? D'autre part, le théologien africain continue, au-delà des bavardages sur l'indigénisation et l'inculturation de l'Evangile, à se référer au christianisme colonial bourgeois, individualiste et pointilleux sur les rites et la "doctrine".
Pour l'auteur, la théologie africaine ne naîtra pas des déclamations lyriques sur les "valeurs africaines de civilisation" ni de l'adaptation des dogmes et des rites chrétiens, mais d'une étude critique et d'une réappropriation responsable du christianisme à partir des préoccupations actuelles des peuples africains.
La stérilité et la monotonie du discours théologique africain provoquent déjà une accablante lassitude. Comment en serait-il autrement quand il repose sur un double malentendu au sujet de l'Afrique à évangéliser et du christianisme ? D'une part, la théologie africaine sous sa forme la plus répandue se situe dans la ligne de la négritude et de l'ethnophilosophie dont elle plaque les schémas ethnologiques sur les sociétés africaines en pleine mutation.
Bien plus, on a remarqué que ce sont des ecclésiastiques qui ont élaboré les premières systématisations ethnophilosophiques : Tempels, Kagamé, Mulago, Mbiti... Un nombre de plus en plus important de philosophes africains critiquent leur dogmatisme et leur refus de l'histoire. La théologie africaine va-t-elle devenir le dernier bastion de l'ethnophilosophie ? D'autre part, le théologien africain continue, au-delà des bavardages sur l'indigénisation et l'inculturation de l'Evangile, à se référer au christianisme colonial bourgeois, individualiste et pointilleux sur les rites et la "doctrine".
Pour l'auteur, la théologie africaine ne naîtra pas des déclamations lyriques sur les "valeurs africaines de civilisation" ni de l'adaptation des dogmes et des rites chrétiens, mais d'une étude critique et d'une réappropriation responsable du christianisme à partir des préoccupations actuelles des peuples africains.