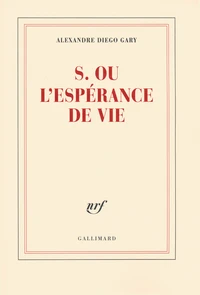En voyant ce livre on pourrait croire que c’est un roman oublié de Romain Gary qui ressortirait de vieux cartons, mais en fait c’est le premier roman de son fils Alexandre Diego, qui s’attaque à l’écriture avec S. ou l’espérance de vie.
Pure fiction ? Non car les détails autobiographiques pullulent, dans cette quête identitaire troublée et troublante. Le lecteur se perd dans la dualité de l’œuvre, qui par certains côtés rappelle W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec, mais avec moins de finesse et d’humour. Entre Georges Perec et Romain Gary, l’héritage littéraire semble lourd à porter pour Alexandre Diego Gary. Celui-ci plonge le lecteur dans la confusion avec ce roman qui sort des schémas usuels.
Deux personnages fictifs se font écho sans pour autant donner sens au récit : un « je », Sébastien Heayes, qui joue au jeu de la réminiscence depuis l’enfance et un « il », l’homme de San Sebastian, qui tente désespérément de prendre la plume pour reconstruire son histoire sur le papier.
« L’homme de San Sebastian […] n’a pas d’état d’âme. Il n’a pas peur des mots, il est en paix avec eux. Il va relater une histoire d’amour et de perdition. Il va raconter les aventures de Sebastien Heayes le Débauché, qui quitta un jour le grand appartement pour plonger dans la nuit. »
Cette histoire est avant tout marquée par la solitude, qui touche le lecteur malgré quelques insuffisances stylistiques. Dans S. ou l’espérance de vie transparaît un vide flagrant que nul n’a jamais pu combler, excepté peut-être Eugénia Muñoz Lacasta, à qui le livre est dédié, la nourrice qui a veillé sur Alexandre Diego Gary depuis ses premiers jours, palliant l’absence de ses parents. De la tendresse transparaît néanmoins à l’égard de ces deux êtres exceptionnels s’il en est, le « grand écrivain » Romain Gary, applaudi par les critiques et auréolé par la gloire et l’actrice américaine d’A bout de souffle, Jean Seberg. Ce récit autobiographique est l’occasion de décrire la perte de ces deux figures parentales, de ces icônes, leur détresse qui les a poussés successivement au suicide malgré l’existence de leur enfant. Leur enfant qui demeure seul dans un grand appartement vide, et qui est amené à rechercher de nouvelles raisons de vivre, même si l’ombre de son nom et de son histoire pèsent inexorablement sur lui. C’est peut-être pour cela qu’il se tourne vers une vie de débauche, entre sexe, alcool et trahisons. Il atteint ainsi un état de perdition qui le pousse à écrire, à « cracher le morceau », à dialoguer avec les mots, avec ses morts qui le hantent. Le récit devient alors laborieux à lire, et la crudité des propos effraie, par exemple lorsqu’il évoque « la grande partouze des morts ». Cependant au fil du texte se crée une certaine sympathie pour ce personnage, qui du désarroi et de la détresse inconsolable découvre progressivement la réconciliation et le pardon avec lui-même. « Simplement vivant. Désespérément vivant aspirant à vivre enfin après ces années de pénombre.»
A travers ce roman, Alexandro Diego Gary cherche à nous interroger sur l’identité, illustrant la question de Claude Roy : « es tu vraiment toi-même ? », se demandant comment exister par et pour soi-même, et pas comme « le fils de ». L’impression qui en ressort est assez mitigée, de belles pages côtoyant quelques effets artificiels.
En voyant ce livre on pourrait croire que c’est un roman oublié de Romain Gary qui ressortirait de vieux cartons, mais en fait c’est le premier roman de son fils Alexandre Diego, qui s’attaque à l’écriture avec S. ou l’espérance de vie.
Pure fiction ? Non car les détails autobiographiques pullulent, dans cette quête identitaire troublée et troublante. Le lecteur se perd dans la dualité de l’œuvre, qui par certains côtés rappelle W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec, mais avec moins de finesse et d’humour. Entre Georges Perec et Romain Gary, l’héritage littéraire semble lourd à porter pour Alexandre Diego Gary. Celui-ci plonge le lecteur dans la confusion avec ce roman qui sort des schémas usuels.
Deux personnages fictifs se font écho sans pour autant donner sens au récit : un « je », Sébastien Heayes, qui joue au jeu de la réminiscence depuis l’enfance et un « il », l’homme de San Sebastian, qui tente désespérément de prendre la plume pour reconstruire son histoire sur le papier.
« L’homme de San Sebastian […] n’a pas d’état d’âme. Il n’a pas peur des mots, il est en paix avec eux. Il va relater une histoire d’amour et de perdition. Il va raconter les aventures de Sebastien Heayes le Débauché, qui quitta un jour le grand appartement pour plonger dans la nuit. »
Cette histoire est avant tout marquée par la solitude, qui touche le lecteur malgré quelques insuffisances stylistiques. Dans S. ou l’espérance de vie transparaît un vide flagrant que nul n’a jamais pu combler, excepté peut-être Eugénia Muñoz Lacasta, à qui le livre est dédié, la nourrice qui a veillé sur Alexandre Diego Gary depuis ses premiers jours, palliant l’absence de ses parents. De la tendresse transparaît néanmoins à l’égard de ces deux êtres exceptionnels s’il en est, le « grand écrivain » Romain Gary, applaudi par les critiques et auréolé par la gloire et l’actrice américaine d’A bout de souffle, Jean Seberg. Ce récit autobiographique est l’occasion de décrire la perte de ces deux figures parentales, de ces icônes, leur détresse qui les a poussés successivement au suicide malgré l’existence de leur enfant. Leur enfant qui demeure seul dans un grand appartement vide, et qui est amené à rechercher de nouvelles raisons de vivre, même si l’ombre de son nom et de son histoire pèsent inexorablement sur lui. C’est peut-être pour cela qu’il se tourne vers une vie de débauche, entre sexe, alcool et trahisons. Il atteint ainsi un état de perdition qui le pousse à écrire, à « cracher le morceau », à dialoguer avec les mots, avec ses morts qui le hantent. Le récit devient alors laborieux à lire, et la crudité des propos effraie, par exemple lorsqu’il évoque « la grande partouze des morts ». Cependant au fil du texte se crée une certaine sympathie pour ce personnage, qui du désarroi et de la détresse inconsolable découvre progressivement la réconciliation et le pardon avec lui-même. « Simplement vivant. Désespérément vivant aspirant à vivre enfin après ces années de pénombre.»
A travers ce roman, Alexandro Diego Gary cherche à nous interroger sur l’identité, illustrant la question de Claude Roy : « es tu vraiment toi-même ? », se demandant comment exister par et pour soi-même, et pas comme « le fils de ». L’impression qui en ressort est assez mitigée, de belles pages côtoyant quelques effets artificiels.