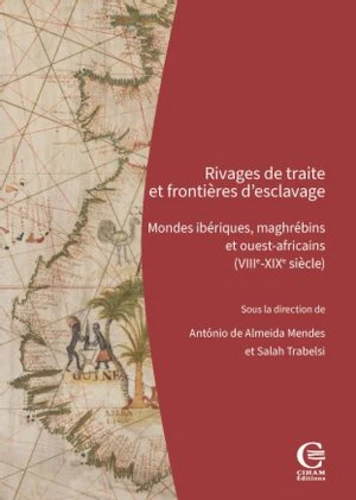Rivages de traite et frontières d'esclavage. Mondes ibériques, maghrébins et ouest-africains (VIIIe-XIXe siècle)
Par : ,Formats :
Disponible d'occasion :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages286
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.544 kg
- Dimensions17,1 cm × 24,2 cm × 1,5 cm
- ISBN978-2-9585809-2-6
- EAN9782958580926
- Date de parution04/12/2024
- CollectionMondes médiévaux
- ÉditeurCIHAM-éditions
Résumé
Au cours des siècles, les itinéraires migratoires en Méditerranée n'ont cessé de se recomposer, les frontières de s'ouvrir ou de se fermer, au gré des évolutions politiques, économiques et institutionnelles. La Méditerranée est devenue, ces dernières années, la route maritime la plus meurtrière au monde. Les migrants qui cherchent aujourd'hui à franchir la frontière méditerranéenne ont en commun d'être des "indésirables", des êtres en attente de nulle part, un fardeau encombrant pour des pays qui s'en débarrassent en les envoyant chez leurs voisins.
Après-guerre, Hannah Arendt voyait dans les migrants, les réfugiés, les apatrides, le symbole d'un temps nouveau dans lequel des millions de femmes et d'hommes se trouvaient privés d'une place dans le monde. Les millions d'esclaves qui ont vécu sur les deux rives de la Méditerranée relèvent de cette catégorie d'individus déplacés qui, après avoir perdu leur qualité d'êtres humains, étaient condamnés à une mort sociale.
Le phénomène de l'esclavage a donné lieu à de nombreux travaux qui prennent le plus souvent comme modèle le commerce atlantique des Africains. La marchandisation de millions de corps, les formes extrêmes de violence et de racialisation à l'oeuvre dans le monde atlantique ont longtemps effacé d'autres formes d'esclavage aussi cruelles, inscrites de façon durable dans les structures économiques, politiques et sociales des sociétés méditerranéennes, nord-africaines ou sahéliennes.
Réfléchir à la place de ces esclaves revient à s'affranchir de l'image du navire négrier, à aller au-delà des chiffres monstrueux de la traversée transatlantique pour discerner des histoires de femmes et d'hommes qui, en dépit de l'invisibilité à laquelle ils ont été condamnés, font partie de l'histoire de nos sociétés méditerranéennes. C'est donc à suivre les traces de ces voyages incessants que ce livre invite, au cours d'un (très) "long Moyen Age" étendant ses bornes chronologiques du VIIIe au XIXe siècle.
Après-guerre, Hannah Arendt voyait dans les migrants, les réfugiés, les apatrides, le symbole d'un temps nouveau dans lequel des millions de femmes et d'hommes se trouvaient privés d'une place dans le monde. Les millions d'esclaves qui ont vécu sur les deux rives de la Méditerranée relèvent de cette catégorie d'individus déplacés qui, après avoir perdu leur qualité d'êtres humains, étaient condamnés à une mort sociale.
Le phénomène de l'esclavage a donné lieu à de nombreux travaux qui prennent le plus souvent comme modèle le commerce atlantique des Africains. La marchandisation de millions de corps, les formes extrêmes de violence et de racialisation à l'oeuvre dans le monde atlantique ont longtemps effacé d'autres formes d'esclavage aussi cruelles, inscrites de façon durable dans les structures économiques, politiques et sociales des sociétés méditerranéennes, nord-africaines ou sahéliennes.
Réfléchir à la place de ces esclaves revient à s'affranchir de l'image du navire négrier, à aller au-delà des chiffres monstrueux de la traversée transatlantique pour discerner des histoires de femmes et d'hommes qui, en dépit de l'invisibilité à laquelle ils ont été condamnés, font partie de l'histoire de nos sociétés méditerranéennes. C'est donc à suivre les traces de ces voyages incessants que ce livre invite, au cours d'un (très) "long Moyen Age" étendant ses bornes chronologiques du VIIIe au XIXe siècle.
Au cours des siècles, les itinéraires migratoires en Méditerranée n'ont cessé de se recomposer, les frontières de s'ouvrir ou de se fermer, au gré des évolutions politiques, économiques et institutionnelles. La Méditerranée est devenue, ces dernières années, la route maritime la plus meurtrière au monde. Les migrants qui cherchent aujourd'hui à franchir la frontière méditerranéenne ont en commun d'être des "indésirables", des êtres en attente de nulle part, un fardeau encombrant pour des pays qui s'en débarrassent en les envoyant chez leurs voisins.
Après-guerre, Hannah Arendt voyait dans les migrants, les réfugiés, les apatrides, le symbole d'un temps nouveau dans lequel des millions de femmes et d'hommes se trouvaient privés d'une place dans le monde. Les millions d'esclaves qui ont vécu sur les deux rives de la Méditerranée relèvent de cette catégorie d'individus déplacés qui, après avoir perdu leur qualité d'êtres humains, étaient condamnés à une mort sociale.
Le phénomène de l'esclavage a donné lieu à de nombreux travaux qui prennent le plus souvent comme modèle le commerce atlantique des Africains. La marchandisation de millions de corps, les formes extrêmes de violence et de racialisation à l'oeuvre dans le monde atlantique ont longtemps effacé d'autres formes d'esclavage aussi cruelles, inscrites de façon durable dans les structures économiques, politiques et sociales des sociétés méditerranéennes, nord-africaines ou sahéliennes.
Réfléchir à la place de ces esclaves revient à s'affranchir de l'image du navire négrier, à aller au-delà des chiffres monstrueux de la traversée transatlantique pour discerner des histoires de femmes et d'hommes qui, en dépit de l'invisibilité à laquelle ils ont été condamnés, font partie de l'histoire de nos sociétés méditerranéennes. C'est donc à suivre les traces de ces voyages incessants que ce livre invite, au cours d'un (très) "long Moyen Age" étendant ses bornes chronologiques du VIIIe au XIXe siècle.
Après-guerre, Hannah Arendt voyait dans les migrants, les réfugiés, les apatrides, le symbole d'un temps nouveau dans lequel des millions de femmes et d'hommes se trouvaient privés d'une place dans le monde. Les millions d'esclaves qui ont vécu sur les deux rives de la Méditerranée relèvent de cette catégorie d'individus déplacés qui, après avoir perdu leur qualité d'êtres humains, étaient condamnés à une mort sociale.
Le phénomène de l'esclavage a donné lieu à de nombreux travaux qui prennent le plus souvent comme modèle le commerce atlantique des Africains. La marchandisation de millions de corps, les formes extrêmes de violence et de racialisation à l'oeuvre dans le monde atlantique ont longtemps effacé d'autres formes d'esclavage aussi cruelles, inscrites de façon durable dans les structures économiques, politiques et sociales des sociétés méditerranéennes, nord-africaines ou sahéliennes.
Réfléchir à la place de ces esclaves revient à s'affranchir de l'image du navire négrier, à aller au-delà des chiffres monstrueux de la traversée transatlantique pour discerner des histoires de femmes et d'hommes qui, en dépit de l'invisibilité à laquelle ils ont été condamnés, font partie de l'histoire de nos sociétés méditerranéennes. C'est donc à suivre les traces de ces voyages incessants que ce livre invite, au cours d'un (très) "long Moyen Age" étendant ses bornes chronologiques du VIIIe au XIXe siècle.