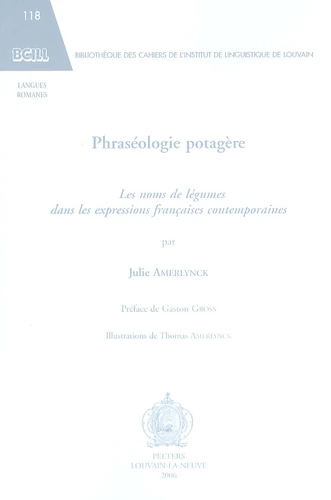Phraséologie potagère. Les noms de légumes dans les expressions françaises contemporaines
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages250
- PrésentationBroché
- Poids0.415 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,2 cm
- ISBN2-87723-919-5
- EAN9782877239196
- Date de parution01/01/2006
- CollectionBCILL
- ÉditeurPeeters France
- PréfacierGaston Gross
- IllustrateurThomas Amerlynck
Résumé
L'imagination de nos aïeux a produit une multitude de métaphores et de "façons de dire" nées de l'observation de la nature, à la fois pleines de fantaisie et de bon sens, mais pour la plupart tombées dans l'oubli. La langue d'aujourd'hui regorge encore d'expressions figurées empruntées au monde des légumes. C'est que le potager inspire toujours le français du XXIe s. : d'avoir la patate à être dans les choux, en passant par faire le poireau et courir sur le haricot, les légumes sont employés à toutes les sauces... Souvent même très "épicées" : tremper son poireau ou dégorger son panais (pour les messieurs), avoir le haricot à la portière ou encore mouiller sa laitue (pour les dames), tournures érotico-argotiques dont l'étonnante inventivité prête à sourire. " On ne connaît pas complètement une chose tant qu'on n'en sait pas l'histoire ". Ceci est spécialement vrai en matière de langage, où un détour par le passé s'avère indispensable à une approche sérieuse de la phraséologie contemporaine. Cet ouvrage s'efforcera de retracer, pour chaque expression, l'évolution de son sens, mais aussi de sa forme. Bien souvent, des changements surviennent au cours de la vie d'une locution, car le français, comme toute langue vivante, ne cesse d'évoluer, se modelant et de se remodelant perpétuellement. Avec le temps, certains éléments d'une expression peuvent se modifier, s'obscurcir, couture pour dissimuler leur valeur initiale. Personne ne soupçonne plus aujourd'hui l'origine obscène de s'occuper de ses oignons, alors que la forme primitive de cette expression était sans équivoque. Ce livre s'attachera aussi à dater avec précision chaque locution, à en éclaircir l'origine et en souligner la cohérence avec des emplois plus anciens. Comme le dit Gaston Gross dans sa préface, " Au fil de l'étude, on voit apparaître, comme dans un bain révélateur, le rôle des légumes comme une source de l'imagination créatrice de la langue dans une nation intéressée comme la nôtre par l'art de la table et celui des
jardins. Certains légumes sont valorisés (oseille, oignon, chou, poireau), d'autres non (artichaut, citrouille, courge, navet) et cela grâce aux propriétés qui leur sont communément attribuées : leur forme qui explique les métaphores sexuelles (asperge, poireau), leur couleur, leur consistance, les vertus cachées qu'on leur reconnaît. Cet ouvrage est à la fois une recherche savante dans le domaine du figeaient lexical, bien documentée, écrite avec clarté, et en même temps un livre qui intéressera le grand
public. Au moment où la linguistique a perdu son rayonnement de naguère, des études de ce type peuvent contribuer à faire apprécier son utilité ".
L'imagination de nos aïeux a produit une multitude de métaphores et de "façons de dire" nées de l'observation de la nature, à la fois pleines de fantaisie et de bon sens, mais pour la plupart tombées dans l'oubli. La langue d'aujourd'hui regorge encore d'expressions figurées empruntées au monde des légumes. C'est que le potager inspire toujours le français du XXIe s. : d'avoir la patate à être dans les choux, en passant par faire le poireau et courir sur le haricot, les légumes sont employés à toutes les sauces... Souvent même très "épicées" : tremper son poireau ou dégorger son panais (pour les messieurs), avoir le haricot à la portière ou encore mouiller sa laitue (pour les dames), tournures érotico-argotiques dont l'étonnante inventivité prête à sourire. " On ne connaît pas complètement une chose tant qu'on n'en sait pas l'histoire ". Ceci est spécialement vrai en matière de langage, où un détour par le passé s'avère indispensable à une approche sérieuse de la phraséologie contemporaine. Cet ouvrage s'efforcera de retracer, pour chaque expression, l'évolution de son sens, mais aussi de sa forme. Bien souvent, des changements surviennent au cours de la vie d'une locution, car le français, comme toute langue vivante, ne cesse d'évoluer, se modelant et de se remodelant perpétuellement. Avec le temps, certains éléments d'une expression peuvent se modifier, s'obscurcir, couture pour dissimuler leur valeur initiale. Personne ne soupçonne plus aujourd'hui l'origine obscène de s'occuper de ses oignons, alors que la forme primitive de cette expression était sans équivoque. Ce livre s'attachera aussi à dater avec précision chaque locution, à en éclaircir l'origine et en souligner la cohérence avec des emplois plus anciens. Comme le dit Gaston Gross dans sa préface, " Au fil de l'étude, on voit apparaître, comme dans un bain révélateur, le rôle des légumes comme une source de l'imagination créatrice de la langue dans une nation intéressée comme la nôtre par l'art de la table et celui des
jardins. Certains légumes sont valorisés (oseille, oignon, chou, poireau), d'autres non (artichaut, citrouille, courge, navet) et cela grâce aux propriétés qui leur sont communément attribuées : leur forme qui explique les métaphores sexuelles (asperge, poireau), leur couleur, leur consistance, les vertus cachées qu'on leur reconnaît. Cet ouvrage est à la fois une recherche savante dans le domaine du figeaient lexical, bien documentée, écrite avec clarté, et en même temps un livre qui intéressera le grand
public. Au moment où la linguistique a perdu son rayonnement de naguère, des études de ce type peuvent contribuer à faire apprécier son utilité ".