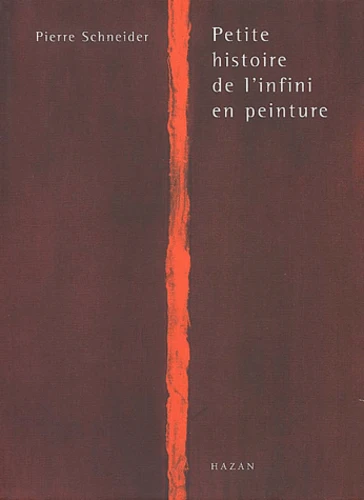Petite Histoire De L'Infini En Peinture
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages511
- PrésentationRelié
- Poids2.46 kg
- Dimensions21,5 cm × 28,5 cm × 4,0 cm
- ISBN2-85025-726-5
- EAN9782850257261
- Date de parution28/11/2001
- ÉditeurHazan
Résumé
Notre époque a tort de voir en la peinture un art dépassé et du passé, estime Pierre Schneider. Pour échapper à la confusion actuelle, il propose de remonter au commencement - et en peinture tout commence avec la confrontation d'une figure et d'un fond. En choisissant de reprendre les choses à partir de ce face à face, Pierre Schneider s'est engagé sur un chemin nouveau : celui qui s'ouvre dans les images lorsqu'on interroge leur fond, en général négligé ou ignoré des historiens de l'art, concernés avant tout par le traitement des figures.
Cette approche neuve conduit l'auteur à découvrir, à côté des modalités du fond traditionnellement reconnues (espace tridimensionnel construit par la perspective et espace décoratif adhérant au plan pictural) une troisième catégorie qui, en certaines occasions, se creuse à l'infini dans le plan pictural. En cherchant à éclairer cet espace " abyssal ", Pierre Schneider est amené à révéler, au sein de l'histoire officielle de l'art, une autre généalogie : celle des artistes qui, depuis la Rome des catacombes jusqu'à la Factory d'Andy Warhol, ont été hantés par l'infini.
Avec cet essai monumental, à la mesure de la somme qu'il avait consacrée à Matisse, Pierre Schneider renouvelle notre façon de voir l'art par une traversée inédite de la peinture.
En s'efforçant de définir concrètement la nature et le comportement du fond, l'auteur met en évidence trois modalités de l'espace pictural. Seules deux d'entre elles ont été retenues par l'histoire de l'art traditionnelle : le " fond plan ", également dit " décoratif ", en raison de l'usage qui en a été fait généralement, ou " abstrait ", depuis que l'art moderne se l'est approprié ; le " fond perspectif ", parce que, grâce à la perspective, le peintre y construit une profondeur simulée. A ces deux-là s'ajoute une troisième catégorie d'espace, rarement perçue par les commentateurs : le " fond perdu " (ou " fond sans fond ") qui se creuse, en certaines circonstances, dans le fond plat, lui permettant d'accueillir la dimension de l'infini.
Pierre Schneider relève les apparitions de cet espace abyssal au fil des siècles, depuis la Rome paléochrétienne et Byzance jusqu'à Manet, Giacometti, Malevitch, Matisse, Dubuffet (pour n'en citer que quelques-uns). Se dégage ainsi une généalogie des artistes de l'infini qui s'ordonne peu à peu en une histoire autre au sein de l'histoire conventionnelle, une histoire en deux temps qui s'éclaire à la lumière de deux passages du livre de la Genèse (Ancien Testament) : dans le premier, qui va du me siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, le rapport figure/fond reflète le rapport de la créature à Dieu ; le second, qui voit l'artiste créer à la place de Dieu, s'épanouit et s'achève au XXe siècle. Sans cesser un instant d'être une étude de l'art, cette Petite histoire de l'infini en peinture se double d'une réflexion sur l'histoire des civilisations et d'une méditation esthétique.
Notre époque a tort de voir en la peinture un art dépassé et du passé, estime Pierre Schneider. Pour échapper à la confusion actuelle, il propose de remonter au commencement - et en peinture tout commence avec la confrontation d'une figure et d'un fond. En choisissant de reprendre les choses à partir de ce face à face, Pierre Schneider s'est engagé sur un chemin nouveau : celui qui s'ouvre dans les images lorsqu'on interroge leur fond, en général négligé ou ignoré des historiens de l'art, concernés avant tout par le traitement des figures.
Cette approche neuve conduit l'auteur à découvrir, à côté des modalités du fond traditionnellement reconnues (espace tridimensionnel construit par la perspective et espace décoratif adhérant au plan pictural) une troisième catégorie qui, en certaines occasions, se creuse à l'infini dans le plan pictural. En cherchant à éclairer cet espace " abyssal ", Pierre Schneider est amené à révéler, au sein de l'histoire officielle de l'art, une autre généalogie : celle des artistes qui, depuis la Rome des catacombes jusqu'à la Factory d'Andy Warhol, ont été hantés par l'infini.
Avec cet essai monumental, à la mesure de la somme qu'il avait consacrée à Matisse, Pierre Schneider renouvelle notre façon de voir l'art par une traversée inédite de la peinture.
En s'efforçant de définir concrètement la nature et le comportement du fond, l'auteur met en évidence trois modalités de l'espace pictural. Seules deux d'entre elles ont été retenues par l'histoire de l'art traditionnelle : le " fond plan ", également dit " décoratif ", en raison de l'usage qui en a été fait généralement, ou " abstrait ", depuis que l'art moderne se l'est approprié ; le " fond perspectif ", parce que, grâce à la perspective, le peintre y construit une profondeur simulée. A ces deux-là s'ajoute une troisième catégorie d'espace, rarement perçue par les commentateurs : le " fond perdu " (ou " fond sans fond ") qui se creuse, en certaines circonstances, dans le fond plat, lui permettant d'accueillir la dimension de l'infini.
Pierre Schneider relève les apparitions de cet espace abyssal au fil des siècles, depuis la Rome paléochrétienne et Byzance jusqu'à Manet, Giacometti, Malevitch, Matisse, Dubuffet (pour n'en citer que quelques-uns). Se dégage ainsi une généalogie des artistes de l'infini qui s'ordonne peu à peu en une histoire autre au sein de l'histoire conventionnelle, une histoire en deux temps qui s'éclaire à la lumière de deux passages du livre de la Genèse (Ancien Testament) : dans le premier, qui va du me siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, le rapport figure/fond reflète le rapport de la créature à Dieu ; le second, qui voit l'artiste créer à la place de Dieu, s'épanouit et s'achève au XXe siècle. Sans cesser un instant d'être une étude de l'art, cette Petite histoire de l'infini en peinture se double d'une réflexion sur l'histoire des civilisations et d'une méditation esthétique.