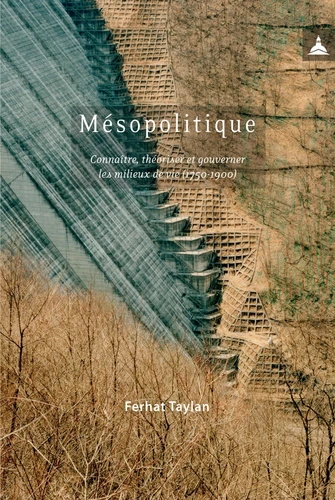Mésopolitique. Connaître, théoriser et gouverner les milieux de vie (1750-1900)
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages307
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.548 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,8 cm
- ISBN979-10-351-0066-7
- EAN9791035100667
- Date de parution17/05/2018
- CollectionHomme et société
- ÉditeurEditions de la Sorbonne
Résumé
Connaît-on vraiment la manière dont notre modernité a fait l'expérience de son milieu, la manière dont elle l'a pensé comme problème politique, scientifique et philosophique ? L'histoire de la question environnementale, souvent élaborée à partir de la tradition darwinienne et de l'écologie politique, semble en effet négliger toute une tradition réflexive sur les milieux de vie, pourtant centrale pour les sciences sociales naissantes dès la seconde moitié du XVIIIème siècle.
En poursuivant les travaux de G. Canguilhem et de M. Foucault, en explorant notamment cette science des milieux que le médecin Bertillon nommait "mésologie" dans les années 1860, cet ouvrage dresse l'histoire d'une rationalité "mésopolitique" : un ensemble de connaissances et de techniques qui visent à altérer, améliorer ou transformer les humains par l'aménagement de leur milieu de vie. Au croisement de plusieurs domaines de savoir (géographie, histoire naturelle, médecine, biologie lamarckienne, sociologie comtienne et durkheimienne) et de pratiques de gouvernement (urbanisme, criminologie), on assiste ainsi à l'émergence du "milieu" dans une même problématisation scientifique et politique.
Il en découle une histoire alternative et critique de la question environnementale, de cette "mésopolitique" qui pose jusqu'à aujourd'hui encore le problème de l'autonomie des populations gouvernées et des milieux dégradés.
En poursuivant les travaux de G. Canguilhem et de M. Foucault, en explorant notamment cette science des milieux que le médecin Bertillon nommait "mésologie" dans les années 1860, cet ouvrage dresse l'histoire d'une rationalité "mésopolitique" : un ensemble de connaissances et de techniques qui visent à altérer, améliorer ou transformer les humains par l'aménagement de leur milieu de vie. Au croisement de plusieurs domaines de savoir (géographie, histoire naturelle, médecine, biologie lamarckienne, sociologie comtienne et durkheimienne) et de pratiques de gouvernement (urbanisme, criminologie), on assiste ainsi à l'émergence du "milieu" dans une même problématisation scientifique et politique.
Il en découle une histoire alternative et critique de la question environnementale, de cette "mésopolitique" qui pose jusqu'à aujourd'hui encore le problème de l'autonomie des populations gouvernées et des milieux dégradés.
Connaît-on vraiment la manière dont notre modernité a fait l'expérience de son milieu, la manière dont elle l'a pensé comme problème politique, scientifique et philosophique ? L'histoire de la question environnementale, souvent élaborée à partir de la tradition darwinienne et de l'écologie politique, semble en effet négliger toute une tradition réflexive sur les milieux de vie, pourtant centrale pour les sciences sociales naissantes dès la seconde moitié du XVIIIème siècle.
En poursuivant les travaux de G. Canguilhem et de M. Foucault, en explorant notamment cette science des milieux que le médecin Bertillon nommait "mésologie" dans les années 1860, cet ouvrage dresse l'histoire d'une rationalité "mésopolitique" : un ensemble de connaissances et de techniques qui visent à altérer, améliorer ou transformer les humains par l'aménagement de leur milieu de vie. Au croisement de plusieurs domaines de savoir (géographie, histoire naturelle, médecine, biologie lamarckienne, sociologie comtienne et durkheimienne) et de pratiques de gouvernement (urbanisme, criminologie), on assiste ainsi à l'émergence du "milieu" dans une même problématisation scientifique et politique.
Il en découle une histoire alternative et critique de la question environnementale, de cette "mésopolitique" qui pose jusqu'à aujourd'hui encore le problème de l'autonomie des populations gouvernées et des milieux dégradés.
En poursuivant les travaux de G. Canguilhem et de M. Foucault, en explorant notamment cette science des milieux que le médecin Bertillon nommait "mésologie" dans les années 1860, cet ouvrage dresse l'histoire d'une rationalité "mésopolitique" : un ensemble de connaissances et de techniques qui visent à altérer, améliorer ou transformer les humains par l'aménagement de leur milieu de vie. Au croisement de plusieurs domaines de savoir (géographie, histoire naturelle, médecine, biologie lamarckienne, sociologie comtienne et durkheimienne) et de pratiques de gouvernement (urbanisme, criminologie), on assiste ainsi à l'émergence du "milieu" dans une même problématisation scientifique et politique.
Il en découle une histoire alternative et critique de la question environnementale, de cette "mésopolitique" qui pose jusqu'à aujourd'hui encore le problème de l'autonomie des populations gouvernées et des milieux dégradés.